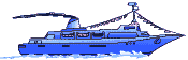 Retour au menu "compléments"
Retour au menu "compléments"
Les premiers pas
|
|
On l'avait dit : l'Algérie devait être une grande mangeuse de vies humaines ; et longtemps la prédiction terrible s'accomplit, De cette terre que l'on ne connaissait pas, de ce climat aux rigueurs excessives, trop chaud ou trop froid, de ces champs immenses et dévastés, on avait mal auguré en France et les prudents ne se gênaient pas pour qualifier de folle aventure une prise de possession qui cependant allongeait du double la ligne de nos frontières. Mais quelles frontières et quelles acquisitions! Des rochers et des rivières à sec, des plaines embroussaillées et malsaines, des landes en friche et où le fer du pionnier s'ébrécherait sur les dures racines du palmier nain. L'Afrique n'était plus la terre ouverte et arrosée où sur les bords de canaux innombrables ondulaient des moissons capables de nourrir un quart de l'Europe, on en avait fait un désert et ce désert, lui-même, ne valait pas d'être pris.
Des hommes qui, par le fait des circonstances, avaient été amenés à vivre là, en avaient rapporté cette impression et ils n'étaient quo trop empressés à la communiquer, en des propos d'un pessimisme aigu qui trouvaient créance. Ne s'étant attachés à voir qu'en surface, ils gardaient le souvenir de contrées coupées et sauvages, où les embuscades perfides offraient une étonnante facilité, où des bandits s'embusquaient sous les bois sombres, derrière des haies naturelles de lentisque ou de cactus aux feuilles épineuses et aiguës. Ainsi l'armée d'occupation, en 1830, avait-elle envisagé la route de Sidi-Ferruch à Alger en passant par les coupe-gorges de la Bouzaréa.
On aimait assez, dans la population calme et paisible, à s'en fier à ces renseignements de source inexacte et le paysan français, commodément installé dans sa ferme ou sa métairie ne se sentait pas d'humeur à aller affronter des dangers quotidiens, des labeurs ingrats, l'inclémence du ciel, les aridités du sol, sans un espoir de s'habituer aux uns et de triompher des autres.
Autant que tous, le Français a des aptitudes colonisatrices et, maintes fois, il en a fourni la démonstration. Même, appliqué à une entreprise quelconque, on peut affirmer qu'il y déploie une merveilleuse souplesse et trouve dans son ingéniosité native des procédés d'adaptation qui le font réussir où d'autres auraient échoué. Son tempérament n'est pas le moule uniforme et immuable dans lequel on se façonne une fois entré, sans pouvoir en faire fléchir les formes rigides : homme des circonstances fortuites, des imprévus audacieux, le Français saisit les uns et les autres pour s'en faire des auxiliaires précieux et il sent en lui-même quelque chose qui le rapproche de tous les êtres humains vivant à la surface du globe. Or, c'est là, dans son caractère, une admirable facilité au rôle de colonisateur et l'espace des lointains ignorés ne devrait pas l'effrayer, s'il ne se sentait si heureux, si à l'aise sur le coin de terre où ses destins l'on fait naître.
Aussi, en y ajoutant les indécisions gouvernementales, comprendrons-nous que l'œuvre de la colonisation africaine se soit lentement ébranlée, ait peu progressé, pendant les premières années et ne se soit lancée à une allure plus vive que dernièrement, quand nombre des aléas avaient été retranchés de la perspective.
Ce fut, quelque temps, une histoire lamentable et il fallut aux hasardeux enfants du pays de France, un stoïcisme étrange, car nous ne voulons pas encore parler du courage louable des véritables colons, Il nous est arrivé de prononcer le nom de Boufarik et d'en rappeler le souvenir funèbre, à l'époque où ce n'était encore qu'une bourgade malsaine, bâtie pauvrement sur la lèvre du marais aux miasmes méphitiques.
Ainsi de nombreux villages naquirent et moururent. Un jour, une bande arrivait et, après avoir parcouru la campagne voisine, s'arrêtait en un endroit jugé propice ; il y avait là des hommes, des femmes et des enfants. On se mettait de suite, à la besogne et des maisons basses, sans étage s'élevaient le long de lignes qui figuraient de larges rues. Les rues étaient sans ombre et les arbres dont les branches brûlées s'y dressaient sur chaque côté ne croissaient que péniblement. Si le village était triangulaire, la place qui en occupait le milieu affectait la même forme, tandis qu'elle était rectangulaire si le village était un rectangle. Tout autour régnait une longue palissade, car il fallait se défendre contre les incursions des bêtes de proie et des brigands arabes, plus terribles encore qui s'en prenaient aux hommes. On vivait constamment sur la défensive, parce que les attaques étaient fréquentes et que le défaut de vigilance eût été mortel. Que de fois pendant la nuit des bandes armées avaient fait irruption, massacré tout, pillé les maisons, mis le feu aux bâtiments et enlevé les troupeaux.
Pendant les dix-sept années que dura la guerre, ce fut une éventualité toujours à prévoir et un événement souvent subi, contre lequel on n'était jamais assez préparé.
Chaque guerre entreprise par Abd-el-Kader autorisait le gouvernement français à s'approprier des centaines de milliers d'hectares, d'où l'Arabe fuyait et nous n'étions plus seulement maîtres du Sahel, mais la vallée de la Mitidja, la vallée de la Seybouse, comme celle de Chéliff nous appartenaient ; le Tell s'était ouvert et, pour le garder, les gouverneurs y avaient créé des postes militaires qui cernaient le pays et en assuraient la tranquillité. Les hauts plateaux eux-mêmes restaient sous la surveillance lointaine mais effective des détachements qui y stationnaient en des enceintes fortifiées; si ce n'était pas la sécurité complète, on y devait trouver, cependant, des garanties plus nombreuses et la facilité d'exploiter un sol qui s'y prêtait plus ou moins.
Ces révoltes furent si fréquentes qu'il serait impossible d'en déterminer le nombre et nous en avons relaté les principales, celles qui agitèrent davantage le pays, quand nous avons narré les longs efforts ayant abouti à la pacification. Elles éclateront subitement, sans un prétexte, sans ces signes avant-coureurs auxquels on eût pu en deviner l'approche ; localisées parfois, dans une vallée, sur l'espace de quelques kilomètres, elles n'étaient pas la guerre en bonne et due forme, mais la dévastation, le brigandage duquel souffraient surtout les colons livrés sans défense à ces hordes cruelles et que les postes voisins n'avaient pas eu le temps de secourir. Des fermes étaient incendiées, des troupeaux dispersés et emmenés, des moissons foulées et coupées jusque dans la racine; puis, lorsque sur les routes percées un peu partout paraissaient quelques cavaliers, spahis ou autres, quand les uniformes français se montraient à l'horizon, la campagne rentrée dans sa désolation était muette et vide. Rien n'était difficile comme les répressions, tant les auteurs du crime savaient se cacher et étaient couverts par le silence de tous. Une seule ressource restait, c'était de punir indistinctement tous les villages d'alentour : le châtiment n'avait rien d'injuste, car tous avaient été complices.
A ces hommes qui vainquirent, à la fois, l'Arabe et la nature, on doit l'hommage rendu aux soldats qui affrontèrent les champs de bataille et peut-être un hommage plus grand encore. Dans les centres arabes des villages nouveaux se bâtirent et furent peuplés soit par des colons seuls, soit par un mélange de colons et d'indigènes : ils furent l'origine d'un certain nombre de communes de plein exercice ou de communes mixtes.
Des savants, des artistes, toute une jeunesse aux aspirations ardentes formèrent l'avant-garde de la grande colonne civilisatrice; mais ces savants, ces jeunes avaient les mains trop blanches, des poitrines insuffisamment à l'épreuve des intempéries, des muscles pas assez tendus; au lieu de l'ouvrage scientifique et moralisateur auquel ils espéraient s'adonner, ils trouvèrent devant eux la besogne du laboureur, devant être accomplie dans des conditions détestables. S'il ne leur eût
fallu que de la vaillance et une certaine ténacité, ils en étaient pourvus : mais il leur manqua la robustesse du corps et la persévérance stoïque et, comme ils s'acharnèrent, sans y être préparés, à une entreprise dépassant leurs forces, ils mourront presque tous. Enfin se présenta la race robuste et entreprenante qui devait se fixer sur le sol africain, y produire le labeur le plus fructueux et transformer notre conquête. Cette race appartint à plus d'un pays et vint de contrées très diverses. Attirée par un champ nouveau offert à son activité, non moins que par les avances du gouvernement français, elle passa le grand lac méditerranéen, et vint de l'Espagne, des départements les plus méridionaux de la France, de l'Italie, de la Sicile, de Malte. Alors une vie nouvelle commença, vie d'une intensité inouïe, qui ne connut pas le repos parce quelle sembla ignorer la fatigue et triompha du sol vaincu. Des lambeaux de terre, comme des propriétés immenses furent creusés et retournés, la terre fuma, les bœufs l'écrasèrent et l'ouvrirent, le maquis se rétrécit, fut resserré jusqu'entre les fentes du rocher et les forêts montèrent insensiblement pour ne plus occuper que les aspérités montagneuses, où se balancèrent les pins et les cèdres. Ce fut un gain pour la quantité de surface arable et ce fut une perte pour la qualité de cette même surface. Les forêts arrêtaient les eaux au passage, de la môme façon que les pointes des montagnes arrêtaient les nuages et en déversaient le contenu ; ces eaux, momentanément immobilisées, s'égouttaient ensuite, sans hâte, entretenant le débit des oueds qui arrosaient les campagnes et il n'y avait pas jusqu'aux aïoun ou fontaines des retraites élevées en altitude qui n'y trouvassent profit. Les bois disparaissant en partie, les oueds furent plus souvent à sec et la disette d'eau, ce grand fléau de l'Algérie, fut plus universellement sentie. En attendant, comme si leur origine eût fixé la destination qu'ils devaient préférer, Italiens, Siciliens et Maltais se fixèrent de préférence dans le département de Constantine et descendirent jusqu'aux oasis du désert. Les Français répandus un peu partout abondèrent davantage dans la province d'Alger et les Espagnols, Mahonnais et autres s'étendirent dans les profondeurs de la province d'Oran. Ce partage ne fut pas exclusif et nombre de colons, ne consultant que leur intérêt n'obéirent pas à la loi du rapprochement. Des plages voisines d'Oran, par un temps clair on apercevait à l'horizon les sommets des sierras, de même qu'une courte traversée de Philippeville amenait sur les côtes de Sicile. Mais l'image de la mère patrie, sans s'effacer complètement, se nuançait d'ombre dans l'esprit de gens qui se faisaient une patrie nouvelle, l'Algérie. Il grandit, en ce temps, dans l'Afrique du nord, toute une génération née sous le ciel de l'Algérie et qui, française par l'origine, l'est, en même temps, par la langue, par les mœurs et par le cœur. Mais ce sont de rudes travailleurs. Qui donc a dit que l'espagnol est paresseux ? Il faut, alors, que le ciel de l'Afrique l'ait bien transformé car, ici, c'est l'ouvrier le plus infatigable dans les mines qui sont nombreuses et d'où l'on extrait le minerai de fer, dans les chantiers où l'alfa se change en pâte molle et en papiers. Même l'espagnol est le créateur de ces jardins gracieux qui forment à certaines villes comme Némora et Tlemcen une ceinture fleurie et les primeurs abondent dans les jardins, pour passer de là aux marchés des grandes villes. ALGÉRIE http://gallica.bnf.fr/Search?lang=FR&ArianeWireIndex=index&f_typedoc=livre&q=algerie&n=15&p=3&pageNumber=1363 |
Mis en ligne le 02 mar 2011