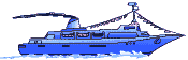 Retour au menu " Indemnisation"
Retour au menu " Indemnisation"
|
" « Il n’y a rien de pire que les périodes de transition, même pour les juristes » 1 "
Pour bien comprendre les difficultés qu’ont connues les juges dans cette époque troublée il faut,
au préalable, faire une synthèse chronologique des textes sur lesquels ils ont tenté de s’appuyer. Que disaient les accords d’Évian du 19 mars 1962 à propos des Français propriétaires en Algérie ? Ils prévoyaient, assez naïvement d’ailleurs quand on sait le climat de violence qui régnait en Algérie à cette époque, que de nombreux Français resteraient sur place dans la nouvelle Algérie indépendante. Ils affirmaient que les Français, remplissant certaines conditions, auraient trois ans pour décider s’ils prenaient la nationalité algérienne (c’est-à-dire jusqu’en 1965). Dans le chapitre suivant des accords d’Évian, consacré à « La coopération entre la France et l'Algérie », dès le préambule, il est affirmé : « Les relations entre les deux pays seront fondées, dans le respect mutuel de leur indépendance, sur la réciprocité des avantages et l'intérêt des deux parties », et ensuite : « L'Algérie garantit les intérêts de la France et les droits acquis des personnes physiques et morales dans les conditions fixées par les présentes déclarations. En contrepartie, la France accordera à l'Algérie son assistance technique et culturelle et apportera à son développement économique et social une aide financière privilégiée. » La rédaction ne laisse pas de doute : il est bien ici question des droits acquis par les personnes physiques et morales. Or l’Algérie ne va pas tarder à enfreindre ces accords. Il importe, dans un premier temps, de dresser un catalogue sommaire des textes algériens ayant organisé la dépossession des Français d’Algérie. Il faudra y revenir sur le fond, au gré des arguments retenus par les juges lors de leurs décisions. Dans la période trouble qui suit le départ des Français d’Algérie, les immeubles ou les propriétés appartenant à des Français ont été occupés de manière « sauvage » par des algériens, qu’il s’agisse d’immeubles ou de domaines agricoles. Mais dès le mois d’août 1962, le nouvel État algérien prend des mesures législatives légitimant la dépossession et la spoliation. Ces textes peuvent se scinder en deux catégories : des textes qui légitiment la prise de possession dans l’intérêt de l’État ou de l’économie algérienne et qui ne prévoient aucune indemnisation ; et des textes intitulés « nationalisations » qui eux, envisagent un transfert de passif et une indemnisation. Le premier groupe de textes se situe en 1962 et 1963 et vise à prendre purement et simplement
les propriétés des Français dans l’intérêt de l’État. La première mesure est une ordonnance
d’août 1962 4 concernant la gestion des biens vacants qui sera complétée par le décret du 18
mars 1963 5. Le gouvernement provisoire confie aux préfets le soin de recenser les locaux
d’habitation vacants depuis deux mois ainsi que toutes les entreprises industrielles, artisanales et
agricoles qui ne fonctionnent pas depuis deux mois. Ils doivent ensuite nommer un
administrateur-gérant. Il est bien précisé dans l’article 12 que les propriétaires (français)
pourront réintégrer leurs biens, mais le décret de mars 1963 ne laisse plus de doute : ces biens
deviennent la propriété de l’État algérien. Enfin le premier octobre 1963 6, un décret déclare biens de l’État toutes les propriétés agricoles
qui n’appartiennent pas à des Algériens (celles des Français). Les domaines agricoles qui étaient
passés par la phase « biens vacants » et dont l’exploitation avait été confiée à des comités de
gestion deviennent définitivement propriété de l’État algérien en ces termes : « sont déclarées
biens de l’État les exploitations agricoles appartenant aux personnes physiques ou morales qui, à
la date du présent décret, ne jouissaient pas de la nationalité algérienne ou ne justifiaient pas
avoir accompli les formalités légales en vue de l’acquisition de cette nationalité ». Sont
concernés également tous les Français qui sont restés après l’indépendance, ils sont expulsés de
leur domaine car ils n’ont pas la nationalité algérienne. Or, si l’on suit les accords d’Évian, ils
avaient trois ans, donc, jusqu’en 1965, pour choisir de devenir algériens.
Il y a bien d’autres textes mais ceux-ci sont essentiels. Dans aucun d’entre eux, il n’est question
d’indemnisation des personnes spoliées au nom de la Révolution socialiste. Une interview 7 du
président Ben Bella ne laisse aucun doute sur les intentions du gouvernement algérien de ne pas
respecter les accords d’Évian : à la question qui lui était posée de savoir s’il comptait
indemniser les colons expropriés, il répond : « non parce que je pense que leur exploitation est
amortie depuis longtemps, et d’ailleurs où trouver cet argent pour indemniser ? …. Même avec
tous les gaz et pétroles du monde, je ne pourrais pas payer, je pense qu’il faut tourner la page.
Cela a obéré la coopération.» Le second groupe de textes réglemente les « nationalisations ». On change de taille, il s’agit ici
de très grandes entreprises ou d’industries. Par l’Ordonnance du 4 novembre 1963, la
fabrication, la vente et l’importation de tabacs et allumettes est nationalisée 9. Il est dit dans
l’article 7 « l’ensemble des biens, droits et obligations des manufactures et entreprises de tabacs
et allumettes est intégralement transféré à la S.N.T.A 10 ». L’article suivant prévoit une indemnisation. Et l’article 11 édicte que « des arrêtés du ministre de l’Économie fixeront, pour
chaque entreprise le montant de l’indemnisation. »
La loi du 26 décembre 1961 13 qui aborde, pour la première fois, la question des rapatriements, ne
fait qu’affirmer le principe d’une indemnisation : dans son dernier paragraphe, qui a donné lieu
à des discussions fournies dans les travaux préparatoires, il est expressément dit : « une loi
distincte fixera, en fonction des circonstances, le montant et les modalités d’une indemnisation
en cas de spoliation et de perte définitivement établie des biens appartenant aux personnes
visées au premier alinéa de l’article 1er et au premier alinéa de l’article ». Cette loi distincte
tardera bien à voir le jour. La loi n° 66-485 du 6 juillet 1966 16 apporte des modifications à la loi de 1963. La loi de 1963 ne
visait que les rapatriés, personnes physiques, la loi de 1966 l’étend aussi aux personnes morales.
La loi de 1966 vise toutes les obligations même les prêts de réinstallation. Pour ce qui est des
« dettes algériennes », elles sont prises en compte dans leur ensemble. Et, de plus, la durée des
délais qu’il est possible au juge d’accorder est augmentée.
Il faudra attendre la loi du 6 novembre 1969 spécifique aux personnes « dépossédées de leurs
biens Outre-mer », loi à titre provisoire, loi d’urgence ou en urgence, pour que soit consacrée la suspension des poursuites en paiement contre les rapatriés. Elle sera suivie par la loi n° 70-632
du 15 juillet 1970 qui organise « la contribution nationale à l’indemnisation des Français
dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le
protectorat ou la tutelle de la France ». Cette loi contient un chapitre relatif aux conditions de
dépossession, ouvrant droit à indemnisation. Le titre IV est consacré aux créances sur les
rapatriés et les personnes dépossédées de leurs biens Outre-mer. Le droit prend enfin en compte,
dans leur complexité, les « dettes algériennes ». C’est dans ce contexte juridique que les juges, saisis des actions en paiement dès les premières années après les accords d’Évian, ont dû résoudre au mieux ces situations extrêmement complexes. L’analyse de 85 décisions de justice allant de 1965 à 2006 permet de déterminer le rôle très important du magistrat. La première question à résoudre est celle de l’extinction ou du maintien de la dette à la charge du rapatrié. (I.) Dans un premier temps les magistrats ont tendance, devant l’iniquité de ces poursuites, troublés par le drame que vivent les Français d’Algérie, à prendre des décisions très favorables au débiteur rapatrié (A.). Puis, la Cour de cassation intervient et applique la loi sans faire de sentiment. Elle décide, sans équivoque que le débiteur est tenu de payer (B.) La seconde question a trait aux moyens juridiques disponibles pour tempérer cette obligation. (II.) La première mesure législative permet au juge d’accorder des délais de paiement exceptionnels mais n’offre pas une réponse satisfaisante au problème des « dettes algériennes » (A.). Il faudra attendre que le législateur intervienne pour que cessent ces poursuites mais les problèmes juridiques, s’ils changent de nature n’ont pas disparu pour autant. (B.) I. Une jurisprudence contrastée : dette éteinte ou dette exigible Dès leur retour en métropole, les créanciers des rapatriés les poursuivent en paiement pour des dettes nées en Algérie. Les débiteurs spoliés de leurs biens refusent de payer et ils vont rencontrer, dans un premier temps, la compréhension des juges. A. La compassion des juridictions de première instance : une obligation morale Les recours des créanciers contre leurs débiteurs algériens interviennent dès la première année
des rapatriements et les juges de première instance, saisis de ces questions, sont tout à fait
démunis car, dès 1963, l’État algérien a commencé à déposséder les Français des biens qu’ils
détenaient sur leur territoire. Aucune loi n’ayant été faite pour permettre de résoudre le
problème particulier des dettes algériennes, c’est au juriste d’aller puiser dans les textes
existants la légitimation du choix de déclarer éteinte ou exigible une dette née en Algérie au
profit de biens dont le débiteur a été dépossédé. Il faut éliminer la piste administrative car les décisions du Conseil d’État ne laissent aucune
possibilité de poursuivre la responsabilité de l’État français. Certains ont recherché cette
responsabilité de l’État français au motif qu’il n’a pas exigé la création de la Cour des garanties
prévue par les accords d’Evian. Le Tribunal administratif répond à cet argument que la
constitution de cette institution relevait de l’État algérien et que, de ce fait, les juridictions
administratives doivent se déclarer incompétentes. Dans une affaire plus tardive, devant le
Conseil d’État, en novembre 1968 21, la Haute juridiction administrative confirme cette
jurisprudence. L’État français ne peut voir sa responsabilité recherchée au motif qu’en
négociant les accords d’Évian, il se serait engagé à garantir l’indemnisation des Français
dépossédés. En effet, il s’agit d’une action de caractère international qui n’est pas de la
compétence du Conseil d’État. De même, les juridictions administratives sont incompétentes
pour connaître d’un problème se rattachant aux rapports entre l’exécutif et le Parlement comme
le fait de ne pas avoir déposé de projet de loi d’indemnisation conformément à ce qui était prévu
dans le texte de loi de 1961. Donc les juridictions administratives étant incompétentes, c’est au
civil que les litiges nés des « dettes algériennes » vont être portés et particulièrement devant la
première Chambre civile de la Cour de cassation.
Dans un premier temps, les juges de première instance, une peu désemparés, ont sursis à statuer
sans donner aucun délai 22, en se fondant sur la loi du 26 décembre 1961 qui annonçait un texte à
venir sur les indemnisations des rapatriés victimes de spoliation. Mais, assez vite, la loi de 1963 qui traite spécifiquement de la question des « dettes algériennes » enferme les juges qui ne peuvent plus les déclarer éteintes mais seulement donner des délais. Cependant, cette loi ne s’applique pas aux personnes morales et les tribunaux continuent de chercher des solutions équitables pour le débiteur, lorsqu’il est une société par exemple. Car il y a aussi des spoliés qui ne sont pas des rapatriés. En effet, s’ils avaient des biens en Algérie, certains n’y habitaient pas. C’est souvent le cas d’importantes sociétés nationalisées. Ceux là ne bénéficient pas des délais de la loi de 1963 réservée aux rapatriés personnes physiques (la correction sera faite par la loi de 1966). Mais alors, on se heurte à un autre problème : la loi de 1961 ne concernant que les personnes physiques, on ne peut surseoir à statuer indéfiniment sans commettre un déni de justice. D’autres magistrats se sont alors appuyés sur la force majeure et le fait du prince pour déclarer
les dettes éteintes 23. Mais s’il y a bien fait du prince, il ne rend pas impossible le paiement d’une
dette contractée avec un tiers étranger à la spoliation. La théorie de l’unicité de patrimoine
rendant difficile l’application de la force majeure.
De nombreux juges 24 ordonnent aussi les mainlevées de mesures conservatoires sur le motif que
les poursuites des créanciers fondées sur des dettes algériennes vont obliger les rapatriés à les rembourser grâce aux prêts de réinstallation octroyés par l’État français, ajoutant une seconde
spoliation à la première. Mais ce n’était que temporaire. Une autre solution se fait jour fondée
sur le transfert du passif qui serait la conséquence de la confiscation de l’actif. Le juge des
référés du Tribunal de grande instance de Marseille 25 a décidé qu’en cas de nationalisation
algérienne, il y avait transfert du passif vers l’État algérien nouveau propriétaire. En effet,
beaucoup de juges ont trouvé facile d’assimiler les dépossessions de biens vacants à des
nationalisations et ainsi de soumettre ces opérations aux règles des nationalisations notamment à
celle du transfert de passif, mais cela se heurte au fait que, dans les lois algériennes, il n’en est
nullement question.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en 1966 26 fait avancer les choses en distinguant les
personnes dépossédées selon les lois sur les biens vacants et les domaines agricoles, où aucun
transfert de passif ni aucune indemnisation ne sont prévus, des personnes dont les entreprises
ont été nationalisées, la loi algérienne de nationalisation envisageant le transfert de passif et
l’indemnisation.
Mais les Cours d’appel, si elles compatissent avec les rapatriés spoliés, vont vite revenir à une
application du droit plus orthodoxe. Dans plusieurs décisions 27, elles infirment des décisions de
première instance qui avaient sursis à statuer sans fixer de terme. La Cour d’appel conteste que
l’on puisse s’appuyer sur le principe d’une loi d’indemnisation annoncée par la loi du 26
décembre 1961. La Cour d’Aix-en-Provence affirme en effet : « le retard apporté par le débiteur
au payement de sa dette ne met pas, en principe, le créancier en droit de surseoir au paiement dû
à un tiers, si par suite de la carence de ses débiteurs, fut-elle liée au fait du prince ou à un cas de
force majeure, ce créancier est dans l’impossibilité de remplir ses propres engagements, il ne
pourra que solliciter un délai de grâce.» Ainsi on ne peut surseoir à statuer au motif d’une
indemnisation future par l’État français. Les juges ajoutent que si c’était le cas, on ne voit pas
pourquoi le législateur aurait prévu des délais exceptionnels dans la loi du 11 décembre 1963.
Cela n’empêche pas le Tribunal de commerce de la Seine 28 de résister et de donner une
motivation originale au sursis à statuer qu’il prononce : « Ce principe d’une indemnisation
équitable est non seulement conforme à l’article 545 du Code civil français et considéré comme
d’ordre public, mais encore est conforme aux principes généralement admis par tous les pays
civilisés ; attendu que, si l’État algérien n’a pris aucune disposition quant à présent, pour
l’appliquer, ce principe est, par contre, clairement exprimé par l’article 4 de la loi-cadre
française du 26 décembre 1961 et est entré dans le droit interne français par le jeu de la loi
référendaire ayant approuvé les accords d’Évian.
Pour ce qui concerne la dépossession d’un domaine agricole, la Cour d’appel d’Aix-en-
Provence, estime que, bien que qu’il ait été déclaré bien de l’État et bien qu’il ait été précisé
qu’aucune poursuite pour dette antérieure ne serait possible contre ces biens, il n’y a pas pour
autant transfert du passif. La spoliation ne fait pas disparaître la dette pour le débiteur initial qui
peut être poursuivi sur ses biens en France 30.
Par ailleurs, plusieurs sociétés ont fait l’objet de dépossession dans le cadre de véritables lois de
nationalisation, intitulées ainsi par l’État algérien. Ces spoliations, parce que les textes algériens
prévoient le transfert du passif sont moins problématiques. Le juge s’appuie alors sur la
novation extinctive, le changement de débiteur ayant éteint la dette à l’égard du débiteur initial.
Dans une affaire, jugée par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence 32, la Banque nationale
pour le commerce et l’industrie-Afrique poursuit en paiement d’avances bancaires, un associé
d’une société en nom collectif de semoulerie qui a fait l’objet d’une nationalisation. En réalité,
elle a d’abord été déclarée bien vacant, puis mise sous comité de gestion, puis une personne
morale algérienne a été créée et c’est un établissement public qui a repris la semoulerie, la
société ayant été déclarée bien de l’État « nationalisée » avec transfert de l’actif et du passif. Le
débiteur soutient que la dette de la société serait éteinte par novation extinctive. Le Tribunal fait
remarquer que la dette étant née entre les parties après l’indépendance, c’est la loi algérienne qui
s’applique et en tire pour conséquence que la banque doit poursuivre l’établissement public
ayant pris possession de l’entreprise en Algérie, nouveau débiteur. Dans sa note M. Ghanassia 33
fait remarquer que tous ces débiteurs poursuivis ont dû emprunter à leur arrivée en France pour
reconstruire un patrimoine et que si l’on exige le paiement des dettes nées en Algérie sur des
biens dont ils ont été spoliés, ils ne pourront rembourser les emprunts contractés en métropole.
Cette jurisprudence qui a eu de grands retentissements dans la presse est suivie par deux
décisions semblables 34.
La Cour d’appel de Paris 36 distingue bien les dépossessions résultant de la déclaration de biens
vacants qui n’entraînent pas transfert de passif à l’État algérien, des nationalisations qui
prévoient expressément ce transfert, pour condamner le propriétaire spolié d’un domaine
agricole à payer sa dette. Le commentateur, J. Ribs, est très critique, il pense que le juge n’a
aucun droit d’interpréter les textes algériens qui restent silencieux quant au sort du passif pour
les biens vacants et les domaines agricoles, comme excluant toute extinction de la dette et il
ajoute, « la seule voie raisonnablement ouverte à la jurisprudence est de constater le silence de la loi algérienne et, faisant application des principes d’ordre public du droit français, de décider
que l’appropriation par le Gouvernement algérien des exploitations de nos ressortissants a eu
pour effet de transférer le passif de ces entreprises détachées du patrimoine de leurs anciens
propriétaires, au Gouvernement algérien dans la proportion et à due concurrence de l’actif
recueilli. »
La Cour d’appel de Paris n’a jamais été très favorable au rapatrié, ainsi rend-elle une décision
obligeant le débiteur spolié d’un appartement acheté à crédit, à payer son créancier. Elle estime
que le débiteur ne peut prétendre avoir une créance d’indemnisation contre l’État français en
s’appuyant sur le principe d’indemnisation annoncé dans la loi de 1961. Il ne peut prétendre non
plus que le prêteur doit se retourner contre le possesseur de l’appartement car l’unité de
patrimoine s’oppose à ce que l’on fractionne les biens du débiteur 37. La Cour de Paris suit
toujours sa ligne jurisprudentielle en février 1967 38 et ajoute un argument qui, on le verra, sera
retenu et fondera l’argumentation de la Cour de cassation : les nationalisations algériennes
(biens vacants et domaines agricoles) faites sans indemnité sont contraires à l’ordre public
français, dès lors le débiteur ne peut en faire état pour s’exonérer de son obligation envers le
créancier français.
En mai 1967, la Cour d’appel de Nîmes s’engage sur la même voie, elle distingue les lois de nationalisation des textes de dépossession des biens vacants. Elle affirme que « le transfert de propriété à l’État algérien, décidé au dépens de personnes physiques ou morales de droit privé, au profit de la collectivité et dans le but proclamé de socialisation des terres, ne peut s’analyser qu’en une nationalisation. » Cependant, la dette étant née alors que l’Algérie était française, c’est la loi française qui s’applique et l’on ne peut imposer au créancier une substitution de débiteur décidée par une loi étrangère. Encore une autre argumentation défavorable au débiteur. Le 18 octobre 1967 une décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence condamne l’acheteur
d’un appartement en Algérie à payer le solde du prix, même s’il en a été dépossédé, la vente
étant parfaite dès sa conclusion 39. Un arrêt de la même Cour du 1er octobre 1968 40, rejette aussi
les arguments du débiteur pour refuser de payer et déclare que les spoliations ne constituent pas
des cas de force majeure exonératoire car elles ne rendent pas impossible le paiement de la
dette.
Si l’essentiel des affaires de nationalisations concernent l’Algérie, la question s’est aussi posée
pour le Maroc : le Tribunal de Grande Instance de Nice 41 a eu à connaître d’un litige portant sur
la nationalisation d’un domaine agricole au titre de la « récupération des terres de colonisation
officielle » 42. Or les propriétaires n’avaient pas fini de rembourser un prêt fait dans l’intérêt de
cette propriété. Pour une propriété estimée à 640 000 F, ils ont reçu une indemnisation de
90 175 F ; ils ont donc subi un préjudice important. Les juges assimilent cette dépossession à
une nationalisation faisant du domaine agricole une entité économique indépendante qui a été
transmise à l’État marocain avec son actif et son passif. Le TGI fait preuve d’originalité en
ventilant la somme de l’indemnisation (90 175 F) entre le prêteur, en l’occurrence l’État
français, et le débiteur spolié un tiers pour le prêteur et les deux tiers pour le propriétaire spolié.
Comme toutes les juridictions de première instance, on reste favorable au débiteur. L’astuce ici
consiste à considérer que la dette incombe à l’exploitation elle-même et non à l’exploitant.
« Savoir réaliser l’équité à l’aide de la règle juridique, telle est l’ambition suprême de tout
magistrat ; le jugement du tribunal de Nice y parvient ; il n’eut pas été désavoué par
Salomon 43.»
Nous avons fait le choix délibéré de décrire la jurisprudence dans son ordre chronologique pour
montrer son caractère mouvant et dispersé. Si les cours d’appel ont tendance à être moins
favorables au débiteur, les premières instances et notamment les juridictions commerciales
continuent de le défendre. Pour résumer un peu cet imbroglio juridique, on peut dire que les
décisions favorables aux débiteurs, soit sursoient à statuer en attendant une éventuelle
indemnisation, soit déclarent la dette éteinte pour force majeure ou fait du prince ou encore
parce qu’elles assimilent les dépossessions à des nationalisations et décident qu’il y a eu
transfert de passif libérant le débiteur initial. Les jugements et arrêts qui condamnent le débiteur
au paiement malgré son caractère injuste, s’appuient sur le principe de l’unicité de patrimoine,
sur l’existence d’une possibilité de paiement sur les biens situés en métropole et sur le caractère
contraire à l’ordre public français des décrets algériens qui, de ce fait, ne peuvent fonder l’action
judiciaire. B. La rigueur de la Cour de cassation : une obligation juridique Jusque-là aucune décision de la Cour de cassation n’est venue fixer un droit. La première à trancher la question est la Chambre commerciale le 3 mars 1969. Il s’agissait d’une affaire opposant les dirigeants de la société Rivoire et Carret à un de ses fournisseurs bénéficiaire de lettres de change. Cette société, d’abord déclarée bien vacant, gérée par un comité de gestion, a été nationalisée par le décret du 22 mai 1964. La Cour d’appel avait rejeté la demande en paiement à l’encontre des dirigeants précisant que c’était la société nationalisée algérienne qui était débitrice. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Donc un premier arrêt de cassation assez favorable au débiteur même si l’on est ici dans le cadre des décrets de nationalisation. La Chambre commerciale s’appuyant tout de même sur des textes algériens décidant du transfert du passif. La première chambre civile, saisie de l’essentiel des pourvois se devait de réagir. Elle le fera par
neuf décisions rendues le même jour le 23 avril 1969 44, décisions qui reflètent tous les cas de
figure qui ont pu se présenter devant les juges de première instance et qui toutes décident que le
débiteur doit payer. « C’est un bien grand désordre qu’un droit, même inspiré par l’équité, qui
se plie aux circonstances. Il n’est, à long terme meilleure garantie de l’équité que la rigueur de
la règle de droit » 45 dit Jean Denis Bredin. Effectivement on ne pouvait rester dans cet
éparpillement jurisprudentiel qui donnait un caractère tout à fait aléatoire à la solution juridique.
Ces décisions sont précédées par des conclusions absolument remarquables de l’avocat général
Blondeau qui participera à l’essentiel de la jurisprudence construite par la Cour de cassation sur
les questions juridiques soulevées par les rapatriés 46. Il y reprend, point par point, toutes les
argumentations avancées jusque-là et fait des suggestions aux juges de la Haute juridiction. On verra que la solution finalement adoptée n’était pas la préférée de l’avocat général mais la plus
simple, la plus radicale et surtout la plus « politique ».
L’avocat général dresse d’abord la liste des difficultés inhérentes à ces dossiers. Les débiteurs
sont des Français qui ont tout perdu 47. Les condamner au paiement de dettes nées en Algérie
remet en cause les mesures d’aide à la réinstallation car si les prêts accordés servent à
rembourser les dettes algériennes, les rapatriés n’auront plus aucun moyen de réinsertion. Les
sommes empruntées ont profité aux exploitations dont ils ont été spoliés. Mais d’un autre côté,
les créanciers sont aussi des banques françaises. Elles sont des créanciers sans reproche et il
n’est pas exclu qu’un particulier puisse être créancier. Il pose la question à la Cour : « pouvez vous
courir le risque de remplacer un spolié par un autre ? » Or le problème est né du fait qu’un
État étranger a légiféré dans des circonstances exceptionnelles. Ces textes ont abouti à la
dépossession des Français d’Algérie et ils sont en contradiction avec nos conceptions juridiques
et avec les accords d’Évian. L’avocat général affirme que les juridictions algériennes n’ont
donné aucune interprétation de ces textes sommaires et, qui plus est, aucun Français ne s’est
porté devant ces juridictions pour obtenir cette interprétation (ce raisonnement est un peu naïf
quand on sait dans quelles circonstances, les Français ont quitté l’Algérie). Donc « situation sans précédent », ce sont nos tribunaux de première instance qui ont été les premiers à interpréter ces textes. L’avocat général conseille une analyse stricte des textes algériens et réfute la construction doctrinale brillante qui les a interprétés comme des nationalisations favorables aux débiteur, mais il réfute également l’interprétation inverse qui s’appuie sur l’incompatibilité de ces textes avec l’ordre public international et qui ferme toute possibilité de remboursement au débiteur. Avant de proposer des solutions qui seront défavorables au débiteur, il rappelle que la loi de 1963 modifiée par la loi de 1966 permet d’atténuer les effets de ces décisions en accordant des délais et que, comme cela est prévu par la loi de 1961, l’État prendra bien un jour la décision d’indemniser. D’abord, il démolit l’argument fondé sur le fait que la perte du patrimoine résultant du fait du prince constituait un cas de force majeure. En effet, le remboursement de cette dette ne présente pas ici un caractère d’impossibilité absolue car la plupart des débiteurs possèdent d’autres biens. Le deuxième argument juridique est celui qui est basé sur le transfert de passif au nouveau
débiteur au moment de la dépossession ; M. Blondeau estime qu’il paraît logique de dire que la
dépossession, par une sorte de loi de police autoritaire, semble effectivement emporter transfert
de l’actif et du passif. Mais peut-on invoquer contre un cocontractant français, en l’occurrence
une banque, des lois étrangères ? C’est ce qu’a décidé la Chambre commerciale de la Cour de
cassation 49. Pourtant il s’agit d’une question de droit international privé et c’est sur cette base qu’il faut la
résoudre. Si le contrat a bien été conclu en Algérie par deux personnes vivant en Algérie, la loi
applicable est la loi algérienne. Ses modifications sont extérieures au contrat qu’il ait été conclu
avant l’indépendance ou après. Ces lois algériennes, il les range en deux groupes. Le premier
décide de dépossession sans aucune indemnité et le second parle de nationalisations avec
indemnisation. L’auteur des conclusions analyse ensuite dans le détail les textes algériens pour savoir si, à la
lumière des accords d’Evian, on peut penser que le législateur algérien avait l’intention
d’indemniser. Sur les biens vacants, il semble que l’État algérien n’ait pas eu l’intention
d’indemniser ni de se charger du passif, sur les domaines agricoles qu’il s’est appropriés, le
texte, très laconique, ne prévoit aucun transfert de passif. En revanche, dans les textes décidant
des nationalisations il faut s’assurer avec certitude qu’il y a bien un nouveau débiteur que le
créancier peut poursuivre. Or aucune mesure visant à fixer le passif et l’indemnité n’a été prise
par le gouvernement algérien. On ne connait pas la position des juges algériens et M. Blondeau
suggère que les débiteurs « victimes » des nationalisations fassent une action devant les juges
algériens pour obtenir transfert de passif et indemnisation. Quel est le contenu des décisions ? Elles sont toutes favorables au créancier : le débiteur doit payer. Elles approuvent les arrêts de Cours d’appel condamnant le débiteur au paiement et elles cassent ceux qui avaient donné raison au débiteur. Ces arrêts se caractérisent par le laconisme de leurs motivations. Ainsi, alors qu’une caution
refusait de payer la dette d’un débiteur dont l’entreprise de transport avait fait l’objet d’une
déclaration de vacance en vertu du décret algérien du 18 mars 1963, la Cour 50 a rejeté l’arrêt
d’Aix-en-Provence en estimant que « le contrat de compte-courant intervenu entre les parties
toutes françaises, a pris naissance avant la date de l’indépendance de l’Algérie, en territoire
français ». La Cour d’appel en a, à bon droit, déduit la volonté des parties de se soumettre à la
loi française. La Cour de cassation estime que la Cour d’appel ne « s’est référée au décret
algérien du 18 mars 1963 qu’à titre surabondant » et qu’en appliquant la loi française, le
débiteur et sa caution sont tenus au paiement. L’affaire suivante concernait également une
entreprise commerciale qui avait été déclarée bien vacant, elle a donné lieu à deux décisions. La
première 51 pose l’argument « massue » de la Cour de cassation qui sera repris par la suite par les
juridictions ayant eu à connaître de ce type de problème : « Le décret algérien (18 mars 1963)
duquel est résultée la dépossession immédiate des biens de la société X en Algérie est contraire
à l’ordre public français dont les exigences correspondent en l’occurrence aux déclarations
gouvernementales du 19 mars 1962 approuvées en France par la loi référendaire du 8 avril 1962 et en Algérie par le scrutin d’auto-détermination du 1er juillet 1962, lesquelles prévoient que nul
ne peut être privé de ses droits de propriété sans une indemnité équitable préalablement fixée :
d’où il suit que la Cour d’appel 52 ayant énoncé que pareille mesure ne pouvait avoir pour effet
d’éteindre la dette du propriétaire de ces biens ni d’interdire les poursuites sur les autres biens
dont il dispose notamment en France, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié en droit ». La Haute juridiction va aller beaucoup plus loin 59. En effet, jusque-là on est en présence de lois
algériennes qui dépossèdent les anciens colons sans aucune indemnisation ni transferts de
passif, mais les textes postérieurs qui « nationalisent » des entreprises françaises, prévoient le
transfert du passif et posent le principe d’une indemnisation. La semoulerie appartenant aux
frères Narbonne a été nationalisée par le décret du 22 mai 1964. Un des dirigeants, poursuivi en
paiement, opposait au créancier le fait que le passif avait été transféré aux nouveaux
propriétaires, transfert expressément prévu par la loi. La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence 60 qui avait considéré la dette comme éteinte pour le dirigeant. L’analyse de toutes ces décisions démontre que la Cour de cassation a pris une position de
principe : débiteurs et créanciers étant tous les deux Français, elle a décidé de favoriser les
créanciers. Si, pour tout ce qui concerne la confiscation de biens vacants et la spoliation des
domaines agricoles, on peut suivre le raisonnement juridique de la Cour car, effectivement, les
textes algériens sont contraires aux accords d’Évian qui prévoyaient l’obligation d’indemniser
en cas de dépossession, on comprend beaucoup moins la position de la Cour de cassation quand
il s’agit de « nationalisations » d’entreprises car la loi algérienne prévoit transfert du passif, et
une indemnisation, le texte étant alors conforme aux engagements de 1962 du nouvel État
indépendant. Alors on s’interroge. Pourquoi cette intransigeance ? Est-ce pour que tout le
monde soit traité à la même enseigne, particuliers, agriculteurs et chefs d’entreprise ? Ce n’est
pas convaincant. Est-ce pour mettre fin à une jurisprudence anarchique qui d’un point à l’autre
du pays rendait des décisions contraires ? C’est certain mais, à notre avis, ce n’est pas la raison
essentielle. Les arrêts postérieurs vont s’en tenir à cette ligne avec constance 62. Il y a une
nouvelle rafale d’arrêts le 6 octobre 2009 qui vient asseoir la jurisprudence de la Cour 63 et
encore le 17 novembre 1969 64. Dans ces affaires, c’est le caractère contraire à l’ordre public
français qui constitue la motivation principale. Cette solution, mise au point en avril 1969 est
toujours en vigueur en 1970 65. Puisque les pourvois soumis à la Cour, portaient sur l’existence
ou non de la dette, la Cour applique le principe de contrariété à l’ordre public ; cependant, à
partir de novembre 1969, la suspension de l’exécution est de plein droit.
Il faut se reporter aux conclusions de l’avocat général. Il dit, dans son préambule « Si des condamnations à payer devaient être exécutées, il en résulterait, certes, des dommages ; mais il me paraît inévitable que ces dommages seront tôt ou tard réparés par l’effet de la solidarité nationale, déjà annoncée par la loi du 26 décembre 1961 ». Que disait cette loi dans son article 4 ? « Une loi distincte fixera, en fonction des circonstances,
le montant et les modalités d’une indemnisation en cas de spoliation et de perte définitivement
établies des biens appartenant aux personnes visées au premier alinéa de l’article 1er 66 et au premier alinéa de l’article 3 67 ». Or en avril 1969, aucune loi n’a été votée et aucune ébauche ou
proposition de loi n’est en chantier. Peut-on alors penser que la Cour de cassation, excédée que
l’on laisse aux juges la gestion d’une décolonisation décidée au plus haut sommet de l’État, a
pris des décisions « politiques », des décisions tellement radicales, notamment pour ce qui est
des nationalisations, qu’elles ne peuvent laisser indifférent. Force est de constater que ce coup
d’éclat de la Haute juridiction, volontaire ou involontaire, (nous penchons vers une décision
délibérée) a eu l’effet escompté. Il y a donc, enfin, une réponse législative au problème. Mais avant de l’examiner il faut s’interroger sur l’efficacité limitée de la loi du 11 décembre 1963 complétée par celle du 6 juillet 1966, qui permettait d’accorder de larges délais de paiement. II. Des réponses législatives Les juges ont eu la lourde tâche de résoudre des questions que l’État laissait délibérément en
suspens. Plusieurs facteurs font que la situation s’éclaircit en 1969 : le coup d’arrêt de la Cour
de cassation en avril 1969, les revendications de plus en plus virulentes des associations de
rapatriés et l’arrivée à la présidence de la République de Georges Pompidou qui avait fait des
promesses aux rapatriés lors de la campagne électorale. De Gaulle artisan de l’indépendance de
l’Algérie, et qui avait fait savoir qu’il était réticent à l’indemnisation 68, est parti. On a
confirmation de cela dans le rapport fait devant l’Assemblée Nationale lors du vote de la loi de
novembre 1969 où le rapporteur rend hommage à ses prédécesseurs en ces termes : « la tâche du
rapporteur de l’époque était beaucoup plus malaisée que la mienne, M. Limouzy devait, en effet,
travailler au sein de la commission des lois dans des conditions fort difficiles, car les différents
projets envisagés se heurtaient à des dispositions en vigueur et à une position du Gouvernement
qui – il faut le reconnaître – n’était pas celle d’aujourd’hui ». Les pieds-noirs représentent un
enjeu électoral et la situation n’est plus possible. Aussi une loi « à titre provisoire » vient contrer
les effets de la jurisprudence de la Cour de cassation en novembre 1969 et quelques mois après
une loi, très étayée, règle, entre autres, la question des dettes des personnes dépossédées (B).
Cependant, dès 1963, en décembre, devant les dépossessions opérées par l’État algérien, une loi,
très brève, prenait des mesures de « protection juridique » en faveur des Français rapatriés (A).
A. Les lois accordant des délais de paiement Dès décembre 1963 (le 11), François Missofe, ministre des Rapatriés fait voter par l’Assemblée
et le Sénat, une loi « instituant des mesures de protection juridique en faveur des Français
rapatriés ». Cette loi d’urgence se compose de huit articles seulement. Elle est très incomplète,
on le verra et semble être faite dans l’urgence. Elle ne concerne que les personnes physiques et renvoie aux articles : 1 et 3 de la loi du 26 décembre 1961 69 qui donnait la qualification de
rapatrié. Elle est tout à fait spécifique au problème qui nous préoccupe car elle est applicable
« aux dettes qu’elles (les personnes rapatriées) ont contractées ou qui sont nées à leur égard,
antérieurement à leur rapatriement et à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ». Elle
institue une possibilité de dérogation à l’article 1244 du Code civil en permettant d’octroyer des
délais de paiement ne dépassant pas deux ans, de surseoir à exécution des poursuites ou d’en
organiser les modalités. Ces délais pourront être portés à trois ans, au total, après
renouvellement. Ils sont laissés à l’entière appréciation de juges qui prennent en compte la
situation financière des parties. Les autres articles détaillent les mesures que le magistrat peut
prendre. C’est seulement en 1966 70, qu’une nouvelle loi accorde aux personnes morales
spoliées, les mêmes droits qu’aux personnes physiques. Mais la loi de 1966 est aussi l’occasion
d’augmenter les délais en passant de deux à trois ans avec une possibilité de les porter jusqu’à
cinq ans.
Bizarrement, on ne trouve que très peu de jurisprudence relative à de l’application de la loi de 1963 avant les années 1970. Une explication logique réside dans le fait que, jusqu’à ce que la Cour de cassation tranche, les débiteurs demandent que leur dette soit considérée comme éteinte, ils ne peuvent dans le même temps solliciter des délais de paiement, puisque ce serait reconnaître qu’ils sont encore susceptibles de payer. D’autre part, il faut attendre 1966 pour que les délais soient également accordés aux personnes morales. Or de nombreux litiges les concernent. Enfin, mais cela semble une explication peu probable, les délais auraient été accordés facilement et donc les litiges seraient restés au niveau de la première instance. Cependant quelques décisions permettent dès 1965 de se faire une idée sur la manière dont les
juges apprécient les conditions d’application de cette loi, puisqu’elle leur laisse l’opportunité
d’octrpyer un délai de paiement. Par un arrêt du 19 mai 1965, la Cour d’appel d’Aix-en-
Provence 71, accorde les plus larges délais au débiteur « compte tenu de la situation
particulièrement difficile où se trouvent actuellement ceux-ci (ils ont perdu des domaines
agricoles et industriels) par suite des pertes considérables subies par eux en Algérie ».
L’existence de la loi de 1963 met fin à la possibilité de surseoir à statuer. On retrouve dans
plusieurs textes cette affirmation : s’il était permis de surseoir à statuer jusqu’à la mise en place
de la loi sur l’indemnisation, le texte de 1963 l’aurait prévu, or il ne laisse que la possibilité de
donner des délais 72. Dans l’autre décision de la même Cour 73, les juges, après avoir expliqué
pour cette raison évoquée plus haut, l’impossibilité de surseoir à statuer, estiment que, le
débiteur ayant déjà bénéficié d’un délai de deux ans octroyé par le premier juge, il n’y a pas lieu
de le prolonger. La Cour d’appel de Grenoble 74 s’appuie sur la loi de 1963 pour étaler le
paiement de la dette en 20 mensualités. Il s’agissait du paiement de marchandises envoyées de
France à un commerçant de Mostaganem. Le commerçant affirmait avoir été pillé et avoir pu
quitter l’Algérie avec une partie des marchandises livrées qu’il offrait de restituer. La
marchandise est chiffrée et le débiteur condamné au paiement. Le juge d’instance ayant accordé
des délais, les magistrats de la Cour d’appel de Grenoble, s’ils refusent de nouveaux délais,
fixent des mensualités au motif que « le condamner à payer dans l’immédiat une somme
relativement importante serait de nature à compromettre sa reconversion en métropole ». Le tribunal de commerce de Nantes suit la même logique en étalant la dette sur plusieurs
mensualités 75.
Une décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation 76 estime qu’une fille qui s’était
portée caution pour son père, commerçant à Oran et qui a été dépossédé, « placée dans une
situation digne d’intérêt à la suite d’événements indépendants de sa volonté, est fondée à obtenir
les plus grandes facilités à la fois pour se libérer d’obligations contractées dans les circonstances
rappelées et pour lui permettre d’assurer les conditions d’une vie nouvelle ». Ainsi, approuve-telle
la Cour d’appel « de lui avoir donné un délai de deux ans et d’avoir levé le nantissement qui
grevait son fonds de commerce de pharmacie ». On constate, encore une fois que dans ses rares
décisions la Chambre commerciale est assez favorable au débiteur.
Par une série d’arrêts, la première Chambre de la Cour de cassation tranche cette question des
délais en avril 1970. Cela illustre parfaitement le décalage entre la jurisprudence et la loi. En
effet, en décembre 1969, une loi a affirmé la suspension des poursuites à l’encontre des « dettes
algériennes », mais elle n’a pas abrogé la loi de 1963, or, en raison de la durée de la procédure,
la Cour de cassation tranche des pourvois portant sur la difficulté d’application de la loi de 1963
accordant quelques délais aux même débiteurs.
La Cour de cassation 77 approuve la Cour d’appel d’Aix-en-Provence 78 d’avoir accordé un délai
de deux ans au débiteur et d’avoir estimé que, contrairement à ce qu’il plaidait, sa dette n’était
pas éteinte par transfert de passif aux autorités algériennes. La décision suivante, à la même
date 79, est fondée sur la loi de 1966 80. Elle pose les limites de la liberté laissée au juge quant à
l’opportunité d’accorder des délais. En l’espèce, les magistrats de la Cour d’appel ont estimé
que les débiteurs ne rapportaient pas la preuve que les billets à ordre litigieux avaient été
contractés en vue de la conservation ou de l’amélioration du bien dont ils ont été dépossédés en
Algérie. La Cour de cassation estime que la Cour d’appel a fait une fausse application de la loi.
En effet la loi exige que le demandeur ait été dépossédé de ses biens mais elle ne demande pas
de prouver que la dette pour laquelle ils sont poursuivis a été contractée directement pour ce
bien.
La Cour de cassation saisie d’une affaire dans laquelle la Cour d’appel a refusé d’accorder tout
délai de paiement pour des lettres de change échues en 1960 et 1961 a approuvé la solution
donnée par la Cour d’appel au motif que « le juge du fond apprécie souverainement
l’opportunité d’accorder un délai de grâce, et, le cas échéant, la durée de ce délai, dans les
limites fixées par la loi ». Ainsi, c’est à bon droit que des délais ne sont pas accordés quand le
débiteur est dans une situation florissante 85. Il s’agissait ici d’une vente de parcelles de terres
entre particuliers. Ces terrains ont été déclarés biens de l’État algérien en 1963 et le vendeur
impayé, poursuivait la vente sur saisie-immobilière de deux appartements à Nice, propriétés de
l’acheteur. La Cour d’appel a autorisé la libération en deux versements et n’a pas accordé de
délais car la situation financière du débiteur était nettement supérieure à celle du créancier.
Pour bénéficier de cette loi, il faut avoir été victime de dépossession. S’est alors posé le
problème à propos d’une personne qui avait vendu son bien en Algérie. La première Chambre
civile 86 a décidé que, comme l’atteste le notaire, le prix n’a jamais été payé au motif que l’État
algérien a considéré cette vente comme illégale et s’est approprié tous les biens objets de la
vente. En revanche, le juge n’a pas à demander qu’il soit prouvé que la dette a servi à la
conservation ou l’amélioration du bien car la loi ne l’exige pas 87.
Cette jurisprudence peut sembler vaine dans la mesure où les délais perdent de leur intérêt quand une loi plus récente est venu suspendre toute poursuite en paiement des « dettes algériennes » à l’encontre des débiteurs dépossédés, mais, en réalité, elles font avancer les définitions : le concept de dépossession, la qualification des bénéficiaires, notions importantes pour l’application des nouvelles lois qui font référence à ces notions. Jusque-là, toutefois, les mesures prises pour protéger les rapatriés étaient très timides, à un tel point que cela n’avait pas empêché la Cour de cassation de prononcer toute une série de condamnations au paiement à l’encontre des débiteurs dépossédés. C’est avec les lois de novembre 1969 et de juillet 1970 que l’État français va enfin prendre à son compte cette situation inique soit 8 ans après la déclaration d’indépendance de l’Algérie. B. La suspension légale des poursuites jusqu’à indemnisation Le 6 novembre 1969 88 l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté une loi qui décide dans son
article 1er « à titre provisoire et jusqu’à l’entrée en vigueur de mesures législatives
d’indemnisation » que les personnes qui ont contracté des obligations pour des biens dont elles
ont été dépossédées sans avoir été indemnisées « ne peuvent être poursuivies à raison de ces
obligations sur les biens qu’elles possèdent dans les départements français.» Dans son article 2
elle suspend « l’exécution des obligations financières contractées auprès des organismes de
crédit ayant passé des conventions avec l’État ». Donc pour résumer, toute poursuite en
paiement contre un rapatrié soit pour des dettes contractées en Algérie, soit pour des dettes
contractées en France pour leur réinstallation est gelée. Le rapporteur de cette loi, Bernard Marie 89 affirme « qu’il s’agissait d’un texte imparfait, jugé par certains juridiquement
indéfendable et qualifié par d’autres, particulièrement sévères, de monstruosité juridique, Mais
n’est-ce pas là le sort de tous les textes transitoires qui essaient d’apporter des palliatifs à des
situations très exceptionnelles et qui recherchent plus d’équité que des solutions rationnelles ».
C’est tout de même étonnant d’entendre ces mots dans la bouche du rapporteur de la loi. Donc
le principe est le suivant : pas ou plus de poursuite, de sûretés et de voie d’exécution. Cependant
l’article 7 de la loi prévoit que le juge, peut, à titre exceptionnel y déroger en considération des
facultés de paiement du débiteur et de la situation économique du créancier. Le Garde des
sceaux confirme lors du débat parlementaire 90 précédant le vote que, parmi les raisons qui ont
poussé le gouvernement à proposer ce texte, il y a la position de la Cour de cassation. « Depuis
que, en application d’un des principes fondamentaux de notre droit privé, celui de l’unité de
patrimoine, la Cour de cassation a été amenée, par une exacte application de l’article 2092 du
code civil, à admettre que les poursuites étaient possibles en pareil cas (dette sur des biens dont
les rapatriés ont été dépossédés), les textes antérieurs devenaient insuffisants et le législateur se
devait d’intervenir pour éviter que cette exacte application du droit n’aboutisse à une situation
dont tout le monde aurait ressenti le caractère socialement, moralement et humainement
choquant » 91. Cette référence aux sentiments et à l’équité de la part du législateur est assez rare
pour qu’on la remarque.
L’ampleur et la durée des débats parlementaires illustrent le caractère éminemment sensible de
la question du paiement des dettes par les rapatriés, victimes de l’État algérien qui les a
dépossédés et contraints au retour 92.
On n’a que peu de jurisprudence sur l’application de la loi de novembre 1969 pour une raison
très objective : provisoire par essence, elle a été remplacée par la loi de juillet 1970. La première
décision de la Cour de cassation de janvier 1972 93 refuse d’appliquer la suspension des
poursuites à une dette née en Algérie. En l’espèce, un fonds de commerce avait été vendu pour
un prix payable en trois billets à ordre. Le vendeur a assigné en paiement l’acheteur pour deux
billets à ordre restés impayés. L’acheteur oppose que son commerce aurait été déclaré bien
vacant et confisqué par l’État algérien. Or aucune preuve de dépossession n’est rapportée et de
plus il est fait remarquer que, concomitamment à la fermeture du fonds, un autre commerce à
l’activité similaire a été créé sous la forme d’une SARL dont l’acheteur détient la presque
totalité des parts. Il est démontré que le départ a été volontaire et que les biens ont été transférés
d’un fonds à l’autre. La décision suivante précise bien que l’on ne peut, a posteriori, reprocher
de n’avoir pas appliqué une loi inexistante. En l’espèce, la Cour d’appel, en 1962, ne pouvait
pas appliquer la loi de 1969 et suspendre l’application d’une clause pénale 94. Mais il arrive
également à la Cour d’appel de déduire la dépossession même s’il n’y a pas de preuve
formelle 95. En l’occurrence, il s’agissait d’une dette contractée pour l’achat de vaches dans un
domaine agricole. La Cour d’appel constate avec raison que la loi algérienne du 1er octobre 1963
ayant dévolu à l’État algérien, sans indemnité pour leurs anciens propriétaires, toutes les
propriétés agricoles, le débiteur pouvait donc bénéficier de la loi de 1969.
La loi du 15 juillet 1970 96 a un contenu beaucoup plus large. Elle n’indemnise pas les rapatriés,
elle contribue à leur indemnisation, la nuance est d’importance. Il est fait référence à l’article 4
de la loi du 26 décembre 1961 qui posait le principe d’une indemnisation. Il est bien précisé, dès
le préambule, que « cette contribution a le caractère d’une avance sur les créances détenues à
l’encontre des États étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession ». Même si le sujet de
l’indemnisation fait l’objet d’une étude approfondie, dans cet ouvrage, il faut relever
l’hypocrisie majeure de ces propos car tout le monde sait et cela depuis 1963, que l’État algérien
puisqu’il s’agit principalement de lui, ne remboursera jamais et n’a jamais eu l’intention
d’indemniser les victimes de dépossession contrairement à ce qui était fort naïvement annoncé
dans les accords d’Évian. Cette loi qui comprend de nombreux titres et chapitres ne nous
intéresse ici que pour son titre IV : « Des créances sur les rapatriés et les personnes dépossédées
de leurs biens Outre-mer », qui a pour vocation de régler le problème des « dettes algériennes ».
On reprend le principe de la suspension des poursuites sur des biens du débiteur situés en France
et dans les territoires restés français mais il est précisé dans quelles conditions le créancier, qui
conserve tous ses droits, pourra obtenir paiement sur le montant des indemnités versées par
l’État français. Le créancier doit déclarer sa créance à l’agence nationale pour l’indemnisation.
Les droits des créanciers sont réduits dans la même proportion ou a été réduite l’indemnisation
(un coefficient est appliqué par tranche de valeur des biens) 97. De plus l’opposition au paiement
ne pourra être exercée que sur la somme qui restera disponible après que l’État se sera
remboursé de toutes les aides à la réinstallation accordées 98. De nombreux articles du texte
donnent des détails de technique juridique selon les cas de figure qui sont assez variés mais tous
limitent grandement le droit des créanciers à se payer sur les sommes allouées à titre
d’indemnité. Cette partie du texte, consacrée « aux dettes algériennes » va donner lieu à un
contentieux intéressant. En effet, tant qu’aucun texte n’avait décidé de l’indemnisation les
rapatriés pouvaient reprocher à l’État son inertie mais ils pouvaient aussi espérer être
indemnisés à hauteur des biens réellement perdus 99. Cette loi est assez réductrice, elle ne
consent qu’une certaine solidarité en s’abritant derrière le non-respect des engagements pris par
le nouvel État algérien et va en décevoir plus d’un. De plus, une fois l’État remboursé des frais
de réinstallation, une fois les créanciers payés, on peut penser qu’il ne reste pas grand-chose à
certains rapatriés.
Les juges affirment d’abord que le sursis à exécution de la condamnation à paiement s’applique
de plein droit. Ainsi, une Cour d’appel peut condamner un débiteur rapatrié à payer, sans
mentionner l’application de l’article 49 de la loi du 15 juillet 1970, car, étant donné que le
créancier ne demande pas à bénéficier de la dérogation prévue par l’article 55 de la même loi,
elle n’était pas tenue de préciser « ce qui allait de soi que cette condamnation ne pouvait, en
l’état, être exécutée sur les biens des débiteurs situés en France 100 ». Une décision de 1973 101
confirme cette position : « L’interdiction édictée par l’article 49 (de la loi du 15 juillet 1970) de
poursuivre l’exécution de la condamnation sur les biens que le débiteur possède en France ne
met nullement obstacle à la recevabilité de l’action du créancier en tant qu’elle tend à la
reconnaissance judiciaire de l’obligation du débiteur». Elle applique également cette nouvelle loi pour justifier de la nullité ou de la mainlevée de
toutes les mesures conservatoires. À un créancier qui plaidait qu’il n’y avait pas lieu d’annuler
les sûretés conservatoires, la créance étant seulement gelée, la Cour répond 103 que, hormis les
cas dérogatoires prévus par l’article 55 (voir infra), la loi de 1970 interdit toute poursuite sur les
biens situés en France, quelle que soit la nature de la sûreté. En effet la loi permet seulement au
créancier de « dettes algériennes » d’être payé sur les sommes obtenues par le biais de
l’indemnisation. Elle ordonne la radiation d’une hypothèque provisoire prise par la banque
créancière sur les biens possédés en France par le débiteur. Elle approuve une Cour d’appel
d’avoir ordonné la mainlevée d’une saisie-arrêt 104 car « la saisie-arrêt rendant indisponible le
bien du rapatrié et aboutissant normalement à une exécution forcée constitue, au sens où
l’entendent la loi du 6 novembre 1969 et l’article 49 de la loi du 15 juillet 1970, une procédure
d’exécution interdite à l’égard d’un tel débiteur ». Il en va de même pour une saisie-exécution 105
car la loi du 15 juillet 1970 qui a abrogé l’article 1er de la loi du 6 novembre 1969 en a maintenu
l’article 5 avec lequel elle doit se combiner.
Cette loi est très complète, elle envisage, dans son article 54 le cas des ventes immobilières avec
rente viagère et le sort de ces rentes quand l’acheteur a été dépossédé. La Cour de cassation 106
s’appuie sur ce texte pour refuser une annulation de la vente fondée sur le défaut de paiement de
la rente car « ce texte, en disposant que le crédirentier ne peut réclamer au débirentier que le
paiement d’un capital, a nécessairement mis obstacle au jeu de la clause résolutoire sanctionnant
le défaut de règlement de la rente viagère ». Ici, en effet, l’acheteur aurait eu tout intérêt à faire
annuler la vente puisque l’immeuble a été confisqué.
On se rend compte que, même si la loi est très complète, même si à peu près tous les cas ont été envisagés, on a besoin du juge pour dire comment elle s’applique. Tel est le cas dès qu’il s’agit de savoir si le débiteur remplit les conditions pour bénéficier de la suspension des poursuites, et, notamment pour déterminer s’il a bien été dépossédé de sa propriété située en Algérie. La dépossession d’un bien dont le rapatrié était propriétaire en Algérie est un élément essentiel
et indispensable pour bénéficier du gel des « dettes algériennes » et de leur paiement limité au
montant de l’indemnisation. Ainsi, la Cour de cassation exige-t-elle qu’il soit démontré que le
débiteur a bien fait l’objet d’une dépossession 107. De la même manière, la Cour de cassation 108
affirme que « si en principe, pour apprécier si une obligation est, au sens de l’article 49 de la loi
du 15 juillet 1970, afférente à l’acquisition, la conservation, l’amélioration ou l’exploitation d’un bien dont le débiteur a été dépossédé, il faut s’attacher moins à la cause réelle du contrat,
qu’à l’utilisation effective des fonds prêtés, il en va différemment lorsque le débiteur a, pour
obtenir un crédit de son créancier, usé d’une fraude envers celui-ci ». En l’occurrence, la banque
n’a accordé des crédits qu’au vu des bilans de la succursale française sans savoir qu’ils étaient
employés pour la succursale d’Oran dont le débiteur a été dépossédé. Mais la loi a prévu, dans son article 55 que, « par dérogation… le créancier peut obtenir du juge
l’autorisation de poursuivre son débiteur en exécution de son obligation ». Le législateur laisse
le soin au juge de dire s’il y a lieu de faire des exceptions à la suspension des poursuites. C’est
tout à fait logique que ce soit dans ces cas là qu’il y a contestation et que le contentieux est le
plus important. En effet, dès la loi de 1969, son rapporteur devant l’Assemblée
nationale 112reconnaissait que ce principe de suspension de l’exécution, contenait « dans sa
générosité, des éléments d’injustice. C’est le cas du moratoire accordé à des personnes qui n’en
ont pas réellement besoin ». Le texte de loi semble reposer sur un postulat : les débiteurs sont
des victimes et les créanciers sont des banques qui ne seraient pas dans le besoin. Mais le
créancier peut être un particulier, lui-même rapatrié. La loi du 15 juillet 1970 prend en compte
la possibilité que le créancier soit en difficulté alors que le débiteur a tout à fait les moyens de
payer. La loi prévoit quatre cas dans lesquels il est possible pour le juge d’autoriser les
poursuites: 1° si les fonds prêtés ont été transférés et sont restés à la disposition du débiteur, 2°
si le débiteur n’a pas été dépossédé, 3° si le prêt a été garanti, au départ par des possessions
détenues en France ou dans un autre pays, 4° s’il est établi que la situation du créancier est
difficile et digne d’intérêt et que le débiteur est en état de faire face, en tout ou partie à ses
engagements. C’est sur cette base que plusieurs créanciers vont demander au juge de bénéficier
de cette dérogation.
Il n’y a pas une jurisprudence abondante mais tout de même certains créanciers ont profité de la brèche ouverte par l’article 55 pour obtenir paiement de leur créance. Même si la Cour d’appel a une appréciation souveraine des faits, la Cour de cassation demande
que le juge motive sa décision 113. Ainsi la formule « la situation en l’espèce est en réalité, à ce
jour, celle que prévoit l’article 49 de la loi du 15 juillet 1970, lequel met obstacle à l’exécution
du débiteur sur les biens que celui-ci possède en France » est jugée insuffisante dès lors que le
créancier plaide la dérogation de l’article 55. L’arrêt est donc cassé pour défaut de base légale.
Deux affaires ont pour fondement l’article 55-1. La première concerne les propriétaires d’une
minoterie située en Algérie 114 et qui a fait l’objet d’une nationalisation. Mais les juges constatent que « des crédits de campagne destinés à faire face aux frais engagés pour l’exploitation de la
société en Algérie entre juin 1962 et janvier 1963 pour une somme de 600 000 francs ont été
transférés en France pour au moins 440 000 francs, et ont été utilisés à des fins autres que la
conservation de leur bien en Algérie ». C’est donc à bon droit qu’ils ont autorisé la banque
créancière à poursuivre l’exécution de la condamnation au paiement du solde du comptecourant.
Dans l’affaire suivante, 115 il est également démontré qu’une partie des fonds a été
transférée et la Cour d’appel autorise les poursuites à concurrence du montant des fonds
transférés. Et il est laissé à son appréciation souveraine de décider comment un compte-courant
a fonctionné et que sont devenues les sommes avancées.
La dérogation demandée sur le fondement de l’article 55-2 de la loi du 15 juillet 1970 concerne
des parties marocaines 116. Le débiteur avait obtenu d’une banque marocaine diverses avances de
trésorerie garanties par le nantissement de valeurs mobilières possédées en France, pour
l’exploitation d’un domaine agricole dont il a été dépossédé. On a très peu d’explication mais la
Cour de cassation reconnaît à la cour d’appel le pouvoir souverain d’apprécier les faits et de
décider qu’elle n’accorde pas la dérogation à la banque marocaine.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Toulouse qui a refusé de suspendre les
poursuites en se fondant sur l’article 55 alinéa 3 car la banque créancière n’avait accepté de
maintenir ouvert le compte courant de la société située en Algérie que parce qu’une personne
s’était portée caution en France et avait déposé une garantie de 50000 francs à l’agence de
Toulouse. Il s’agissait bien du cas où le crédit n’a été donné que grâce une garantie
métropolitaine. Toujours en invoquant l’article 55-3, une société et sa caution sont condamnées
à payer le solde d’un compte courant 117. En l’espèce l’emprunt était bien postérieur à
l’indépendance et la société avait transféré progressivement son patrimoine en France. « La cour
d’appel a déduit implicitement mais nécessairement des circonstances par elle souverainement
appréciées, que les avances de la BNCIA avait été consenties du commun accord des parties,
principalement en considération du patrimoine ou de biens en France et à l’étranger 118 ».
Les litiges précédents reposent sur des faits que l’on peut démontrer alors que l’alinéa 4 de
l’article 55 fait appel à une appréciation subjective même si elle s’appuie sur des données
financières 119. La première affaire, en 1973, oppose deux particuliers 120. Une dame avait prêté à
une autre la somme de 80 000 francs en 1959, avec garantie hypothécaire sur un immeuble sis à
Oran. La créancière a demandé le remboursement du prêt en France et la Cour d’appel le lui a
accordé en condamnant la débitrice à verser mensuellement sept cent francs. Elle a validé le
nantissement pris sur son fonds de commerce en France. La décision est contestée au motif que
la débitrice devrait bénéficier de la suspension des poursuites de la loi de 1970. La décision de
première instance s’était fondée sur l’article 7 de la loi de novembre 1969 qui permettait de
déroger à la suspension des poursuites. L’arrêt déféré s’est appuyé sur la loi de 1970 et a décidé
que la situation de la créancière était difficile et digne d’intérêt et que la débitrice était en état de
faire face à sa dette.
C’est sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article 55 également que la Cour d’appel de Toulouse, approuvée par la Haute juridiction, accorde la dérogation au créancier aux motifs que sa situation est difficile et « qu’il résulte une différence de ressources sensible au profit du débiteur qui est d’ores et déjà en mesure de satisfaire partiellement ses engagements ». Il s’agissait ici d’une dette « familiale » : de l’argent avait été prêté par le beau-père pour l’entreprise du gendre. Toujours sur le même fondement, la Cour de cassation rejette le pourvoi 121 contre la Cour
d’appel de Montpellier qui avait décidé, dans son appréciation souveraine, de déroger à la
suspension des poursuites au motif que le débiteur possède en France une entreprise de transport
florissante alors que la créancier a fait l’objet de multiples saisies et ne possède que très peu
d’argent sur son compte.
Si la jurisprudence a trait essentiellement aux rapatriés d’Algérie, une affaire concerne des
rapatriés du protectorat marocain, une affaire qui illustre bien les errements juridiques qui
entourent ces litiges. Il faut préciser qu’un décret d’application du 21 avril 1971 122 prévoit les
modalités d’indemnisation pour les rapatriés marocains dépossédés. Ce décret a fait l’objet d’un
recours devant le Conseil d’État au motif qu’il méconnaitrait le principe général d’égalité des
citoyens devant la loi car les modalités d’indemnisation sont différentes de celles retenues pour
l’Algérie. Ce recours sera rejeté car « le gouvernement pouvait, pour tenir compte des
conditions économiques et sociales prévalant dans ces différents territoires, adopter des critères
d’évaluation des biens différents pour chacun d’eux. 123 ». Cette affaire de 1973 124 a été jugée par
la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en 1968 (c’est-à-dire avant les lois de 1969 et de 1970),
pourtant aucune de ces lois n’est évoquée devant la Haute juridiction. L’affaire qui est plaidée
devant la première Chambre civile repose sur l’article 2292 du Code civil : le principe de
l’unicité de patrimoine. L’ambassadeur de France au Maroc avait accordé un prêt de 30 millions
de francs marocains à des agriculteurs à Beni Madane en 1960 pour l’amélioration d’une
propriété qu’ils possédaient depuis 1932. Par le dahir du 26 septembre 1963, la propriété
agricole a fait l’objet d’une décision de « récupération des terres de colonisation officielle ».
Une indemnité de 90 175 francs marocains a été allouée aux propriétaires, soit un huitième de la
valeur réelle. Pour avoir paiement du solde de la créance de l’État, le Trésor public a poursuivi
les propriétaires. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a décidé que la créance de l’État devait
être réduite dans les mêmes proportions, soit un huitième de son montant. La motivation : « le
patrimoine des consorts X n’ayant pas été intégralement « nationalisé», une véritable séparation
s’était opérée dans ce patrimoine et avait isolé, à l’intérieur de celui-ci une entité juridique
composée de biens, droits et obligations sur lesquels porte la nationalisation » est inacceptable
pour la Cour de cassation qui précise bien « en l’état de la législation en vigueur à l’époque ».
Bien sûr, on ne peut, en principe, revenir sur l’unicité de patrimoine, et pourtant, c’est bien ce
que va faire la loi de 1970 et décidant que les créanciers ne pourront être payés que sur les
sommes allouées comme indemnités pour la dépossession des biens détenus dans nos colonies
et encore dans les proportions où le propriétaire a été indemnisé (puisqu’il ne s’agit pas d’une
indemnisation intégrale). Conclusion Rarement, dans la jurisprudence a-t-on trouvé de tels exemples de la place majeure occupée par
des juges et du jeu de rôle établi entre le législateur et les magistrats. Du juge de première
instance qui met en avant l’équité et la justice pour exonérer le débiteur, à la Cour de cassation
qui applique le droit, et seulement le droit, pour provoquer le législateur, toutes les nuances et
l’inventivité des juristes se trouvent réunies en vue de résoudre un problème inédit.
Martine Fabre (UMR 5815 Dynamiques du droit) Article à paraître en 2013 dans le volume 9 du Juge et l'Outre-mer. Justice et décolonisation de 1940 à nos jours : Le Juge et les rapatriés http://www.histoiredroitcolonies.fr/IMG/pdf/DettesAlge_riennes2013JugeEtL_Outre-mer.pdf |
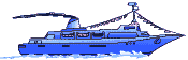 Retour au menu " Indemnisation"
Retour au menu " Indemnisation"
Mis en ligne le 02 mai 2015