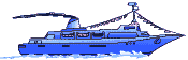Curieuse destinée pour ce peuple formé de soldats, de déportés politiques ou d'exilés de la misère.
Leur établissement sur cette terre d'Algérie fut parsemée d'embûches, de difficultés nombreuses qui coutèrent la vie à nombre d'entre eux. Au commencement était Boufarik
Une solution coloniale
Le 27 février 1848, une frégate entre dans le port d'Alger, arborant les couleurs de la République. Les gens
du port n'en croient pas leurs yeux et se chargent de répandre la nouvelle.
L'émissaire qui se présente au palais du gouverneur apporte des informations stupéfiantes. A Paris, la révolution a éclaté. Louis-Philippe est déjà en Angleterre. Un gouvernement s'est constitué à la hâte avec une majorité de socialistes. La République est bien accueillie par les Français d'Algérie. Le rêve enlisé
Ainsi commence, dans les premiers jours d'octobre 1848, quai de la Râpée, l'aventure inouïe de ces Français,
crédules parce que désespérés, qui nouent leurs baluchons pour aller peupler quarante-deux villages qui n'existent pas encore. Ainsi commence une aventure piégée. Celle de ces prolétaires qui n'ont jamais tenu une
pioche et qu'on envoie cultiver une terre dont la propriété leur sera contestée jusqu'en 1962. Ainsi s'amorce le long chemin politique de ces républicains rescapes des barricades de 1848, et que la République met au ban de
l'Histoire à l'heure de leur dépossession, en 1962. (1) la kouba ou koubba est un petit édifice élevé sur la tombe d'un personnage vénéré, ou dans un endroit où il a séjourné.
A la même époque les immigrants européens s'installaient en Amérique du Nord dans des conditions similaires.
Les "américains" ont magnifié j'usqu'à l'outrance l'oeuvre de ces nouveaux arrivants qui fondèrent les Etats Unis. Ils en firent les héros d'une nation qui extermina les autochtones à coup de winchester. Innombrables furent les productions cinématographiques, où le pionnier courageux, brave les attaques d'indiens et survit dans des conditions précaires. Chaque cinéphile à en mémoire les convois de chariots bâchés qui traversaient les plaines du Far West, les diligences attaquées par des hordes de "sauvages" et le clairon de la cavalerie salvatrice.
Mais dans notre histoire, les colons, terme péjoratif qui induit richesse et oppression, remplace le mot pionniers qui lui est paré de toute les vertus.
Pourtant la réalité de l'installation de ces "exploiteurs" est bien loin de n'être qu'une promenande de santé de nantis s'installant dans un pays de cocagne.
Il y a sans doute matière pour le cinéma français à décrire l'épopée des "colons".

Diligence en Algérie au début du peuplement européen. Les immigrants commencent a affluer. Clauzel les pousse a tenter leur chance dans le Sahel, une sorte de Far-West littoral, qui domine la plaine de la Mitidja encore interdite aux pionniers. La Mitidja est alors un bourbier, coupé de bandes de terre couvertes de broussailles, bourdonnant de malaria, hanté par les cavaliers d'une tribu redoutable et versatile, les Hadjoutes. Pour donner l'exemple aux candidats du Sahel, Clauzel crée, a deux pas d'Alger, sur les bords vaseux de l'oued Harrach, la " ferme modèle ". C'est un modèle de fiasco. L'Harrach est infesté de moustiques. Les sentinelles titubent de fièvre. Le mal n'a pas encore trouvé sa thérapeutique, la quinine. Elle ne sera expérimentée qu'en 1834, par un jeune major de Bône, Maillot. Pour l'instant, la fièvre fait des ravages. Les malheureux paysans de l'Artois appelés par Clauzel pour exploiter la ferme modèle, font demi-tour, épouvantés. Lancé dans l'action, Clauzel commettra des erreurs. Mais il aura, le premier, jeté les bases d'une colonie de peuplement.
Les immigrants commencent a affluer. Clauzel les pousse a tenter leur chance dans le Sahel, une sorte de Far-West littoral, qui domine la plaine de la Mitidja encore interdite aux pionniers. La Mitidja est alors un bourbier, coupé de bandes de terre couvertes de broussailles, bourdonnant de malaria, hanté par les cavaliers d'une tribu redoutable et versatile, les Hadjoutes. Pour donner l'exemple aux candidats du Sahel, Clauzel crée, a deux pas d'Alger, sur les bords vaseux de l'oued Harrach, la " ferme modèle ". C'est un modèle de fiasco. L'Harrach est infesté de moustiques. Les sentinelles titubent de fièvre. Le mal n'a pas encore trouvé sa thérapeutique, la quinine. Elle ne sera expérimentée qu'en 1834, par un jeune major de Bône, Maillot. Pour l'instant, la fièvre fait des ravages. Les malheureux paysans de l'Artois appelés par Clauzel pour exploiter la ferme modèle, font demi-tour, épouvantés. Lancé dans l'action, Clauzel commettra des erreurs. Mais il aura, le premier, jeté les bases d'une colonie de peuplement.
Cette période se prolongera après son départ et durera dix ans. Dix ans d'une colonisation anarchique, sauvage, libre, dix années de l'histoire des Français d'Algérie, comparables a l'épopée américaine. Tout y est laissé à l'initiative des immigrants. Une aventure tentée parallèlement par deux types d'hommes : le jeune légitimiste, las de ronger son frein dans les salons fidèles aux Bourbons, et qui s'exile en Algérie avec ses capitaux, souvent à l'appel d'un ami d'enfance, officier de l'armée d'Afrique. On l'appellera " le colon en gants jaunes ". Et puis l'autre celui qui n'a, lui, que ses bras pour tenter l'aventure, qui suit la troupe, plante son gourbi à proximité des cantonnements. C'est le " colon marécageux ". Cette geste a ses chefs de file, tel Augustin de Vialar, ses figurants, et ses Davy Crockett, comme le colon Pirette. Attaque une nuit dans sa ferme de l'Harba par trois cents cavaliers hadjoutes, Pirette leur résiste jusqu'a l'aube, sa femme à ses cotes, déchirant les cartouches. Usant de ruses, soutenu par un courage qui dans ces cas-là ressemble au refus de se faire violer, mutiler, et trancher la tête d'un revers de yatagan, le couple parvient à quitter sa ferme au petit jour, a se couler a travers le bivouac ennemi. Et alors qu'on les croit massacrés, Pirette et sa femme surgissent devant les sentinelles françaises, dépenaillés, noirs de poudre, les chaussures autour du cou. Ils entrent de plain-pied dans la légende des Français d'Algérie.
Si l'épopée a ses héros, elle a aussi sa capitale, sa cite pionnière, sa ville d'orgueil : Boufarik. Boufarik, au milieu de la plaine de la Mitidja, finalement ouverte aux colons, en 1835. Là, les arbres généalogiques ont pousse dans l'eau grise des marais, parmi les tombes de ceux que les fièvres ont emporté ou que les Hadjoutes ont massacré. On peut le dire sans exagérer : à cette époque, la plaine de la Mitidja était le coin de terre au monde contenant le plus de cadavres au kilomètre carré. Un vaste mouroir. Pour certains militaires, il n'y a rien à tirer de ce cloaque. La pestilence, les ravages de la fièvre, les raids des Hadjoutes, en font " l'arpent du diable ". L'armée s'est contentée d'y établir un relais-étape entre Alger et Blida. Une redoute qui surveille le marché arabe de Boufarik, alors un lieu-dit : trois figuiers servant de gibets, la kouba (1) d'un marabout, et un vaste terre-plein piqué de pieds d'aloès. Bientôt, une trentaine d'illuminés, qui commercent de n'importe quoi et vivent le fusil à l'épaule, " regroupent leurs chariots autour de la redoute. Ce campement loqueteux, ils le baptisent " le Bazar ". Histoire de rire, parce que l'Orient est à la mode. Tous les lundis, une foule en burnous, poussant des troupeaux, des chameaux, des mulets charges de marchandises, envahit l'aire du marche arabe, en face de la redoute et du " Bazar". Augustin de Vialar, jeune aristocrate, alors colon dans le Sahel, et que rien n'arrête, décide un beau lundi de " tenter le coup " et d'aller s'approvisionner au marche de Boufarik. Aucun Français ne s'y est encore hasardé. Les militaires le traitent de fou. Ils lui imposent une escorte de sept ou huit spahis. Quand Vialar entre dans la foule, les burnous s'écartent en silence. Il avance sous les regards empreints de ce mépris dont les Arabes ont le secret. Pour l'outrager, ils ne lui vendront qu'un chien. Vialar l'achète. C'est un acte politique. Il appelle le chien Pax, et sait que le premier pas est fait. Des lors, il offre des primes aux colons du Sahel qui acceptent de se risquer au marché de Boufarik. Il s'en trouve qui tentent l'aventure. On les ignore, mais on les tolère. Le temps, l'habitude, la gaieté de ces maraichers du Sahel qui viennent tous les lundis vers les Arabes avec leurs mules chargées de produits supérieurs aux autres, font que ces derniers finissent par les attendre. Et comme dans le Sahel, quand un homme de cœur et d'action jouera sa carte en Mitidja, d'autres suivront.
Augustin de Vialar n'en reste pas la. Puisque Boufarik a déjà son " bazar ", sa redoute, et puisque son marche est devenu un rendez-vous, il décide d'y établir une ambulance, un dispensaire pour les tribus. Son plan trouve un allié, le Dr Pouzin, premier " toubib " de la Mitidja. Mais pour cette ambulance, il faut de l'argent. Vialar
" monte " à Paris, lance une souscription, fait le siège de tous les salons parisiens favorables à l'Algérie. Il écrit à la reine, qui lui fait parvenir 1500 francs de sa cassette personnelle. L'ambulance est inaugurée. Une baraque en planches ou des draps suspendus séparent les malades étendus sur des châlits. Bientôt, Pouzin, son
interpréte, et les deux jeunes Arabes devenus ses infirmiers n'v suffisent plus. Il faut agrandir le dispensaire. Il faut former d'autres soignants. Alors, Vialar, décide d'appeler en Afrique sa sœur Emilie, fondatrice à Gaillac, leur ville natale, d'un ordre religieux : les sœurs Saint-Joseph de l'Apparition.
Frère et sœur sont de la même trempe.
Emilie et trois de ses nonnettes se mettent en route pour prêter main-forte à Pouzin. Elles débarquent à Alger en pleine épidémie de cholera. Sur le champ, elles offrent leur aide aux hôpitaux d'Alger et Mlle de Vialar
verse la totalité de sa dot, prélevée sur les fonds du couvent de Gaillac, pour lancer à Alger une caisse de solidarité.
Elle se fixera dans la Ville blanche pour y fonder un dispensaire et ne rejoindra jamais celui de Boufarik, ou chrétiens et musulmans se côtoient dans les affres du paludisme. On ne sait rien alors de cette fièvre qui ravage la plaine. Comme on n'en sait rien, on l'attribue à mille causes. Les miasmes des marais, les exhalaisons des terres vierges remuées par les pioches des colons... Le paludisme emporte des générations de pionniers. En 1841, sur les 450 habitants de la ville en chantier, 106 meurent des fièvres. Cette année-là, on devra fermer
l'église. Des trois prêtres qui s'y sont relayés aucun n'a réchappé. Il faut attendre 1847, pour qu'à Boufarik les naissances l'emportent sur les décès. Cette année-le, célébrée comme l'année de la vie, on dansa sous les premiers platanes de la ville. Car maintenant, les arbres poussent, les récoltes lèvent, les champs sont moissonnés, les marécages reculent. Une race se forme a Boufarik, une race d'hommes obstinés, taciturnes, désespérément accrochés a leurs lopins de terre, fauchant leur avoine les fusils en faisceaux. Quand ils vont au cabaret, c'est pour boire leur " consommation ", comme ils disent, du sulfate de quinine, coupé d'eau minérale tiédie.
Ces récits composent la saga des Français d'Algérie. Leur gout pour l'anisette vient sans doute de ces temps durs, héroïques, quand les femmes des pionniers filtraient une liqueur a base d'aneth, une plante des chemins, possédant, disait-on, le pouvoir de combattre les fièvres des marais. Dans certains greniers de la Mitidja, on pouvait retrouver, relégués sous une couche de poussière, les petits alambics des grands-mères apothicaires.
Il faut attendre 1880 pour que Laveran découvre enfin que cette fièvre est le paludisme, et son vecteur, la femelle de l'anophèle. L'insecte aura fait du colon de la Mitidja, un personnage légendaire, dévasté par les fièvres. Un homme tragique, au teint blême, aux yeux brulants, obstiné a vivre pour sa terre, et qui aura parfois enterré tous les siens, avant de mourir seul dans sa ferme, des lors livrée aux pillards et aux hyènes. Tous les Français d'Algérie savent ce que signifie l'expression " avoir une figure de Boufarik ".
Pourtant, bombardant les gouverneurs de suppliques à la moindre rumeur d'abandon, ces fous de la Mitidja feront de leur plaine un jardin, et de Boufarik la ville témoin de leur courage, entourée d'orangeraies, de vignobles...
 Ils y voient la possibilité de réaliser l'assimilation de l'Algérie au territoire français.
Cette révolution ouvrière s'achève dans le sang en juin 1848, et porte au pouvoir l'armée, intervenue pour rétablir l'ordre. Le général Cavaignac prend la tête de l'exécutif. Il propose à Lamoricière le portefeuille de la
Guerre, et Bedeau les Affaires étrangères. C'est la République des képis. Mais surtout, des képis de l'armée
d'Afrique. Aux problèmes sociaux de la France, ils apportent une solution coloniale. Il faut expédier en Algérie
les hordes de chômeurs qui hantent la capitale depuis la fermeture de ces chantiers de travail artificiels qu'on a
appelés les ateliers nationaux. Il faut épargner de nouveaux troubles au pays. En conseil des ministres, Lamoricière soulève alors une question cruciale : " Les "colons" seront-ils assez nombreux, pour équilibrer a temps trois millions d'Arabes ? De votre réponse, messieurs, dépend le destin de l'Algerie ! "
Ils y voient la possibilité de réaliser l'assimilation de l'Algérie au territoire français.
Cette révolution ouvrière s'achève dans le sang en juin 1848, et porte au pouvoir l'armée, intervenue pour rétablir l'ordre. Le général Cavaignac prend la tête de l'exécutif. Il propose à Lamoricière le portefeuille de la
Guerre, et Bedeau les Affaires étrangères. C'est la République des képis. Mais surtout, des képis de l'armée
d'Afrique. Aux problèmes sociaux de la France, ils apportent une solution coloniale. Il faut expédier en Algérie
les hordes de chômeurs qui hantent la capitale depuis la fermeture de ces chantiers de travail artificiels qu'on a
appelés les ateliers nationaux. Il faut épargner de nouveaux troubles au pays. En conseil des ministres, Lamoricière soulève alors une question cruciale : " Les "colons" seront-ils assez nombreux, pour équilibrer a temps trois millions d'Arabes ? De votre réponse, messieurs, dépend le destin de l'Algerie ! "
On s'empresse de lui répondre : " C'est une question de moyens. Nous vous les donnerons ! " Pour conforter ceux qui hésitent à quitter l'hexagone, l'Algérie est déclarée partie intégrante du territoire français. Elle est divisée en trois départements administrés par des préfets. Le suffrage universel est institué, les colons pourront élire quatre députes à la Constituante et trois à la Législative. Bugeaud, auquel on avait refuse un crédit de 3 millions pour ses villages militaires, lit avec amertume dans le journal officiel que le gouvernement Cavaignac vient de faire voter 50 millions par an, reconductibles sur quatre années, pour permettre à Lamoricière de fonder en Algérie quarante-deux colonies de peuplement. Ces quarante-deux villages doivent naitre entre Oran et Constantine à proximité des points d'eau et des voies de communication.
Lamoricière mène l'affaire tambour battant, a sa manière, large dans les conceptions et pointilleuse dans les détails. Le 27 septembre, il signe l'arrêté sur les colonies agricoles. Il décide que les premiers départs de " colons " auront lieu onze jours plus tard, le 8 octobre 1848. Entre-temps, le 30 septembre, il écrit au général
Charron, le nouveau gouverneur de l'Algérie, une lettre circulaire destinée aux commandants des secteurs pacifiés. Il leur demande de bien accueillir les nouveaux pionniers, de pourvoir aux terres et donne des conseils pratiques sur les fontaines, les moulins collectifs, le cheptel et rassembler. En post-scriptum, ne laissant rien au
hasard, il précise même a Charron que " la meilleure truie à adapter au climat d'Afrique est la petite truie noire des Baléares, résistante et prolifique ".
La lettre, bruissant d'un entrain destiné a remonter le moral de l'infortuné Charron, auquel on demande de jeter les bases de quarante-deux villages en deux semaines, laisse aussi percer une certaine inquiétude. Vaste entreprise que de transformer en colons des prolétaires, des boutiquiers et des artisans. Pour les appâter, on leur propose quoi ? Le Pérou, comme toujours. Un Pérou a la mesure de leur misère. Tout candidat agréé recevra :
- un logis que l'Etat doit faire construire dans les plus brefs délais ;
- un lot de terres de 2 a 10 hectares, selon le nombre d'enfants ;
- des semences, des instruments aratoires, un cheptel ;
- enfin, des rations de vivres gratuites jusqu'a ce que la terre soit mise en valeur.
En revanche, les exigences du général-ministre sont fort minces :
avoir moins de soixante ans, un casier judiciaire vierge et un certificat de bonne santé.
Bien évidemment, un vent d'allégresse souffle sur les taudis, les ateliers, les boutiques en faillite, la misère et la faim des chômeurs parisiens. Cent mille candidats se présentent. On ne retient que 13500 dossiers.

Le lendemain, on conduit les futurs colons, avec leurs baluchons, leurs gosses et leurs espoirs, sur des prolonges d'artillerie, jusqu'a la terre promise. La, le rêve s'écroule. Sur place il n'y a rien, rien que de la broussaille, des chèvres qui boivent le vent, et des guitounes de l'armée ou on les entasse en vrac. Certains pleurent, d'autres gueulent, d'autres se résignent. Tous apprendront que cette terre ne réalisera ses promesses qu'après les épreuves de la fièvre, de la faim, de la maladie, de la misère. Le cholera, qui éclate en 1849, en emporte une partie.
D'autres repartent à leurs frais et vont parfois à pied de Marseille à Paris.
Ceux qui s'obstinent, très vite privés de moniteurs agricoles, cultivent sous la coupe de l'armée des céréales qui ne rendent pas grand-chose et qui les condamnent a l'indigence.
L'administration des villages est confiée a des officiers. Ils cumulent tous les pouvoirs. Certains se comportent en missionnaires, d'autres en soudards. A Marengo, le capitaine de Malglaive engage sa fortune pour sauver les colons, tandis qu'à El-Affroun, le lieutenant Buquet s'arroge un droit de cuissage sur leurs femmes. Il en résulte souvent un antimilitarisme violent qui s'exprime dans les clubs, les sociétés secrètes auxquels les Français d'Algérie prennent gout. Paradoxalement, ils exprimeront cet antimilitarisme, en 1852, accordant leur vote à Napoléon III, quand ce dernier viendra faire plébisciter son coup d'Etat jusque dans les villages d'Algérie. Les germes d'un antagonisme profond entre l'armée et les colons naissent dans les villages agricoles de 1848 ; ils se développent jusqu'a sceller l'unité des civils dans le conflit ouvert qui éclatera par la suite.
Marie Elbe - Les jujubiers de la conquête (extrait) - " Ces minorités qui font la France- Les pieds-noirs " Ed Philippe Lebaud
Mis en ligne le 16 nov 2010