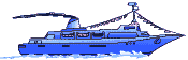Si l'excédant de la population française se déversait sur l'Algérie, dans la proportion des diverses professions de la métropole, la colonie se trouverait bientôt pourvue des ouvriers dont elle a besoin.
Dans les premiers temps de l'occupation, la population civile de l'Algérie ne se composait guère que de petits industriels. Un certain nombre de cantiniers avait suivi l'armée ; ses approvisionnements en attirèrent beaucoup d'autres à mesure que l'occupation prit plus de consistance et que la guerre intérieure qu'il fallut soutenir augmenta l'effectif. A ce premier noyau vinrent bientôt se joindre tous les gens qui, dans leur pays, sentaient leur avenir compromis, et qui ne trouvaient pas en France un assez libre essor à leurs mauvaises passions.
A une époque où le sort de la colonie était encore incertain, on ne pouvait pas trop se plaindre d'une telle composition ; il n'y avait guère que des aventuriers qui pussent avoir envie de quitter la France pour aller habiter les côtes barbaresques et mener la vie des camps. Mais lorsque toutes les incertitudes furent levées, que la question d'abandon fut tranchée, et que la colonisation fut définitivement résolue, on comprit que la première chose à faire était d'attirer en Algérie les ouvriers nécessaires pour cette grande entreprise.
La première catégorie comprenait, pour les hommes, les carriers, les maçons, les tailleurs de pierres, les tuiliers, les briquetiers, les chaufourniers, les charpentiers, les menuisiers, les plâtriers, les marbriers, les serruriers, les forgerons, les scieurs de long, les peintres en bâtiments, les plombiers, les charrons, les charretiers, les maréchaux-ferrants, les taillandiers et fabricants d'outils aratoires, les ferblantiers, les chaudronniers, les calfats, les cordiers, les terrassiers, les manœuvres, les garçons de labour, les jardiniers-maraîchers, les pépiniéristes et greffeurs, les fontainiers et foreurs de puits. Les femmes comprises dans cette catégorie étaient les couturières, les lingères, les cuisinières, les filles de fermes et les dévideuses de cocons. M. le Ministre de la guerre promettait le passage gratuit aux ouvriers exerçant les professions ci-dessus énumérées, et à ceux-là seulement. Ces permis n'étaient point délivrés aux ouvriers qui avaient des enfants en bas-âge, c'est-à-dire au-dessous de
douze ans, à moins qu'ils ne s'engageassent à les laisser en France. C'était exclure la plupart des ouvriers mariés, et n'attirer dans la colonie, avec les garçons, que les maris bien aises de se séparer de leurs femmes et de leurs enfants. Néanmoins, on n'admettait que ceux qui étaient porteurs d'un certificat de moralité délivré par le maire de leur commune.
Les émigrants concessionnaires formaient la seconde catégorie des ouvriers. L'administration les destinait à la fertilisation et au peuplement des campagnes ; elle les groupait en centres agricoles. Ces centres agricoles se constituaient à l'aide de quatre éléments, savoir : les capitalistes, les propriétaires, les fermiers ou métayers et les industriels. Ces derniers colons étaient les aubergistes, les bouchers, les boulangers, les menuisiers, les charpentiers, les forgerons et les tuiliers. Invités à faire comme les autres des constructions, ils ne devaient obtenir que deux ou trois hectares de terre et au maximum cinq hectares. Les colons concessionnaires étaient tous admis au passage gratuit. A leur arrivée, ils étaient reçus dans des dépôts d'ouvriers où ils étaient hébergés.
La plupart des terres en France ont une grande valeur ; qu'elles soient réunies en corps de ferme ou divisées en petits champs, qu'elles soient labourables ou couvertes de bois, le propriétaire peut toujours en tirer parti, soit par lui-même, soit par d'autres et est assuré d'un produit quelconque. Comme il était difficile en France de se faire une idée de ce que pouvaient être les terres en Algérie, l'offre de devenir concessionnaire devait être séduisante pour un grand nombre. La grande ambition des ouvriers qui ne possèdent rien est de devenir propriétaires, et ce n'est pas pour autre chose qu'un si grand nombre souvent désirent des révolutions. Les préfets, responsables de l'ordre public dans leurs départements, saisirent avec empressement ce moyen, qui leur était offert par le Ministre de la guerre, de se débarrasser de la population ouvrière qui ne pouvait pas ou ne voulait pas trouver de travail autour d'eux. Toutes les facilités furent données pour une migration en Algérie à tous ceux qui étaient une charge ou un embarras. La charité s'en mêla comme la politique, et l'on vint même jusqu'à croire que cette migration était un moyen de rétablir la fortune de toutes les personnes ruinées. Si la guerre avec les Arabes, qui n'était pas encore achevée, n'avait fait trembler la plupart ; si l'idée que sur la terre d'Afrique on était à chaque instant exposé, non-seulement à recevoir des coups de fusils, mais encore à être dévoré par une multitude de bêtes féroces, n'avait arrêté les plus intrépides, il eût été difficile, aux premières propositions qui en furent faites, de modérer l'ambition d'une foule de prolétaires français. Mais aussi on comprend les exigences de tous ceux qui ne craignirent point d'affronter de pareils dangers.
Les colons concessionnaires, en attendant leur installation, ne cherchaient point à travailler ; ils allaient devenir propriétaires, être riches ; ils pouvaient donc dépenser leur argent sans crainte. Quant aux autres, venus comme simples ouvriers industriels, ils marchandaient chèrement leur travail : le moindre apprenti menuisier ou maçon n'exigeait pas moins de 5 ou 6 fr. pour sa journée. Les maîtres ouvriers étaient hors de prix ; ils n'opéraient le plus souvent que comme entrepreneurs ou comme architectes. Au milieu de tant de gens qui se croisaient les bras et qui bâtissaient des châteaux en Espagne, tous ceux qui, moins préoccupés des rêves de l'avenir, ne dédaignaient pas de mettre aussitôt la main à l'œuvre, voulaient au moins tirer quelque compensation dans les jouissances du présent. D'ailleurs ils n'avaient ni famille, ni ménage à pourvoir : tout ce qu'ils n'avaient pas mangé dans la journée ils l'employaient le soir à se divertir.
Les ouvriers d'art, avec leurs salaires élevés, se tiraient généralement encore assez bien d'affaire et pourvoyaient à toutes les exigences de la nouvelle position qu'ils s'étaient faite ; mais ceux qui en étaient réduits, faute de pouvoir mieux faire, au métier de manœuvre ou de terrassier, un peu moins bien rétribué, réglaient plus difficilement les comptes d'aubergistes ou de cabaretiers. Ainsi, des ouvriers gagnant 2 fr. 50 c. par jour se mettaient en pension à 60 fr. par mois ; et ce n'était pas trop quand on songe qu'il ne leur fallait pas moins d'un litre de vin par chaque repas, plusieurs plats de viande, de la volaille, un dessert assorti et du café. Il restait bien peu pour leur entretien et leurs menus-plaisirs, encore ne leur fallait-il pas chômer le dimanche (1). Quand par malheur le travail quotidien était interrompu, après avoir épuisé leur crédit, ils n'avaient d'autre alternative que de se serrer la ceinture ou de sacrifier leurs épaules à leur ventre, en vendant l'une après l'autre les différentes pièces de leur vêtement, jusqu'à leur dernière chemise. En tous cas, ils entraient dans de très-mauvaises conditions hygiéniques dont ils ne tardaient pas à ressentir les effets. Après plusieurs séjours à l'hôpital, le tempérament des plus robustes finissait par s'épuiser ; la moindre fatigue, le moindre refroidissement faisaient revenir la fièvre, et dès lors ces pauvres ouvriers, maudissant l'Afrique, quand ils auraient dû souvent ne s'en
prendre qu'à leur inconduite et à leurs excès, ne songeaient plus qu'à retourner en France. Bien peu de ces ouvriers se sont fixés en Algérie dans les premiers temps ; alors qu'il leur eût été si facile, par une conduite rangée et un peu d'économie, d'y prospérer et d'assurer leur sort.
C'était chose beaucoup moins aisée pour ceux qui étaient pressés de devenir propriétaires, et qui s'imaginaient pouvoir subvenir aux charges de cette nouvelle position avec les seules ressources de leur travail. Ils attendaient des mois et quelquefois des années entières le bienheureux titre provisoire qui leur permettrait d'aller s'installer sur une concession. La plupart avaient déjà absorbé en frais de voyage et de séjour les quelques économies qu'ils avaient apportées. Leur nouveau domaine consistait le plus souvent en lots de terres en friche, couvertes de broussailles ou de palmiers-nains. Ce genre de végétation était loin d'offrir à nos colons africains les ressources qu'offrent à ceux du Nouveau-Monde les forêts vierges de l'Amérique. Là on trouve en abondance
tout le combustible et tout le bois de construction nécessaire à une première installation. Une touffe de palmier nain à arracher donne autant de peine qu'un gros arbre à abattre, sans procurer les mêmes avantages : les racines de palmier-nain ne sont même pas bonnes à brûler. Du reste, moins les terres de l'Algérie sont en friche, plus elles ont été exploitées par les Arabes, plus elles ont été ravagées et plus elles sont dépouillées des premières ressources que la nature y avait placées. Ceux qui voulaient s'y établir pour les mettre en valeur, et qui avaient besoin d'un autre abri que celui de leurs anciens maîtres, étaient donc obligés de tout apporter avec eux, nourriture, outils et matériaux.
Or, les voies de communication de l'Algérie dans les premiers temps n'étaient pas faciles. Sans doute l'Administration bienveillante fournissait quelques matériaux à ses colons, leur donnait des planches avec lesquelles ils pouvaient se construire des baraques ; mais en étaient-ils beaucoup plus avancés ? Tout leur manquait pour vivre : et en supposant qu'ils eussent encore un peu d'argent, ils étaient obligés d'aller chercher au loin des provisions dont le prix doublait par la difficulté du transport. L'eau potable même leur manquait souvent. Ils avaient des terres ; mais avant de pouvoir jouir d'une récolte, il fallait les labourer, les ensemencer, Ces établissements, dont la création remonte à 1842, avaient été développés dans les trois provinces ; il y en avait à Alger, à Oran, à Philippeville et à Bône. Le plus important, celui d'Alger, pouvait contenir environ 150 individus. Les hommes, femmes et enfants y étaient logés et couchés dans de vastes dortoirs divisés par catégories, et recevaient chacun une ration de vivres qui leur était distribuée dans un réfectoire en deux repas par jour. Le dépôt d'Alger, placé comme les autres sous la surveillance immédiate de l'Administration municipale, était dirigé par un agent comptable auquel étaient adjoints des surveillants, des hommes de peine et des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Toutefois, le règlement de ces établissements avait été un peu modifié. Dans l'origine, les colons concessionnaires devaient y être hébergés jusqu'au jour où ils seraient en possession de leurs terres ; mais comme cette mise en possession ne se faisait souvent, dans les premiers temps, qu'une année après le débarquement, pour ne point trop augmenter les charges de l'Etat, il avait été décidé que le séjour dans les dépôts, des colons concessionnaires ainsi que des simples ouvriers, serait réduit à cinq jours.
Les premiers administrateurs, croyant que tout était réglé pour le mieux et que rien ne pouvait être ajouté à leurs prévisions, se consolaient froidement de tous ces mécomptes en disant que ce qui était fait n'en restait pas moins acquis au sol, et qu'au pis aller les premiers colons auraient servi à. engraisser la terre. Mais, en attendant, le résultat n'était pas encourageant pour l'émigration. Les familles ainsi décimées n'en appelaient pas d'autres ; et celles qui étaient appelées au partage d'aussi tristes successions ne faisaient que déprécier partout les avantages de la colonisation africaine. La misère était grande en France, et la disette de 1846 avait épuisé toutes les ressources alimentaires. On ne savait comment nourrir tous les pauvres gens des campagnes ; ils en étaient réduits, dans certains cantons de la Lorraine allemande, à disputer aux animaux leur pâture et à faire cuire quelques herbes pour ne pas tomber d'inanition. Le moment était favorable pour essayer de peupler l'Algérie de bons ouvriers agriculteurs ; le Gouvernement facilita donc les transports ; il chercha partout des terres à concéder, et pour que les petits colons n'éprouvassent plus de retard, il laissa aux autorités locales le soin de les pourvoir. Les commissaires civils eux-mêmes, dans les moindres localités, purent les installer provisoirement.
Dans les circonstances difficiles où le manque de pain avait mis la France, une nouvelle et large place se faisait donc en Algérie pour tous les colons de bonne volonté. Partout il s'y trouvait d'anciennes concessions à vendre et de nouvelles à donner ; mais l'appât des concessions était devenu insuffisant. Chaque année, aux Chambres, on voyait aussi revenir la question de colonisation à propos du budget de l'Algérie. Cet énorme budget ne diminuait point : l'armée d'occupation était toujours très-nombreuse ; on aurait voulu, en la diminuant, dégrever un peu l'État de sa charge la plus lourde, ou du moins préparer ce résultat par le développement de la colonisation, par des dépenses productives qui en assureraient la prospérité. Mais Louis-Philippe ne voulait de l'Afrique que pour l'armée, dont il ne savait que faire, et l'armée ne voulait non plus que pour son propre avantage de la colonisation qui la gênait. La colonisation n'entrait donc dans le budget que comme un accessoire obligé, elle ne devait servir qu'à justifier les autres dépenses.
L'État ne se souciait donc pas de se mettre en nouveaux frais, et l'on conçoit que les particuliers devaient être, de leur côté, médiocrement enclins à faire la guerre à leurs dépens, pour vaincre les difficultés d'une entreprise incertaine. Trop peu de personnes en France s'intéressaient à l'Algérie pour qu'il y eût lieu d'espérer qu'on prît de longtemps les mesures nécessaires pour y attirer de nouveaux colons. Mais sous la République les choses changèrent tout d'un coup de face, et la question de la colonisation prit une importance toute nouvelle qui vint frapper l'attention publique. La cessation du commerce avait mis sur le pavé une masse d'ouvriers que l'industrie ne pouvait plus nourrir, et, plus que jamais, tous les regards se tournaient vers l'agriculture. Ce n'était pas là une affaire de circonstance et une crise passagère. Les statistiques faites précédemment avaient constaté
que la population de la France s'accroissait chaque cinq ans de plus d'un million d'habitants, d'où il résultait qu'à la fin du siècle elle serait augmentée de 10 à 12 millions d'âmes. Au commencement de la République, ces considérations devenaient plus sensibles que jamais, et les hommes d'État du jour comprirent très-bien l'abîme dans lequel on allait jeter la patrie, si l'on ne s'empressait de diriger vers l'agriculture la masse nombreuse des ouvriers. D'un autre côté, les ouvriers commençaient à comprendre le triste rôle que l'industrie leur réservait, et ils jugeaient avec raison que la possession du sol était la première garantie de l'indépendance. Comment alors, sans bouleverser la société, satisfaire aux prétentions de la masse d'ouvriers repoussés de l'industrie ; comment faire pour les rendre propriétaires sans léser les droits de ceux qui l'étaient déjà ? Il est vrai qu'il restait encore des terres en friche ; mais ce n'étaient pas les meilleures, et la plupart eussent exigé plus de travaux qu'elles n'eussent produit de fruits. Sous le précédent règne l'occupation de l'Algérie était venue fort à propos résoudre une difficulté : celle de pouvoir faire la guerre et de préparer une bonne armée sans rompre la paix avec l'Europe, base principale du système d'alors. Sous la nouvelle République, il semblait que l'Afrique fût appelée à résoudre une nouvelle difficulté plus essentielle encore pour la France; celle d'attacher au sol une masse turbulente d'ouvriers, et cela sans troubler les anciens propriétaires, sans rompre la paix intérieure, non moins précieuse que celle du dehors.
Devenue toute politique, la question de colonisation algérienne s'agita dans tous les clubs, et bientôt, voulant répondre au nouvel élan qui commençait à se manifester, l'Assemblée nationale n'hésita pas à voter un crédit de 50 millions pour l'établissement de colonies agricoles en Algérie. Depuis bientôt vingt ans on n'avait pas encore fait d'aussi grands sacrifices. Ces nouveaux millions, votés à l'occasion des ouvriers parisiens, devaient-ils beaucoup plus servir à la colonisation africaine que ceux votés à l'occasion de l'armée ? Des Parisiens civilisés ne devaient pas procéder en arrivant dans la colonie comme de simples paysans : leur pain assuré, les jouissances intellectuelles, les intérêts sociaux devaient tout d'abord les préoccuper. Ceux de Fleurus ont poussé la chose au point de demander qu'avant de construire leurs maisons, on édifiât la salle de spectacle. Une troupe d'artistes s'organisa aussitôt, et au bout de quelques semaines on joua des vaudevilles et des drames dans ce fortuné village, tout aussi bien qu'aux Variétés et à la Porte-Saint-Martin. La politique a bien pu faire déserter les champs, maïs elle n'a pu faire oublier le beau sexe. Il fallait aux Romains panem et circenses ; les Parisiens avaient des goûts moins féroces : le pain et la danse leur suffisaient. Les règlements militaires détournaient l'armée des clubs, mais ne lui interdisaient pas les réunions joyeuses. Officiers et soldats s'étaient donc mis de la partie pour ces innocents plaisirs. Dans tous les villages agricoles il y avait bal comme à la Grande-Chaumière, le dimanche, le lundi et le jeudi. Certains directeurs des colonies se comportaient comme des princes, et daignaient ouvrir les bals par une contredanse avec leurs sujets bien-aimés
Entre autres avantages offerts aux Parisiens dans les colonies agricoles, il en était un inappréciable pour eux. En
Afrique il n'y avait ni octroi, ni barrière : on pouvait boire sans déplacement ; liberté presque complète était accordée au commerce ; de sorte que bien des maisons de chaque village avait pu être transformée en cabarets, ermitages, rendez-vous d'amis, et tout le village devenir une guinguette perpétuelle très-bien assortie. Il y avait de quoi ôter jusqu'au regret du paradis perdu. Puis on était affranchi dans les colonies agricoles des sévères règlements de la police parisienne ; les jouissances de la vie pouvaient se prolonger tard : on y tolérait l'ouverture des cabarets jusqu'à une ou deux heures après minuit. Les buveurs intrépides avaient jusqu'au jour la ressource d'emporter, en guise de punch, un bol de vin et d'aller boire, près du corps de garde, à la santé et sous la protection de la sentinelle. Il résultait malheureusement de tout cela certains abus, car quelquefois les têtes de nos colons se montaient et ils devenaient très-peu maîtres d'eux.
Un jour, un colon d'Aboukir avait besoin d'argent pour payer le cabaretier; son sac était vide, il ouvre la malle de sa femme pour lui prendre ses bijoux ; le fils, mécontent de ce procédé, veut défendre le bien de sa mère. Notre colon, irrité de l'impudence de son fils, prend son fusil et le lui décharge dans la cuisse qu'il perce de part en part. Sa femme se sauve, il prend un autre fusil et l'atteint dans les reins. La scène s'était passée en plein jour et devant témoins ; la justice allait informer, mais les témoins arrangèrent l'affaire. Ils avaient à cœur de sauver leur camarade, " car, disaient-ils, le même accident pourrait d'un jour à l'autre nous arriver. " L'acquittement fut prononcé à la satisfaction générale. Quant à la victime, elle apprit, au sortir de l'hôpital où elle avait été transportée, qu'une partie de ses hardes était vendue. L'installation précipitée des colons parisiens avait eu de graves inconvénients : les maisons n'étaient pas construites ; on avait mis dans les mêmes baraques plusieurs familles ensemble, et les baraques elles-mêmes n'étaient séparées que par des planches. Il en résultait que des femmes honorables, de jeunes filles, des enfants étaient exposés à entendre des propos qui révoltaient la nature, et à assister, une partie des nuits, à des orgies abominables. Que si quelqu'un voulait imposer silence quand tous les tapageurs étaient échauffés, c'était un motif de plus pour les exciter. Trop souvent les militaires chargés de l'administration participaient à ces désordres, et l'on voyait des mères fermer les yeux pour être le lendemain un peu mieux partagées dans la distribution des rations. Dans quelques colonies cependant, des ordres sévères avaient été donnés pour empêcher les soldats de fréquenter les colons. On a pu, par de semblables prohibitions, préserver quelques villages composés de colons plus sérieux.
Bon nombre de Parisiens avaient des mœurs très-rangées, et aussitôt qu'ils furent installés dans leurs nouveaux logements, ils s'efforcèrent de reprendre des habitudes laborieuses, chacun selon sa profession. Les uns ouvrirent des boutiques d'horlogerie, les autres s'appliquèrent à l'ébénisterie, à la confection des articles de Paris. Les moindres villages furent bientôt pourvus de toutes sortes de magasins. Ces habiles industriels étaient complètement étrangers aux travaux de l'agriculture ; ils ne savaient comment s'y prendre pour utiliser les lots de terres qu'on leur avait assignés. Néanmoins quelques-uns avaient essayé de faire des jardins ; ils 'étaient donné une peine incroyable à cultiver quelques légumes, à semer quelques carrés de pommes de terre ; mais soit que les terrains eussent été mal préparés, soit que les semailles n'eussent pas été faites en temps opportun, soit que les arrosements eussent été mal combinés, la plupart des premières récoltes manquèrent et jetèrent un premier découragement dans l'âme de nos Parisiens. Cependant, l'Administration, dès qu'il avait été question des colonies agricoles, pensant bien que les concessions ne seraient pas distribuées aux colons assez à temps pour les cultures, avait fait ensemencer par les Arabes une grande quantité des terres de la plaine appartenant à l'État. Quand la saison de la moisson fut arrivée, on annonça aux colons parisiens ce qu'on avait fait à leur intention ; il ne leur restait plus qu'à récolter.
Dès la seconde année, une grande partie ne songeait plus qu'à retourner en France : c'était pitié de les voir arriver dans les dépôts d'ouvriers pour prendre leur passage. La première campagne les avait rendus méconnaissables, leurs traits, si animés, n'exprimaient plus que des souffrances ; et ces citadins, naguère si élégamment vêtus, n'étaient plus couverts que de haillons. Cependant, comme les vivres avaient été assurés pendant trois ans, ceux qui n'espéraient pas encore trouver en France des moyens d'existence, restèrent courageusement jusqu'à l'expiration du délai.
A cette époque plus des trois quarts étaient déjà partis. Si les maisons et les concessions avaient pu se vendre, presque tous eussent liquidé leurs affairés et dit à l'Afrique un éternel adieu ; mais les titres de concessions devaient devenir définitifs qu'au bout d'un stage de six années. Quelques-uns s'armèrent donc de courage et, dans l'espoir de ne point revenir les mains vides, prolongèrent encore leur exil : il leur répugnait d'avoir fait en pure perte une telle équipée.
Le Gouvernement, de son côté, voyant la manière dont le nouvel essai tournait, avait bientôt suspendu le départ des Parisiens. On avait fini par ne plus envoyer dans les colonies agricoles que des cultivateurs étrangers à la capitale ; l'Administration locale elle-même, au fur et à mesure des vacances, s'efforçait de colloquer dans ces colonies des ouvriers déjà éprouvés, et surtout d'anciens militaires. Il était bien juste de donner la préférence à ces braves, et de profiter de l'occasion pour reconnaître d'une manière convenable des services qu'ils avaient pu rendre.
Comme la classe des agriculteurs est en définitive là plus nombreuse en France, il en résulte que c'est surtout au milieu-d'elle que se font les recrues de l'armée. Aussi nos soldats avaient-ils été d'un grand secours pour les colonies agricoles.
Presque toutes les cultures et tous les défrichements y avaient été faits également par eux. Depuis longtemps, un bon nombre avait été détaché dans les fermes et les villages pour donner aux autres colons le secours d'une main-d'œuvre à bon marché. Beaucoup de militaires n'attendaient plus que leur libération pour se fixer en Algérie. N'ayant point eu à subir les mêmes privations que les pauvres colons, ils s'étaient acclimatés beaucoup plus facilement, et ils avaient pu faire un excellent apprentissage dans foules les cultures auxquelles ils avaient été appliqués. Les meilleurs colons français sont ceux qui sont venus dans les derniers temps et qui ont été le plus abandonnés à eux-mêmes. La plupart se sont placés comme métayers dans les fermes, ou ont pris des arrangements avec des propriétaires pour différentes cultures industrielles. Quelques-uns, après plusieurs campagnes avantageuses, ont pu faire des économies, acheter des bêtes, se pourvoir d'instruments aratoires, monter enfin un matériel de ferme suffisant pour entreprendre à leur propre compte des exploitations agricoles, soit en louant de petites propriétés, soit en finissant par demander des concessions. Les plus sages, au lieu de faire des démarches pour en obtenir, se sont bornés à en acheter.
Les colons du Gouvernement, comme nous l'avons vu, se dégoûtent ordinairement du cadeau qui leur est fait. Venus pour vivre de leurs rentes en propriétaires, ils sont bientôt las d'un travail auquel ils ne s'attendaient pas. Les charges de leurs concessions leur pèsent : pour bien peu d'argent, pour le payement de quelques dettes, ils abandonnent tous leurs droits. Ainsi, d'anciennes concessions toutes bâties coûtent souvent moins cher que des constructions qu'il faudrait faire partout ailleurs. En tout cas, il y a avantage de se loger dans une maison dont les murs sont déjà secs, sur le territoire d'un village déjà pourvu de fontaines et de routes, plutôt que d'aller camper au loin, dans des lieux encore sauvages comme les concessionnaires privilégiés.
Parmi les colons qui réussissent le mieux, on remarqué les Basques, les Francs-Comtois, les Lorrains et les Alsaciens. Les colons du Nord sont quelquefois plus éprouvés par les maladies que ceux qui arrivent de la Provence ou du Languedoc. Mais en prenant les soins hygiéniques nécessaires, en évitant tout excès, en ne se plaçant pas à leurs débuts dans les plus mauvaises conditions, ils finissent par jouir d'une aussi bonne santé que dans leur pays. Venus souvent pour faire un simple essai, ils sont les premiers à se fixer sans esprit de retour. On ne les voit revenir au pays qu'ils ont quitté que pour vendre quelques héritages ou liquider une succession. Leur exemple est un encouragement pour d'autres et détermine de nouvelles migrations.
Ces migrations sont bien facilitées quand de pauvres ouvriers, en se déplaçant, sont assurés de trouver, à leur arrivée dans une colonie lointaine, des habitants de leur village qui les accueillent comme des frères, qui leur cherchent du travail, qui les guident et qui les aident à faire leur apprentissage. Un tel patronage, toujours cordial et empressé, est préférable mille fois à celui que peut donner le Gouvernement. Toutefois, il ne faut pas se le dissimuler, ce pêle-mêle de la colonisation artificielle de l'Etat a eu ses avantages. Sans doute ces ouvriers parisiens, ces paysans basques ou francs- comtois, ces marchands marseillais, ces anciens artistes, ces anciens militaires, ces anciens capitalistes, tous ces hommes déclassés attirés des quatre coins de la France vers notre colonie, ont dû former dans les premiers temps un singulier amalgame, dans tous les nouveaux centres de population, avec les indigènes et les étrangers de toutes les langues. Sur ce sol africain, il n'y avait plus l'amour du pays et les affections de clocher ; les liens de famille étaient presque entièrement rompus. Cet isolement, au premier abord, portait un peu à l'égoïsme, éteignait le dévouement fraternel, était plus préjudiciable que favorable au prochain ; mais les épreuves de la vie retrempaient le caractère. Beaucoup de natures molles et efféminées ont dû se transformer en Afrique, y prendre la virilité. Plus les difficultés de la colonisation étaient grandes, plus il fallait d'énergie et de force d'âme pour les surmonter. L'intelligence alors se développait ; elle n'était plus d'ailleurs sous l'empire d'une étroite routine. Chacun apportait de son pays des procédés dont il s'empressait de faire l'application, et l'expérience qu'il en faisait pouvait profiter à tous. Le citadin en paletot conduisait sa charrue à côté du paysan en blouse, son voisin ; ou faisait marcher son chariot à la suite de quelques rouliers, transportant comme eux des marchandises pour utiliser son voyage. On causait dans les champs, on causait sur les routes, on fraternisait dans les auberges. Quel que fût le point de rencontre, si l'un était obligé de descendre, l'autre devait chercher à s'élever : c'était un pas de fait vers la civilisation.
D'un autre côté, sous le soleil africain, beaucoup de préjugés devaient se dissiper. A la suite des abus du siècle dernier et des révolutions qui s'en sont suivies, l'impiété en France a fait de grands ravages. Dans beaucoup de nos provinces où les sentiments religieux se transmettaient sans s'altérer d'une génération à l'autre, la foi maintenant est presque éteinte. On n'ose plus s'avouer chrétien : on rougit d'un signe extérieur de piété ; et lorsque l'on vit dans la plus profonde ignorance de l'Évangile, on croit se relever en blasphémant le saint nom de Dieu et en prenant à partie les ministres de ses autels. Le profond respect des Musulmans pour tout ce qui touche à leur foi a dû nécessairement faire une grande impression sur ces malheureux enfants de la révolution, élevés dans l'oubli de Dieu et quelquefois la haine des prêtres. Ces barbares infidèles priant Dieu plusieurs fois par jour, se prosternant au premier endroit venu, sans respect humain, sans s'inquiéter de ce qui se passe autour d'eux, ne doivent-ils pas leur faire honte à eux-mêmes, et leur rappeler que toutes les pensées d'un homme civilisé ne doivent pas se porter vers la terre ? Puis ces jeûnes et ces abstinences, dont la rigoureuse observation pourrait paraître une inconséquence de la part d'hommes qui se laissaient aller à toutes leurs passions, ne devaient pas moins les réconcilier avec les pratiques plus douces et mieux entendues de l'Église. Les
Juifs eux-mêmes observaient scrupuleusement les préceptes de leur loi, et, malgré leur amour du lucre, on les voyait tous interrompre leurs affaires et fermer leurs boutiques pour sanctifier le jour du Seigneur.
Faisant un retour sur eux-mêmes, nos colons les plus prévenus, dans un milieu si différent, ne devaient-ils point s'apercevoir que l'Eglise n'avait rien imposé d'extraordinaire ; qu'en réalité c'était moins l'Église que leurs propres passions qui les gênaient, et que s'ils n'avaient pas la force de les vaincre, ce n'était pas une raison pour se placer, vis-à-vis de Dieu, au-dessous des nations barbares ? Aussi est-il à remarquer que leurs sentiments religieux, bien qu'ils aient eu de fréquentes occasions de s'émousser en Algérie, n'ont fait au contraire que se raviver.
Naguère, ayant, fait halte à l'entrée de la nuit dans un petit village, nous fûmes témoin d'un consolant spectacle. A peine la cloche avait-elle sonné, que tous les colons interrompent leurs affaires, font trêve aux conversations, quittent leurs tables et sortent de leurs maisons, hommes, femmes et enfants. C'était la prière du soir qui, chaque jour pendant le carême, les réunissait au pied des autels. Là, un bon prêtre, sans artifice de langage, mais avec toute l'ardeur de ses convictions, leur donne quelques salutaires conseils, les édifie sur les avantages de la vie chrétienne, parle aux mères de leurs enfants, exhorte les pères à donner l'exemple du bien, à s'observer dans leurs paroles. La petite chapelle était trop étroite ; les femmes à elles seules remplissaient la nef, les hommes étaient entassés dans les tribunes. Au moment de la bénédiction, tous se prosternent dans un saint recueillement. A chaque instant on voit nos colons réclamer des prêtres pour leurs villages, demander la fondation d'une chapelle, s'offrir eux-mêmes pour la construire, on du moins pour aider les maçons et apporter les matériaux, Le culte, les écoles sont encore, avant les routes et les fontaines ; l'objet de leurs pétitions et des faveurs qu'ils demandent au gouverneur général ou aux préfets, lorsqu'ils sont honorés de leur visite. Tandis qu'en France on ne voit que trop souvent les Conseils municipaux repousser les institutions religieuses pour l'enseignement primaire, les municipalités de l'Algérie appellent à l'envi les Frères des Écoles chrétiennes : c'est au point que M. le ministre, dans l'intérêt des instituteurs laïques, s'est cru obligé d'adresser une circulaire aux préfets de l'Algérie pour qu'à l'avenir ils n'autorisassent les Ecoles des Frères que dans les communes où l'on pourrait réunir au moins 200 enfants.
Ce serait donc se faire une très-fausse idée de la population française de l'Algérie que de lui croire des sentiments moins élevés que ceux qui ont jusqu'ici honoré notre vieille France. Il se forme, au contraire, sur le continent africain, une génération nouvelle fortement trempée, qui formera un contrepoids salutaire au relâchement moral que les bouleversements sociaux ont apporté dans la mère-patrie. On a vu, il y a quelques années, nos généraux et nos soldats africains garantir la paix intérieure, et, tout récemment encore, soutenir avec éclat la gloire de la France à l'extérieur. Le temps n'est peut-être pas éloigné où nos colons de l'Algérie apporteront eux-mêmes les plus belles pierres de l'édifice dans la reconstruction du nouvel ordre social qui doit replacer la France à la tête des nations.
Malheureusement, il n'en est pas ainsi ; il s'opère pour elle un choix tout à fait inverse de celui qu'il faudrait faire. Sur 36,000,000 d'habitants, la France compte 20,000,000 d'agriculteurs et 10,000,000 d'artisans, dont 2,000,000 environ sont des ouvriers de manufactures. La France possède, en outre, environ 4,000,000 de citoyens ayant des positions libérales. Ce ne sont pas ces derniers, non plus que les artisans et les ouvriers de manufactures, dont le concours est le plus utile à notre colonie : il lui faut surtout des agriculteurs.
Or, précisément cette classe d'ouvriers, la plus nombreuse en France, est celle qui a le moins fourni de colons à
l'Algérie.
Aussitôt le Ministre de la Guerre fit adresser, par l'intermédiaire de son collègue de l'Intérieur, des circulaires aux préfets de tous les départements. Ces circulaires réclamaient deux sortes d'ouvriers : les uns, pour travailler librement, soit chez des particuliers, soit dans les ateliers du gouvernement ; les autres, pour exploiter les terres mises à leur disposition, comme concessionnaires de l'État.
Les préfets furent invités à donner toute la publicité possible aux renseignements fournis par le Ministre de la guerre, et à les faire insérer dans les journaux de leurs départements.
 les féconder par de pénibles et longs travaux. Les mieux partagés succombaient à cette première tâche : que devait-il en être de ceux qui, avant de cultiver, étaient obligés de défricher ; travail préparatoire qui exigeait quelquefois dix fois plus de peine et qu'il eût fallu au moins plusieurs années pour accomplir ! En attendant, comment vivre ? Aussi, la nécessité de pourvoir aux besoins impérieux de l'existence forçait-elle nos premiers colons à délaisser leurs terres. S'il leur restait un peu d'argent, s'ils pouvaient disposer d'un peu de temps, tous leurs efforts se concentraient plutôt sur la construction d'une maison. C'était la condition pour obtenir un titre définitif, et avec un titre définitif ils pouvaient emprunter en hypothéquant leur propriété. Mais alors ils tombaient dans les mains des usuriers, et comme ils ne pouvaient longtemps payer par mois et jusqu'à 5 % d'intérêt, il leur fallait bientôt délaisser leur maison avec leurs terres. Toutefois la plupart n'attendaient pas leurs créances. La misère, en épuisant leurs forces, en paralysant leur bonne volonté, en les démoralisant complètement, avait ébranlé leur santé ; les maladies avaient sévi et la mort avait exercé ses ravages.
les féconder par de pénibles et longs travaux. Les mieux partagés succombaient à cette première tâche : que devait-il en être de ceux qui, avant de cultiver, étaient obligés de défricher ; travail préparatoire qui exigeait quelquefois dix fois plus de peine et qu'il eût fallu au moins plusieurs années pour accomplir ! En attendant, comment vivre ? Aussi, la nécessité de pourvoir aux besoins impérieux de l'existence forçait-elle nos premiers colons à délaisser leurs terres. S'il leur restait un peu d'argent, s'ils pouvaient disposer d'un peu de temps, tous leurs efforts se concentraient plutôt sur la construction d'une maison. C'était la condition pour obtenir un titre définitif, et avec un titre définitif ils pouvaient emprunter en hypothéquant leur propriété. Mais alors ils tombaient dans les mains des usuriers, et comme ils ne pouvaient longtemps payer par mois et jusqu'à 5 % d'intérêt, il leur fallait bientôt délaisser leur maison avec leurs terres. Toutefois la plupart n'attendaient pas leurs créances. La misère, en épuisant leurs forces, en paralysant leur bonne volonté, en les démoralisant complètement, avait ébranlé leur santé ; les maladies avaient sévi et la mort avait exercé ses ravages.
Partout on ne voyait plus que des impotents, des veuves, des orphelins. Il n'y avait plus à songer qu'à des œuvres de charité : l'Administration de la colonie s'était transformée en bureau de bienfaisance, et les dépôts d'ouvriers eux-mêmes n'étaient plus devenus que des succursales des hôpitaux.
On admit néanmoins, plus tard, au sortir de l'hôpital, ceux que, dès le début, on s'était empressé de mettre bien portants sur le pavé sans ressources suffisantes. Donner un asile aux ouvriers valétudinaires était, sans contredit, beaucoup moins s'écarter du but primitif de ces établissements que d'en faire des auberges de départ, parti qu'il fallut prendre à la fin pour les utiliser.
Malgré la paix profonde, malgré la sécurité qui, depuis plusieurs années, entouraient nos établissements ; malgré les rapports favorables à la colonisation, qui ne cessaient d'être adressés par le Ministère de la guerre, la population européenne de l'Algérie, en beaucoup d'endroits, tendait plutôt à décroître qu'à augmenter.
On parlait cependant depuis longtemps de la colonisation de l'Algérie. On y avait envoyé des commissions scientifiques ; des économistes et des hommes d'Etat l'avaient honorée de leurs visites ; les touristes commençaient à la sillonner en tous sens, Tous ces voyageurs à leur retour avaient bien voulu publier leurs impressions de voyage. Ils avaient chacun trouvé un nouveau système de colonisation qui devait assurer le succès mieux que tous les essais incomplets tentés jusqu'alors.
Naguère la récolte était venue à manquer ; cette perspective de population croissante avait beaucoup préoccupé les économistes : l'on s'était déjà aperçu du danger pour les finances de tirer de l'étranger la nourriture du peuple, sans être assuré de pouvoir y placer les produits de son industrie.
On vit bientôt la Seine se couvrir de nouvelles embarcations. Une quantité d'ouvriers s'étaient fait inscrire aux mairies de leur arrondissement, et briguaient l'honneur d'aller coloniser l'Algérie sous la bannière républicaine. Ce n'étaient plus, comme autrefois, des vagabonds de bas étage poussés d'étapes en étapes comme des troupes de bohémiens, par des préfets ou par des maires. Les nouveaux émigrants étaient les fils aînés de la patrie ; adoptés par elle, ils devaient mettre au service de la colonie leur dévouement et leur intelligence.
Ils furent bénis à leur départ, bénis à leur arrivée. Partout salués sur leur passage, ils répondaient avec enthousiasme et fredonnaient à qui mieux mieux des airs patriotiques, avec le refrain : "Nourri par la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. " Ce refrain favori, ils l'avaient sur la bouche en faisant leur entrée triomphale à Alger, ils le répétaient encore pour charmer leurs loisirs dans leurs nouvelles résidences.
La salle de spectacle avait un autre avantage important, c'était de pouvoir servir de salle de club : les élections ne devaient pas tarder à avoir lieu, et les Parisiens ont depuis longtemps prouvé qu'ils savent sacrifier leur propre intérêt aux intérêts sacrés de la patrie. Quand ce moment solennel fut arrivé, bien qu'on fût dans la saison des cultures, la plupart oublièrent les travaux des champs pour ceux de la politique.
Si tous les villages ne purent avoir des théâtres, tous au moins eurent des clubs ; de longues discussions s'y engagèrent dans les règles. Les principes de la République démocratique et sociale furent soigneusement élaborés au sein des nouvelles colonies agricoles, et des élections conformes vinrent réjouir la mère-patrie. Du reste, la presse parisienne venait soutenir tous ces efforts. Le Lampion, le Père Duchêne, Aimable Faubourien,
le Journal de la Canaille, n'ont pas vécu assez de temps pour la civilisation de l'Algérie ; mais la Réforme, la République, le Peuple et tous les autres débris de la presse socialiste ont envahi nos colonies agricoles. Dans les cafés-billards de chacune de ces localités, les colons ont pu s'en saturer l'esprit et l'intelligence.
Pour ne point retourner avec son mari, elle demanda pour quelques jours au chef de la colonie un logement vacant qui lui fut refusé. On ne voulait point non plus lui donner les moyens de partir. Cependant, à force d'instances, elle obtint un congé de convalescence, et put s'embarquer avec son fils, encore boiteux.
Les mêmes scènes ne se passaient point dans tous les ménages ; mais dans un très-grand nombre il y avait des désordres, de sorte que les gens tranquilles finissaient souvent par se dégoûter et sollicitaient leur rentrée en France, non à cause du climat, du pays, des Arabes, mais à cause du voisinage de leurs compatriotes.
On y vit des marchands de nouveautés, des marchandes de modes, des coiffeurs au cachet et à l'abonnement.
Malheureusement le commerce n'allait pas, les ressources des colons diminuaient tous les jours ; ils ne pouvaient plus se passer les moindres fantaisies. L'industrie parisienne n'avait aucun succès chez les Arabes; ils n'achetaient point de meubles, ils ne faisaient pas arranger de pendules, les modes les plus nouvelles ne tentaient point leurs femmes. Que faire ?
Pleins d'espérance, ils laissèrent femmes et enfants, s'embrigadèrent par petites troupes de cinq à six et partirent
joyeux pour la plaine. Les braves Parisiens coupèrent leurs blés de leur mieux ; les uns essayaient les faucilles pour la première fois avec plus ou moins d'adresse ; les autres prenaient leurs serpes, et croyaient mieux faire avec des instruments qu'ils avaient coutume d'employer. C'était au milieu de l'été, au moment des plus grandes chaleurs, qui cette année-là ont été extraordinaires. Ces braves gens n'étaient point habitués à de tels travaux et à un tel climat. Ils n'étaient pas non plus accoutumés à coucher à la belle étoile : après avoir été en sueur toute la journée, ils étaient bientôt saisis par la fraîcheur de la nuit. La moisson n'était pas achevée que presque tous avaient déjà la fièvre ; à tel point qu'il n'en resta pas assez pour vanner le blé ; on fut obligé de confier ce soin aux Arabes. Les pauvres colons furent renvoyés chez eux pour se soigner, et beaucoup, une année après, n'étaient pas encore débarrassés des maladies qu'ils avaient gagnées en cette circonstance.
Les anciens militaires font d'excellents colons : malheureusement ils manquent des ressources nécessaires ; la plupart n'ont été enrôlés sous les drapeaux que parce que leurs familles étaient trop pauvres pour leur acheter des remplaçants. L'abandon des colonies agricoles par les ouvriers parisiens a levé pour eux un instant cette difficulté. Héritiers des avantages faits à ces derniers, ils se sont mis à l'œuvre avec quelques succès et ont continué avec ardeur pour leur propre compte les défrichements qu'on leur avait fait commencer pour des gens qui peut-être ne les valaient pas. Ces enfants gâtés de la République s'étaient bornés la plupart du temps à les laisser faire ; quelques-uns ne s'étaient pas même donné la peine de défricher leurs maisons : les palmiers-nains poussaient sous leurs lits comme en serres chaudes. Le temps perdu fut bientôt réparé avec des gens au courant du métier; c'était la seule chose qui manquât aux colonies agricoles.
Aussi est-il à remarquer que les Français placés sous sa tutelle sont en général ceux qui se sont le plus fourvoyés. Victimes, la plupart du temps, de la mauvaise direction qui leur a été donnée, isolés les uns des autres, nos compatriotes ont éprouvé beaucoup de déboires, ont été entraînés dans bien des ruines et n'ont fait que perdre le peu qu'ils avaient apporté. Au contraire, comme nous le verrons tout à l'heure, bon nombre d'étrangers, arrivés avec rien, sont parvenus, en quelques années, à amasser plus d'argent qu'une vie tout entière de pénibles travaux ne leur en aurait procuré dans leur pays, et ils ont fini par attirer dans notre colonie une foule d'ouvriers laborieux et intelligents.
Un de ces colons avait pris un garçon arabe pour auxiliaire ; celui-ci avait suivi son nouveau maître, avait écouté le ministre de l'Evangile et avait admiré la sagesse de ses discours.
Nos colons parlaient déjà de le faire baptiser ; des missionnaires n'eussent pas eu une plus belle ardeur de prosélytisme ; et cependant dans leurs villages de France, ces gens de notre pays eussent tout au plus un jour de dimanche osé aborder l'église où ils avaient eux-mêmes été baptisés ; ce n'eût été, peut-être, que pour aller plaisanter sous le porche, pendant qu'à l'intérieur le curé aurait fait son prône devant les bancs.
"La colonisation de l'Algérie, ses éléments" ; Éditeur : J. Lecoffre (Paris) 1856
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LK8-504
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30066691v
(1) Aujourd'hui les choses ont bien changé ; la moralité des ouvriers de toute espèce est bien plus grande ; bon nombre ont fini par se marier. II n'y a guère maintenant que les postes avancés qui puissent rappeler les anciennes habitudes des premiers ouvriers venus en Afrique, Ainsi les ouvriers de Biskara prennent chez les petits aubergistes de cette localité des pensions de 90 francs qui, avec les extra, montent à 430 francs quelquefois ; tandis que les officiers de la garnison ne dépensent guère plus de 50 francs à leur popote ou table commune.