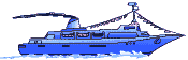 Retour au menu "compléments"
Retour au menu "compléments"
Tous documents écrits ou photos seront les bienvenus. Ils resteront soumis à la loi de propriété et seront susceptibles, si ce ne sont pas des sources personnelles, d'être écartées suivant le souhait des véritables propriétaires. Ceux-ci seront toujours cités, sauf avis contraire dûment explicité.
Je les retranscrirai fidèlement si vous cliquez ici : Contacts
"Le 5 juillet 1962, je me trouvais avec le frère de René B sur le boulevard Gallieni à Oran, devant la compagnie maritime, et vu l'excitation des manifestants, nous avons abandonné la file d'attente et nous avons rebroussé chemin. A l'angle du boulevard Mascara et de la rue de Tlemcen, nous avons vu d'autres manifestants dont les intentions étaient plus que claires, et une patrouille de l'armée française " fumait " sa cigarette tranquillement. Nous avons forcé la marche, et arrivé à l'entrée d'Eckmühl d'autres manifestants remontaient du Ravin. Nous avons passé le reste de la journée, enfermés chez René. Le père Gallas, prêtre au sacré Cœur est passé dans les rues en demandant aux hommes de ne pas sortir. Nous avons vu à travers les volets et depuis la terrasse, les camions qui, ramassaient d'habitude les ordures ménagères, passaient remplis d'hommes assis au fond et encadrés par des membres de l'ALN ou du FLN.D'autres camions étaient remplis de corps allongés, ce n'est que bien plus tard en fin de soirée que j'ai compris qu'il s'agissait de morts.
A Oran, pour embarquer ma grand-mère qui avait presque quatre vingts ans, il fallut "glisser la pièce" au commissaire de bord, métropolitain en tenue, pour qu'il lui attribue une chaise longue qui lui évitait ainsi, de voyager debout. « Enfin, ... on arrive à Oran... Et alors pas un chat dans les rues, sauf au port. Alors là, le bordel comme jamais personne n'a encore vu. Je me rappelle seulement des gens qui courent dans tous les sens. Tous les gens couraient. .. Le bateau, déjà la cheminée fumait. Les gens montaient la passerelle en courant, en criant en pleurant... C'est là que ma mère a commencé à pleurer. Depuis, plus jamais elle s'est arrêtée... Le bateau, c'était le "Ville d'Oran", un beau bateau grand et moderne et tout. Normalement ça devait être bien de faire le voyage dessus..., mais là, qu'est-ce qu'il était triste... Des femmes faisaient des crises de nerfs par terre... En plus qu'on était les uns sur les autres, au moins quinze mille on était dans ce bateau... Là, je dois dire, encore une fois j’ai essayé de comprendre pourquoi tout ça était arrivé, pourquoi on était obligé de partir...,
« Mon mari nous a amenés (avec mes deux enfants) à Marseille le 13 juin. On venait de Bône et c'était pas facile de pouvoir embarquer. Sur le bateau, on était tous pareil et j'ai le souvenir qu'on ne se parlait pas. Moi je pensais à mon mari parce qu'il allait retourner à Bône et j'avais peur. Arrivés à Marseille, j'avais une cousine qui était dans le quartier du "Panier" qui devait nous héberger jusqu'à ce que mon mari revienne. J'avais une chambre avec les enfants, c'était dur mais au moins on avait un toit, parce que j'ai vu, je peux témoigner, des familles dormir dehors. Mais je n'arrivais pas à sortir de l'appartement parce que les Marseillais nous insultaient, nous rendaient responsables de tout et nous mettaient tout sur le dos. Les loyers flambaient, les prix augmentaient, c'était de notre faute. Tout était de notre faute. Je ne pouvais plus rester à Marseille mais je ne pouvais pas avertir mon mari, la Poste ne fonctionnait plus avec l'Algérie. Comment allait-il nous rejoindre et où? Et là, on a eu de la chance parce qu'il ne devait nous rejoindre qu'à la fin août et il a débarqué le 11 juillet. On a pris nos cliques et nos claques et on est partis, d'abord à Nantes parce que mon mari a pu obtenir un travail. Et en 1976, on a pu venir à Montpellier, vers la Méditerranée ».
« Après Bab el Oued, je veux dire après le blocus du quartier par l'armée française, et surtout après la Rue d’Isly (tuerie du 26 mars), à Alger, c'était difficile de vivre. Les magasins ont commencé à tirer les rideaux, le couvre feu était dur, il y avait des attentats partout, des plasticages par les uns et les autres, des enlèvements... Et vers la mi-mai, plus d'école, plus de pain, il était rationné, plus de lait, plus rien. Même plus d'électricité, ni d'eau certains jours. On ne se lavait plus car on gardait les bouteilles qu'on avait remplies pour boire. On a fait comme tout le monde. On a préparé nos valises et on a commencé à voir comment on pouvait partir. Je suis allé me renseigner aux bureaux d'Air-France, à l'immeuble du Maurétania, par avion, c'était impossible. Je suis allé vers le port. La chaîne pour obtenir des billets était impressionnante mais les bateaux chargeaient au maximum. Le 25 juin, on a pu partir pour Marseille mais il faut dire que les places de bateaux, on les a payées, et si on voulait. une chaise longue sur le pont pour la traversée, il y avait un supplément. On nous a rien fait cadeau. Pendant la traversée, une rumeur circule comme quoi on n'arrive pas à Marseille mais qu'on est détourné Toulon, puis sur Port-Vendres. Enfin, c'est bien à Marseille qu'on débarque mais les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. La police et les militaires ont fouillé tous les bagages et on avait intérêt à ne rien dire. Ensuite, aucun accueil, on est baladé de l'autre côté de la ville. On va rester avec ma femme, mon beau-père, les deux enfants dans une pièce d'un appartement d'une cité réquisitionnée par la ville ou le gouvernement, je ne sais pendant cinq jours, isolés, mais qu'avec des pieds-noirs. Après, ils nous ont payés le voyage pour Clermont-Ferrand et là, on a été mieux accueillis, et j’ai trouvé du travail. Et à la retraite, on est venu sur Aix-en-Provence. Mais, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne savait pas où était le reste de famille. On ne nous disait rien. Ma femme n'a appris que sa sœur était à Toulouse qu'en novembre 1962. On ne savait pas s'ils étaient vivants ou morts. C'est aussi pour ça que j’en veux à la France et aux Français, pour cet accueil alors qu'on était des pauvres et on nous disait qu’on était des riches. C’est une blessure ça. »
« Le 30 avril 1962, on nous a désarmés et on a dû signer une feuille stipulant qu'on était libéré à notre demande. C'est faux ! »
" J'ai quitté l'Algérie en octobre 61, à l'âge de 11 ans. Je n'ai pas vécu ces scènes d'exode que vous avez si bien décrites et comme à l'époque nous n'avions pas la télé, je ne les ai jamais vues. J'ai retrouvé dans les témoignages des échos de ma propre expérience avec les métropolitains : " ta mère, elle porte un voile ? ". Je me souviens d'une minute de silence observée suite à l'assassinat de 3 profs par l'OAS, et du regard de toute la classe braqué sur moi. Le comble c'est que je ne suis même pas Pieds-Noirs ! Mes parents ont quitté la France en 56 pour l'Algérie. La dernière génération de colons en quelque sorte. J'ai passé en Algérie les années pendant lesquelles se forgent les goûts, les valeurs et la personnalité. Je dis souvent que je suis Normand tendance couscous. Après toutes ces années, je me sens toujours concerné par l'Algérie, son histoire et son présent. Après leur retour, mes parents ont galéré dans l'attente de la fameuse indemnisation. Ils ont comme beaucoup acheté un petit commerce surévalué en 64, pour finalement faire faillite en 73. La France n'a vraiment pas été à la hauteur. "
" Pour ma part, je suis partie le 23 juin 1962, mes parents quelques mois plus tard, ma grand-mère vivant à Orléansville âgée de 80 ans à l'époque a reçu des menaces de morts de la part des djounouds.
PERPIGNAN :
C'est fin juillet 1962 - impossible de se souvenir de la date exacte - que Gilbert Casimiro, alors âgé de 19 ans, embarquait précipitamment sur le " Ville d'Alger ", dans une grande pagaille et après une semaine d'attente, cloîtré à la maison. Il faut dire que le jeune ouvrier boulanger d'Alger avait eu la trouille de sa vie. " On travaillait au fournil avec mon futur beau-père. Nous n'avions rien à nous reprocher et on pensait pouvoir rester chez nous. Arrive une jeep avec trois militaires algériens. Et là, un des soldats m'a pointé sa mitraillette sur le ventre. C'est son supérieur qui l'a empêché de tirer. Le lendemain, on fabriquait des valises avec des caisses de gâteaux. Grâce à un ami algérien, on a pu aller au port, se faufiler et trouver des billets ".
Dans son appartement du Moulin-à-Vent, Henri Vassalo ne cultive pas les souvenirs. Parti à la fin de l'automne 1962, ce jeune chef de chantier de 27 ans pensait lui aussi pouvoir rester en Algérie et garder son insouciance. " C'était déjà le gouvernement provisoire. Beaucoup de monde était parti et nous avions pour consigne de garder leur appartement où ils avaient tout laissé. On a essayé de rester mais ce n'était plus possible. Mes parents étaient partis dans de meilleures conditions, mon père étant fonctionnaire. Cela nous avait permis de faire partir quelques meubles et du linge. Les gens se seraient battus pour prendre le bateau ou l'avion, ils abandonnaient leur voiture sur les quais ou à l'aéroport ". Henri Vassalo embarque avec sa fiancée Yolande, infirmière qui était depuis quatre ans en Algérie. " On ne souvient pas du nom du bateau, ni de la date de notre départ. Nous avons voyagé en cabine collective, les hommes et les femmes étaient séparés. Je me souviens qu'il y avait sur le pont, des cages avec des lévriers. Et tous ces gens qui pleuraient. Pour nous, ce fut un voyage ordinaire. Mais on allait vers l'inconnu. Plus de boulot, plus de maison. D'un coup, tu perds ta jeunesse, ton soleil, tes amis ". Après avoir été recensés sur le bateau, ils débarquent à Marseille puis à Richelieu, près de Tours. " L'hiver 62-63 a été terrible. On a crevé de faim et de froid, sans chauffage. Nous étions un peu rejetés. Les colons avaient fait pas mal de conneries, nous avions mauvaise réputation. Pendant six mois, le gouvernement nous a versé un petit pécule ". Comme tant d'autres, Henri et Yolande ont fini par s'en sortir et vivre heureux. Dans le cadre de son travail, Henri est retourné une fois dans le Constantinois, là où il est né. Il n'a tenu que deux mois, ne supportant pas sa position de Français cantonné dans une base et assailli par les souvenirs. " On a cherché à tout oublier. On n'a jamais essayé de rencontrer des Pieds-Noirs. Les Français nous ont coupé la parole. On n'a jamais pu dire les choses. On ne nous croyait pas ".
J.-M. C
La colonisation a donné la nationalité française à Jacky Malléa, né le 10 juillet 1942 à Guelma, au nord-est de l'Algérie, près de la frontière tunisienne, lui dont les ancêtres étaient Maltais. Démobilisé suite aux accords d'Evian après 5 ans d'engagement - " Je m'étais engagé, en décembre 1959, pour pouvoir choisir mon corps et ne pas avoir à porter les armes " - il décide, aidé par un copain pied-noir assureur à Bône (aujourd'hui Annaba), de monter un bureau d'agent d'assurances dans sa ville natale. " On était au tout début du mois de juillet 62. J'étais en train de fixer ma plaque sur la maison quand un copain musulman me demande ce que j'étais en train de faire. Je lui dis que je m'installe comme assureur. Etonné, il me demande : " Tu as l'intention de rester ? ". Etonné à mon tour, car inconscient de la situation réelle, je lui réponds que oui. Alors il me conseille de m'en aller le plus vite possible ". Je te revois dévissant consciencieusement de notre porte d'entrée, la petite plaque de cuivre gravée à notre nom, et la placer dans nos maigres bagages. Pour les billets, je ne me souviens pas si nous avons eu du mal à les avoir. Pour certaines choses, il me reste une espèce de brouillard.
Le propriétaire de la Papeterie rue des, ….. à Marseille, est ne à Oran.. Il avait 22 ans à l'indépendance de l'Algérie, en 1962. Il a connu l'exode des Pieds- Noirs.
"Ma famille a quitté l'Algérie à la Pâques de 1963, raconte-t-il.
Mais dès le 5-juillet 62 - date des émeutes qui ont fait mille morts à Oran, les départs se sont précipités" ajoute-t-il. Originaire de Marseille, sa famille avait une société d'acconage (chargement de navires) sur le port d'Oran. Il se souvient avoir aidé, pendant plusieurs mois, les familles à charger à la va-vite de maigres effets dans les bateaux. " Les gens n'emportaient que les vêtements, l'argent, les bijoux. On n'avait même plus de planches pour faire des caisses."
Henri L… se souvient des nuits passées à dormir quelques heures entre deux chargements, sur des ballots, après avoir ingurgité un mauvais sandwich. " Tous les bateaux de France et de Navarre étaient affrétés à cette époque. Le " Sidi Ferruch " pouvait transporter 800 passagers or, un jour, 1200 personnes sont montées à bord.
Le capitaine ne voulait pas appareiller : " quand j'arrive à Marseille, les autorités me jettent en prison " disait-il. "Allez leur dire ça à eux, lui ai-je répondu en montrant les passagers sur le pont. Il a appareillé."
Pour toutes les familles en partance, l'œuvre de toute une vie s'est effondrée. Henri L.. a gardé le souvenir de cet homme qui, une fois sa voiture déchargée, l'a arrosée d'essence, a craqué une allumette et s'est éloigné sans se retourner. " Tout se déroulait dans un désordre indescriptible. Un jour, ma sœur, qui faisait des études d'infirmière, a aidé une femme à accoucher dans la salle d'attente de l'aéroport. "
La destination était vers le stade Montréal, il y avait deux blindés français, stationnés devant l'usine DEA, et les occupants ne pouvaient ignorer ce qu'il se passait....
J'avais 15 ans et si avec le temps on peut oublier certains faits, ceux là sont gravés à tout jamais."
Didier B
A l'arrivée sur le port de Marseille, certains grutiers exigeaient une somme d'argent en liquide pour le débarquement d'une voiture ou d'un container de meubles. Faute de quoi, une « erreur de manipulation » faisait s’écraser le chargement.
Les voitures étaient très fréquemment visitées et déchargées de leur contenu y compris des jeux et vêtements d’enfants.
Plus tard pendant le fameux hiver 1962 où l’eau gelait aux fontaines, ma mère se vit refuser du charbon. Nous eûmes droit aux meublés sans chauffage. Les recherches de logements effectuées au porte à porte, se terminaient souvent par un refus sec et catégorique empreint d’un dédain ou d’une indifférence hautaine. Après maintes humiliations, il nous fut proposé, un appartement dont le prix du loyer était pratiquement le double de celui inscrit sur la quittance. La différence était payée en espèces bien entendu.
Dans son travail, mon père fut mis en quarantaine pendant deux ans. Sans le connaître, personne ne lui adressa la parole.
Il y eut aussi les insultes dans la cour de l’école « sale Pieds-Noirs », « retourne dans ton pays », « sale arabe » etc... et la surprise ensuite de certains petits camarades métropolitains qui s’étonnaient de ma maison propre et du fait que l’on mange sur une table.
A.Martinez
comme des misérables..., que j’allais être obligé de vivre dans un pays étranger, sans le soleil, en exil, et mes parents, pire encore c'était pour eux parce que c'était comme s'ils mouraient d'une certaine manière... Marseille, de loin, on dirait Oran. Les deux villes ont la même couleur jaune. Et, en plus, toutes les deux elles ont une église sur la montagne. On regarde la France approcher. Tous les gens sur le bateau ont les mêmes yeux, des yeux durs, mais derrière on sent qu'ils ont de l'inquiétude parce qu'ils ne savent pas où le destin va les entraîner... Quand on arrive à la gare Saint- Charles, le train pour Paris vient juste de partir. En une heure de France, deux événements nous ont appris des choses. Le premier, c'est que le taxi (une frégate), trois mille francs il nous a demandé pour la course du port à la gare. Le deuxième, c'est que la SNCF ne donne pas de réductions aux rapatriés, malgré le scandale que mon père a fait au guichet. L'employé, il l’y a répondu: « Les rapatriés, monsieur, on en a rien à foutre ici On est déjà trop nombreux en France »... Alors, on va s'asseoir... On se sent comme détruit de l'intérieur... »
Daniel Saint-Hamont, Tiré du livre "Le coup de sirocco", Fayard, Paris, 1978.
Madame Louise D.
M. Paul D.
« La population nous jetait des pierres. J'ai été humilié et torturé par le FLN. Avertis par des Français des atrocités, des militaires sont venus. Le FLN a fait semblant de nous relâcher. Et nous a repris. Le 26 juillet, un nouvel appel au secours est lancé, l'armée revient et on a été vingt et un à pouvoir monter dans les GMC. Les autres je ne les ai jamais revus. Je suis reconnaissant aux militaires d'être venus nous sauver alors qu'ils n'en avaient pas l'ordre... » M Salah Z.
Bertrand L
Mes parents prévenus sont allés la chercher ainsi que mon oncle invalide de guerre et une soeur aînée de ma mère.
Avant de partir avec une seule valise (sous la protection des militaires quand même) mon père a tout détruit ce qui était dans la maison. "
Marie-Paule T.
Gilbert ne part pas seul, il est avec Angèle, sa fiancée, et ses futurs beaux-parents, transportant juste un peu de linge et des papiers. " Nous avons fait la traversée sur le pont, par terre sur des couvertures. On nous a donné des collations. Des gens pleuraient autour de nous, surtout les plus vieux, de voir s'éloigner la côte. Mais nous, nous avions l'insouciance de la jeunesse et on se disait que l'on ferait notre vie là-bas ". Marseille, Nice, Lyon, Hyères. Loger dans un garage, accumuler les petits boulots, subir le froid et la faim et puis rebondir... Angèle et Gilbert coulent aujourd'hui des jours heureux à Saint-Cyprien, après 50 ans de mariage. " Ça ressemble tellement au village où je suis né ". La maman de Gilbert Casimiro, âgée de 90 ans, vit avec eux, elle aussi rapatriée d'Algérie mais dans de meilleures conditions, étant femme de gendarme.
http://www.lindependant.com/articles/2010-02-08/gilbert-casimiro-on-avait-l-insouciance-de-la-jeunesse-125942.php
L'indépendant Edition du 08 02 2010
http://www.midilibre.com/articles/2010/02/08/PERPIGNAN-Tout-oublier-pour-une-autre-vie-1104530.php5
Le midi libre Édition du lundi 8 février 2010
Mado, sa fiancée, était déjà rentrée en France, au mois de juin. " Les familles faisaient partir d'abord les filles parce qu'une rumeur courait que les musulmans épouseraient toutes les jeunes filles françaises ". Jacky Malléa prend très vite la décision. " Je ne me souviens plus comment j'ai eu mon billet d'avion ; ni pourquoi je suis parti en avion ".
Le 9 juillet, il prend la direction de Bône. Sur la route, un groupe du FLN l'arrête. " Dans ma valise, j'avais un poignard, souvenir de l'armée. Le militaire me le confisque. Je n'en menais pas large. Là, je prends conscience que partir est la bonne décision ". Mais 47 ans plus tard, assis dans sa maison d'Ortaffa, Jacky Malléa ne peut réprimer son émotion et le silence s'installe quelques lourds instants.
" Arraché à ma terre "
" Quand l'avion a décollé, je me suis senti littéralement arraché à ma terre natale. Mais je n'avais pas conscience que c'était définitif ". Il n'a pour tout bien que sa valise, 100 francs de l'époque en poche et son billet d'avion pour Toulouse où l'attend Mado. Mais c'est à Marseille qu'il atterrit. " Il y avait des ordres des ministères pour désorganiser l'arrivée des rapatriés. Un copain qui avait un billet pour Marseille a, lui, atterri à Toulouse. Tous les télégrammes en provenance d'Algérie étaient systématiquement mis à la poubelle... ".
Perdu à l'aéroport de Marignane, Jacky trouve tant bien que mal le moyen de rallier la gare Saint-Charles de Marseille, direction Toulouse. Par les vitres, il découvre cette campagne française si différente de l'Algérie. " Mes questions pendant le voyage, c'était : qu'est-ce que je vais faire maintenant ? J'arrivais en terre étrangère ; longtemps j'ai ressenti cela ".
Mais à Toulouse, c'est sa belle-soeur qui l'accueille : Mado est partie à Ortaffa, où vit sa grand-mère. " C'est où Ortaffa ? ". Le rapatrié expatrié saute dans un train pour Perpignan. " J'ai fait Bône-Ortaffa dans la journée, sans poser ma valise ". I. G.
http://www.lindependant.com/articles/2010-02-08/jacky-mallea-je-voulais-rester-en-algerie-125934.php
L'indépendant Edition du 08 02 2010
Nous nous sommes retrouvés sur les quais dès sept heures du matin. La foule a rapidement grandi derrière nous, sans bousculade, sans pleur, sans cri. Nous avons patienté ainsi jusqu'à midi sous le soleil d'Alger. Les martinets criaient dans le ciel bleu de juin.
Enfin, quelque chose s'est débloqué et doucement nous nous sommes rapprochés du bateau : " l'El Mansour ". Une passerelle menait vers une petite porte de métal située à mi-hauteur de la coque. Nous avons pénétré ainsi dans le ventre du navire.
Comme un signe, les ténèbres effacèrent d'un seul coup la lumière incomparable du ciel d'Alger, puis la pénombre nous livra un étonnant spectacle : une multitude de chaises longues installées à la hâte et au hasard de la cale. Ironique, ce bric à brac de bois et de toile habituellement présent sur les lieux de vacances nous narguait, ajoutant un caractère grotesque à la situation.
Le bateau s'éloigna du quai. Une ambiance lourde et silencieuse régnait sur le pont. La baie d'Alger diminuait, semblait se tasser, pour moi c'était la première fois… En souriant, tu m'as désigné le large : " maintenant, c'est là bas qu'il faut regarder… ". Mais je ne voyais que l'horizon… Derrière nous, le bateau ouvrait une large blessure d'écume blanche dans une eau de mer immensément bleue, profondément bleue. Ce cordon ombilical nous relia longtemps à la terre puis tout devint liquide autour de nous.
A partir de ce moment, notre bateau entama un mouvement puissant et continu de haut en bas et de bas en haut. Alors, les visages devinrent blancs et tous regagnèrent leur place dans la cale. Nous étions placés à l'étrave. Il ne fallut pas longtemps pour que cette danse entre la mer et l'El Mansour ne se fasse impitoyable. Au début, il nous restait suffisamment de volonté et de force pour tenter de nous déplacer, de nous isoler en franchissant les chaises longues. Mais sur ce bateau surchargé, l'espace entier devint rapidement innommable. Nous avons pataugé ainsi dans l'ordure et les vomissures durant toute la traversée. De temps à autre, je voyais passer au-dessus de moi, sur les poutrelles d'acier du navire, des rats… Habitants du lieu, ils circulaient ainsi en toute quiétude, nullement incommodés. Au fil des heures, l'odeur d'huile provenant des machines se fit écœurante. Quelques bouteilles vides abandonnées sous les sièges roulaient sans arrêt au rythme du navire, ajoutant à l'insupportable mal de mer. La coque résonnait sous les vibrations continues des moteurs. Pendant de longues heures, l'étrave du bateau plongea et replongea encore.
Au matin, après cette affreuse nuit, nous avons débarqué à Port-Vendres, épuisés et sales. Sur les quais, je crois bien que l'on m'a tendu un café mais j'ai fait non de la tête. N'ayant connu que l'Algérie, je fus époustouflé par la verdure de la campagne environnante bien qu'il s'agisse du sud de la France. J'étais curieux de ce pays sensé être le mien.
Ce que j'ignorais encore c'est que nous n'avions aucune importance, et que notre exode, à nous, ne compterait pas. Nous allions connaître le temps de l'indifférence et du mépris, puis viendrait celui de la culpabilité pour le mal que nous aurions fait en naissant et en vivant là bas…
Quelques années plus tard, alors que je visitais le musée de la marine de Toulon, une maquette de bateau élégamment placée sous une vitrine attira mon attention. Une petite étiquette indiquait : " El Mansour ". Je n'oublierai jamais le nom de ce bateau.
Tu n'es plus de ce monde, mais je garde toujours près de moi la plaque de cuivre oxydée par le temps, sur laquelle on distingue encore notre nom. Souvenir dérisoire que tu dévissas de la porte de notre petit appartement de Belcourt.
Parfois, je me demande si, de l'autre coté de la mer, sur le bois de notre porte, il en reste encore la trace, comme l'empreinte d'un passé heureux.
http://www.demarcalise.org/
Quel souvenir conservez-vous de Port-Vendres ?
C'est d'abord celui d'une attente déçue mais pas seulement. Nous attendions l'arrivée de notre voiture, le seul bien qui nous restait. Cette modeste berline, une Aronde, était chargée affectivement de tous les moments passés en famille et des paysages que nous avions traversés à son bord. C'était comme un petit bout d'Algérie et d'enfance. Le temps de l'attente a été aussi un moment de rêverie : à la vue des " cadres " sur le port, je me prenais à espérer que l'un deux contenait mes trésors abandonnés. La mer vue de l'autre côté, les bateaux au nom de villes d'Algérie, l'ambiance d'un port méditerranéen avaient un charme qui alimentait mes pensées entre songe et réalité. Je voyais mes parents parler, rire, s'animer, mais la question du retour de mon père s'est posée au détour d'une conversation avec un ami Oranais. Je souviens d'avoir ressenti ces paroles comme une menace. J'ai écrit tout cela dans " l'Algérie à l'ombre de Maria " (1)
Les souvenirs de votre arrivée ont-ils orienté votre vie ?
J'ai écrit ce récit d'enfance après la mort de ma mère, sans savoir qu'il deviendrait un livre. C'était peut-être pour lui rendre hommage et donner une voix aux perdants de l'histoire. Il est en effet question dans ce récit du silence des parents que l'on retrouve dans bien d'autres contextes historiques. J'ignore dans quelle mesure les circonstances de mon arrivée en France ont guidé mon action mais je pense avoir une sensibilité particulière à l'égard de tous les exilés et de tous les migrants.
À l'école, avez-vous ressenti " l'humiliation " d'être traités comme une immigrée ?
Après un premier accueil glacé en CM2, je n'ai pas subi de rejet ni d'humiliation en relation avec mon origine mais j'ai hérité, je crois, d'une sorte de prudence dans mon approche d'autrui comme si j'avais à " préparer " l'autre avant d'entrer en relation.
(1) Luce Rostoll est l'auteure de l'ouvrage " l'Algérie à l'ombre de Maria " paru aux Nouvelles éditions Loubatières".
" Jamais je n'aurais pensé qu'un jour notre histoire susciterait quelque intérêt. De la plus tendre enfance, je voyais, de l'appartement où nous habitions, les bateaux s'éloigner ou arriver dans le port d'Alger. Le Kairouan était reconnaissable entre tous. J'ai aussi le souvenir des promenades le dimanche sur les quais du port, où débarquaient les marchandises, où on entendait l'équipage parler en langues étrangères. Jamais, je n'avais pensé qu'un jour je serais obligée de traverser la mer. Je suis parti le 19 juin 1962 avec pour tout bagage ma brosse à dents.J'allais avoir 21 ans et j'étais déjà journaliste à L'Echo d'Alger. Ma famille était en Algerie depuis cent trente ans et mon père était une figure politique importante : sénateur, maire... Il était pour l'Algérie française mais c'était un liberal plutôt un homme de gauche. Sur
le bateau, en quittant Alger, je me suis juré de ne jamais m'engager en politique et de toujours combattre pour le
triomphe de la vérité. le plus choquant dans notre histoire, ce sont les mansonges et les calomnies qui ont été utilisés
contre nous pour nous faire partir. C'est une blessure immense pour nous qui avions un amour profond de la France.
Cet automne, Catherine Camus, qui a mis entre parenthèses sa carrière d'avocate pour veiller sur l'exploitation qui est faite de l'oeuvre de son père, réédite en poche « Chroniques algériennes », un recueil des articles sur la situation en Algérie publiés par le journaliste Albert Camus entre 1939 et 1958. « Quand le livre est sorti pour la première fois, en 1958, il y a eu un seul article dans la presse, parce que sa position dérangeait, confie Catherine Camus. Les Algériens et les pieds-noirs ont été trompés, les accords d'Evian ont livré le pays à un parti unique. Mais je redoute les réactions. Cela reste très à vif au sein des deux communautés. » Face au débat actuel sur la torture pratiquée par l'armée française en Algérie, Catherine Camus dit éprouver « un sentiment de malaise » . « La torture est abominable. Il était indispensable d'en parler, mais j'ai l'affreuse impression que le thème vire à l'effet de mode, tandis que les exactions du FLN restent un tabou chez les intellectuels, qui n'ont pas le courage de reconnaître aujourd'hui que l'indépendance a été un gâchis. »
Aujourd'hui, le PDG du Seuil s'indigne que l'on puisse faire le lien entre les pieds-noirs et la torture. « Les pieds-noirs se sont contentés d'exploiter l'Algérie au bénéfice de la métropole. On ne peut pas leur faire porter la responsabilité des exactions de l'armée française. Ce qui m'intéresse dans le débat actuel sur la torture, c'est le pourquoi du passage à l'acte. Si c'est juste pour dire que l'armée coloniale a torturé, cela n'a aucun intérêt. » Claude Cherki revendique un regard lucide sur la communauté des pieds-noirs d'Algérie. « La société coloniale était stratifiée en classes sociales qui ne se mélangeaient pas. Personnellement, je ne fréquentais ni les juifs pieds-noirs pauvres ni les enfants musulmans. Le seul ciment commun était l'attachement profond à la France. Mais cette société n'a pas apporté que des choses négatives. Il faudra aussi un jour parler des réalisations positives de la colonisation de l'Algérie. »
Et puis, c'est arrivé le 11 septembre 1962. Je n'ai pas vu la côte s'éloigner, j'étais à la projection d'un film (il me semble que c'était " A chacun son destin "). J'ai aussi le souvenir de m'être perdue dans les couloirs du paquebot où j'avais peine à me repérer. Ce voyage a été très important dans ma vie : il y a toujours un avant et un après 1962. J'ai fait le trajet inverse en mai 2006. Je me suis réveillée très tôt, de ma couchette, j'ai soulevé le rideau du hublot, et j'ai ressenti un bonheur intense en voyant le soleil se lever à l'horizon sur une mer très calme, j'avais comme l'impression de me trouver chez moi, entre deux rives. "Anne-Marie Jory-Lafon
Témoignage sur www.frenchlines.com
« Le souvenir le plus terrifiant de mon enfance est la fusillade de la rue d'Isly, le 26 mars 1962, à Alger, quand l'armée française ouvre le feu sur la foule qui manifeste pacifiquement. » Ce jour-là, Jean-Noël Pancrazi a 13 ans. Il écoute avec ses parents la retransmission du drame à la radio. La famille vit à Sétif, où le père est comptable. « J'entends encore cette voix sortie d'on ne sait où qui criait " Cessez le feu ! cessez le feu ! " se rappelle l'écrivain. Ce qui s'est passé le 26 mars symbolise tout ce qui est arrivé par la suite en Algérie : une absurdité sanglante. On ne sait toujours pas pourquoi l'armée a tiré. C'est aussi ce jour-là que mes parents ont compris que le gouvernement les avait abandonnés. » En juillet, la famille Pancrazi prend le bateau pour Port-Vendres. « Mes parents étaient déboussolés, mon père surtout. Il avait 51 ans, il ne connaissait pas la métropole. Il errait dans les rues à la recherche d'un travail. Il ne s'est jamais acclimaté. Cela a été un choc pour moi. » Jean-Noël Pancrazi se réfugie dans les études. « Il fallait que je montre que j'avais ma place. Au lycée, on n'aimait pas les pieds-noirs. Il faudra un jour expliquer que les pieds-noirs ont été balayés par l'Histoire. » Si Jean-Noël Pancrazi est devenu écrivain, c'est en partie à cause de l'Algérie. « Ecrire me permet d'anesthésier les souvenirs les plus douloureux. » Dans « Madame Arnoul », il évoquait son enfance à Sétif et son ami d'école, Mohammed Khair-Eddine. « J'espérais retrouver sa trace en écrivant ce livre. Il était brillant à l'école, j'ai toujours espéré qu'il ait joué un rôle positif après l'indépendance. L'exil est une blessure, mais aussi une chance pour un écrivain. C'est pourquoi je ne veux pas retourner en Algérie. J'ai peur que cela paralyse mon imaginaire. Pourtant, ma terre, c'est là-bas. »
2. « On vivait à Diar-es-Saada (La Cascade), une cité populaire d'Alger jouxtant les quartiers arabes. Mon père y avait acheté en 1960 un appartement à crédit. De retour en France, le Crédit foncier s'est entêté à lui réclamer le remboursement du prêt pendant plusieurs années.
On a attendu la mutation de mon père barricadés tout un mois dans notre appartement. »
3. « On a embarqué sur l'"El-Djezaïr", le 24 juillet, avec quatre valises. On est allé jusqu'au port dissimulés dans une ambulance, pour échapper aux enlèvements. Sur le bateau surchargé, on a attendu des heures parce que le capitaine ne voulait pas hisser le drapeau algérien. Mon père a jeté les clés à la mer. Avant de débarquer à Port-Vendres, un couple de vieux s'est suicidé en se jetant sur l'hélice. »
4. El Djezaïr aujourd'hui.
5. « A Versailles, où mon père avait été muté, on s'est retrouvés dans une chambre de 7 mètres carrés. On y a passé six mois. On avait l'impression d'être dans un pays étranger. Un jour, on a voulu manger des châtaignes. On les a mises sur le poêle sans les entailler. Ça a pétaradé. On s'est tous jetés à plat ventre, par réflexe. La vie a redémarré. L'année suivante, mes parents nous ont fait une petite soeur. »
« Mon village natal s'appelait "Le col du dimanche", sur les contreforts du Haut-Atlas. » Jean Montaldo a 21 ans quand il quitte l'Algérie en 1962. « Depuis trois ans, j'étais journaliste à La Dépêche quotidienne d'Algérie, raconte-t-il. Mon père, qui était sénateur, m'y avait fait entrer comme stagiaire. Je couvrais les attentats, les massacres. On se relayait jour et nuit pour noter dans un grand cahier le lieu des attentats, avec le nombre précis de morts et de blessés. » Et tous les soirs, Jean Montaldo se rend à la morgue pour vérifier et publier ensuite la liste des victimes. « C'était comme assister à un suicide collectif. Cela m'a psychologiquement détruit. » En juin, son père comprend qu'il faut partir. Il lui trouve un billet sur un cargo en partance pour la France. « En arrivant sur le port, j'ai brûlé ma voiture. Sur le pont, j'ai regardé la côte s'éloigner et j'ai pleuré. » Jean Montaldo s'installe à Montpellier, où il retrouve d'autres rapatriés. « On ne réalisait pas, on était des morts-vivants. Nos parents étaient en dépression nerveuse. J'ai vu beaucoup de "vieux" mourir de chagrin. » Sans le sou, Jean Montaldo tente de survivre. « Pendant l'été 1962, j'ai fait tous les thés dansants du Claridge, je faisais danser les dames. J'avais la rage de réussir, ce qui explique ce que je suis devenu aujourd'hui : rien ne me fait reculer. » Jean Montaldo n'a jamais voulu retourner en Algérie. « Le FLN, pour asseoir son pouvoir, a détruit ce que nos pères avaient créé. De ce que nous avons bâti il ne restera rien après notre mort. Alors il faut au moins sauver la vérité. » Et d'expliquer : « Nous avons été manipulés par la classe politique. D'abord par la gauche, qui a créé le FLN en se lançant dans une guerre délirante, avec des moyens indignes tels que la torture. Et ensuite par la droite, qui nous a sacrifiés. Nous nous sommes réconciliés avec la France au prix de notre silence. »
- Le Point publié le 20/01/2007 http://www.lepoint.fr/archives/article.php/61482
Aujourd'hui, je n'ai pas de rancœur. Il reste bien sûr des souvenirs, une fierté pour ce que nous avons accompli là-bas, mais
aussi une immense tristesse silencieuse car nous n'avons pas su - et c'est encore le cas
aujourd'hui - nous faire entendre. Je me sens comme un exilé de l'intérieur
Le Figaro Magazine - Samedi 28 janvier 2010 " 50 Ans après, les Pieds-Noirs. "
Le Point publié le 20/01/2007 http://www.lepoint.fr/archives/article.php/61482
Ma mère était d'une famille Pieds-Noirs de l'Oranais et mon père était venu s'installer en Algérie
où ils se sont rencontrés. J'avais 3 ans quand nous sommes partis en 1962. Etre pied-noir, c'est une identité, une
fierté, un regrd particulier sur l'histoire et la politique.
Même si j'étais très jeune quand nous sommes partis, cela fait partie de mon histoire et c'est certainement à la
source de mon engagement politique. Toute mon enfance a été bercée de ces discussioni sur l'Algérie, où je
suis retourné une fois, pour accompagner mes parents.
Quand l'Histoire fait irruption dans votre vie et celle de votre famille, quand vous la subissez,
vous avez à votre tour envie de l'écrire. Je me suis engagé au Parti républicain, donc à l'UDF.
Aujourd'hui, je suis à l'UMP.Je ne me suis jamais senti gaulliste
même si j'ai du respect pour la personne du Général.
Le Figaro Magazine - Samedi 28 janvier 2010 " 50 Ans après, les Pieds-Noirs. "
Je suis d'origine espagnole par mon père et italienne par ma mère.
J'avais 11 ans quand je suis arrivé en métropole. Pour moi, et sans doute pour ceux de ma génération, le souvenir
essentiel de cette période d'enfance en Algérie, c'est la guerre. A Oran, elle est arrivée vers 1958-1959. J'ai vécu enfant
quatre années de violence extrême, surtout la dernière. J'ai enjambé des cadavres, vu des gens tirer dans la rue,
des attentats, le sang couler... Ce sont des événements constifutifs d'une vie. Ça vous aide à surmonter certaines
difficultés de l'existence. Etre Pied-noir, c'est vivre un double exil. Là-bas, en Algérie, on ne rêvait que de la France et
lorsque nous y sommes arrivés, chassés par la guerre, nous avons réalisé que ce n'était pas notre pays non plus. Encore
aujourd'hui, le fait de ne pas avoir vraiment de terre originaire, cette question du pays impossible, donne de la
distance et une certaine liberté. De la force aussi.
Le Figaro Magazine - Samedi 28 janvier 2010 " 50 Ans après, les Pieds-Noirs. "
Je suis né à Oran en 1953. Neuf ans plus tard, j'embarquais sur le Ville de Bordeaux, à destination de Marseille, en laissant Santa Cruz, la Vierge protégeant Oran, derrière moi. J'ai un souvenir précis de cet instant.
Une femme me dit : " Garde bien cette image car tu ne reverras plus Santa Cruz. " Ces événements ont fait de moi un Français pas comme les autres. Jai vécu dans une nostalgie douce en entretenant le souvenir heureux d'une Algérie paisible, même si les deux dernières années ont été dures. Mon grand-père a été assassiné alors que ma famille était arrivée au début du XIXe. Nous sommes devenus des déracinés avec une certaine acrimonie contre la France et de Gaulle. Nous étions désireux de retrouver la chaleur, le mélange culturel et l'ambition de construire un pays neuf que nous avions là-bas.
En 2OO4, je suis retourné en Algérie. J'ai revu les vignes de mon grand-père, abandonnées. J'ai réglé ses congés payés à un de ses anciens ouvriers qui me les réclamait ! J'ai réalisé que mon histoire d'amour avec l'Algérie est intacte.
Le Figaro Magazine - Samedi 28 janvier 2010 " 50 Ans après, les Pieds-Noirs. "
Nous sommes arrivés en 1965, j'avais 10 ans. Mon père était directeur d'école et ma mère institutrice. C'était des gens de Gauche qui avaient cru dans la révolution algérienne, dans une société multiculturelle multiethnique... Ils se sont vite rendu compte que ce n'était pas tenable. Nous nous sommes installés en région parisienne et ça a été très dur.
Plus dur sans doute que pour ceux qui se sont installés dans le Sud à cause du climat et des conditions de vie. Certains n'ont pas supporté : j'ai perdu rapidement ma grand-mère et deux de mes oncles. On vivait à quatre dans 17 mètre carrés. A l'école, on n'était pas bien vus : on se moquait de notre accent, on était regardés de travers, on était des pieds- noirs, donc forcément riches alors qu'on n'avait rien. Ça a duré deux ans. Après ça s'est tassé, on a été un peu oubliés. Il faut dire qu'on a pris sur nous, on ne l'a pas ramené. Etre Pieds-Noirs, ce sont des souvenirs, des racines, une histoire. Je ne dirais pas que Ça m'a construit mais ça existe. De plus en plus en vieillissant.
Le Figaro Magazine - Samedi 28 janvier 2010 " 50 Ans après, les Pieds-Noirs. "
Mis en ligne le 10 sept 2010 - modifié le 06 mars 2012