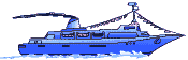Le " rapatriement " des Français d'Algérie était-il prévisible ? A-t-il été prévu, préparé et organisé, ou a-t-il été seulement subi par l'État métropolitain ? Les " rapatriés " européens et les " réfugiés " musulmans ont-ils été traités de manières différentes en fonction de leurs origines ? Telles sont les questions auxquelles je me propose de tenter de répondre, à partir de lectures anciennes ou récentes, mais sans prétendre avoir fait une enquête exhaustive.
Le rapatriement était prévisible
Le rapatriement était prévisible, puisqu'il avait été prévu, dès avril 1956, par Raymond Aron. Dans la première Dans la deuxième partie de sa brochure, complétée et publiée en juin 1957, Raymond Aron démontrait méthodiquement l'impossibilité de l'intégration, mais s'exprimait avec plus de nuances sur la nécessité du rapatriement : " La minorité française pourrait-elle rester dans la République algérienne ? Nul ne peut répondre catégoriquement oui ou non [...]. La République algérienne aura besoin de techniciens pendant une longue période, elle n'aura pas besoin de petits fonctionnaires, de ceux que les Algériens pourront aisément remplacer. Le rapatriement de ceux des fonctionnaires qui, comme en Tunisie et au Maroc, n'ont plus de place dans une Algérie gouvernée par des Algériens doit être organisé et financé par le gouvernement de la métropole. Les autres Français, ceux qui, en raison de leur qualification, resteront utiles à l'Algérie, pourront-ils s'adapter aux conditions nouvelles, y trouveront-ils la sécurité individuelle, le respect de leurs droits ? Je ne sais et nul ne peut l'affirmer. Mais qui s'imagine que le million de Français qui est 1/9 de la population actuelle, qui sera 1/18 de la population dans vingt-cinq ans, continuera de gouverner, d'administrer, de gérer le pays [2] ? "
Le rapatriement a-t-il été prévu et préparé par le gouvernement français ?
Aussi longtemps qu'aucun gouvernement n'osa remettre en question le principe de la souveraineté française sur l'Algérie, le problème du rapatriement ne pouvait pas se poser, et moins que jamais quand la politique d'intégration sembla avoir été définitivement adoptée pendant l'été 1958. Un seul transfert de population semblait envisageable dans cette perspective : l'intensification de la migration des " Français musulmans " à la recherche d'emploi dans la métropole.
Mais, dès que le général de Gaulle eut défini sa nouvelle politique d'autodétermination dans son discours du 16 septembre 1959, il fut obligé d'envisager l'éventualité d'un rapatriement des Français d'Algérie en cas de victoire de " la sécession, où certains croient trouver l'indépendance ", en rupture totale avec la France : " Il va de soi que dans cette hypothèse, ceux des Algériens de toutes origines qui voudraient rester Français le resteraient de toute façon, et que la France réaliserait, si c'était nécessaire, leur regroupement et leur établissement. " Toutefois, il ne précisait pas si ce transfert de population s'effectuerait dans le cadre d'un partage de l'Algérie (qui permettrait à la France de garder un accès aux richesses du Sahara conservées sous sa souveraineté), ou à travers la Méditerranée.
Cependant, de Gaulle espérait éviter cette éventualité en soutenant, à défaut d'une impossible " francisation ", la solution qu'il jugeait celle du bon sens : une Algérie autonome associée à la France dans le cadre de la Communauté (créée à cette intention par la Constitution de 1958) ; puis, quand celle-ci se fut volatilisée pendant l'été 1960, une " République algérienne " coopérant avec la France. Celle-ci aurait pu être construite avec tous les Algériens de toutes origines qui auraient voulu y participer, de Gaulle refusant d'admettre les prétentions du FLN à être le " Gouvernement provisoire de la République algérienne " jusqu'en novembre 1960 [4]. Mais les manifestations musulmanes de décembre 1960 le convainquirent que la paix ne pourrait pas être rétablie sans l'accord du FLN, et le décidèrent à négocier avec celui-ci l'avenir de l'Algérie et des relations franco-algériennes, malgré l'opposition de la masse des Français d'Algérie et d'une proportion non négligeable des " Français musulmans ", manifestée par la carte du NON au référendum du 8 janvier 1961 [5].
Ces négociations, annoncées par les deux parties en mars 1961, s'engagèrent difficilement. Après un premier ajournement décidé par le FLN, de Gaulle recourut à la menace d'un dégagement unilatéral, si aucun accord avec celui-ci n'était possible, dans sa conférence de presse du 11 avril 1961. " Si les populations algériennes veulent, en définitive, se laisser mener à une rupture avec la France, telle que nous n'ayons plus aucune part à leur sort, nous n'y ferons aucune opposition. Naturellement, nous cesserons aussitôt d'engouffrer dans une entreprise désormais désespérée nos ressources, nos hommes, notre argent. Nous inviterons à quitter les territoires intéressés ceux de nos nationaux qui s'y trouveront, et qui courront vraiment trop de risques. Inversement, nous renverrons chez eux ceux des Algériens vivant en France qui cesseraient d'être Français. Dans cette hypothèse, nous tirerons les conséquences de la volonté d'appartenir à la France qu'exprimeront très probablement certaines populations dont, d'ailleurs, l'emplacement est d'avance à peu près connu. Celles-là, aussi, ont le droit de disposer d'elles-mêmes tout comme les autres, et elles ne devraient rien, au départ, à une unité nationale dont elles ne feraient pas partie, à une souveraineté algérienne qui n'a jamais existé, à un État algérien qui serait encore à naître. Ces populations, nous aurions donc d'abord à les regrouper en assurant leur protection. Et ensuite ? Ensuite, on verrait bien [6] ! " Les négociations, officiellement engagées à Évian le 20 mai 1961, ayant achoppé sur leur statut, ainsi que sur l'unité de l'Algérie et du Sahara, le président de la République, recevant les parlementaires le 27 juin à l'Élysée, leur déclara : " Si nous n'arrivons pas à un accord, il faudra faire le partage, mettre d'un côté les uns, de l'autre les autres. " Interrogé sur la durée de ce partage, il précisa : " Il faudra le faire, au moins provisoirement [7]. " Ainsi de Gaulle continuait d'envisager, en cas d'échec des négociations avec le FLN, deux solutions alternatives, qu'il fit étudier et préparer.
Ces sombres prévisions allaient contre les pronostics optimistes du Secrétariat d'État aux rapatriés, créé lors du remaniement ministériel du 24 août 1961, " en retard d'une décolonisation " selon Alain Peyrefitte. Cette administration, confiée au député gaulliste Robert Boulin, fut chargée d'appliquer la loi discutée par le Parlement d'octobre à décembre 1961 et publiée au Journal officiel du 26 décembre 1961, " relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ". La " loi Boulin " fixait les principes d'une action de l'État visant à aider la réinstallation en métropole des " Français ayant dû ou estimé devoir quitter par suite d'événements politiques " un territoire auparavant placé sous la souveraineté de la France, et lui en donnait les moyens législatifs et budgétaires. Le dernier alinéa stipulait : " une loi distincte fixera, en fonction des circonstances, le montant et les modalités d'une indemnisation en cas de spoliation et de perte définitivement établies des biens " appartenant aux rapatriés [10].
Le Secrétariat d'État prévoyait d'accueillir et de réinstaller en cinq ans 100.000 personnes actives, soit 350.000 personnes avec leurs familles (respectivement 20.000 et 70.000 par an). Cette prévision était suffisante pour les futurs rapatriés de Tunisie, du Maroc, d'Égypte ou d'ailleurs, mais nullement pour ceux d'Algérie qui seraient beaucoup plus nombreux selon Alain Peyrefitte. Celui-ci craignait que le triomphe des révolutionnaires algériens ne provoquât une " grande peur " chez les Français d'Algérie et chez les Français musulmans engagés militairement ou politiquement à leurs côtés, ainsi que chez leurs employés musulmans. Si leur absorption par la métropole lui semblait économiquement possible, il persistait à juger la solution du partage moralement préférable.
Or, les négociations avec le FLN avaient secrètement été renouées en novembre 1961. Le 8 décembre, Alain Peyrefitte constata que de Gaulle ne soutenait plus son option, et que celui-ci n'attendait pas plus de 100.000 ou 200.000 rapatriés (ceux qui profitaient directement du régime colonial). Il lui confirma néanmoins son pronostic d'un million de rapatriés si l'Algérie était remise au FLN, et répéta que la formule " de Dunkerque à Tamanrasset " serait réduite à son premier terme. Il proposa pourtant d'interrompre la publication de son livre ; mais le général refusa parce que celui-ci pouvait encore servir comme moyen de pression dans les négociations, et lui envoya un mot de remerciement quand elles furent sur le point d'aboutir en février 1962 [11].
Après les accords d'Evian : le rapatriement inutile et indésirable ?
Les négociations, ayant été débloquées du côté du FLN par la crainte de l'OAS, aboutirent à l'accord préliminaire des Rousses, le 18 février 1962, puis aux accords d'Évian [12] dont les 93 pages furent signées par les représentants du gouvernement français et du GPRA (non reconnu officiellement comme tel) (Krim Belcacem seulement pour le GPRA Ndlr). Ces accords proclamaient des garanties de la sécurité des personnes et des biens qui semblaient rendre inutile et indésirable la préparation d'un rapatriement massif. Ces garanties étaient de deux sortes : les unes générales, les autres réservées à une certaine catégorie de la population algérienne.
Les garanties générales comportaient : le cessez-le-feu à compter du 19 mars 1962 à midi, suivi par la libération de tous les prisonniers des deux camps, l'impunité pour tous les actes de violence commis avant cette date, l'immunité pour toutes les opinions émises jusqu'au référendum d'autodétermination, la liberté de circuler entre l'Algérie et la France (avec une carte d'identité), celle de vendre ses biens et d'en transférer la valeur hors d'Algérie, et l'absence d'expropriation sans une juste et préalable indemnisation. De plus, l'aide que la France proposait à l'Algérie au titre de la coopération devait être conditionnée et proportionnée au respect par celle-ci des intérêts français. Enfin, le maintien d'une présence militaire française pendant plusieurs années était également susceptible de rassurer les Français d'Algérie.
Des garanties particulières étaient réservées aux " citoyens de statut civil de droit commun ", c'est-à-dire aux citoyens français à part entière, soumis à toutes les lois françaises y compris le code civil, quelles que soient leurs origines (Français de souche ou naturalisés, y compris quelques milliers d'origine musulmane). Ceux-là devaient bénéficier pendant une période transitoire de trois ans après l'autodétermination d'une double nationalité, leur permettant d'exercer les droits civiques algériens en Algérie avec une représentation proportionnelle à leur nombre et la garantie de leurs droits civils et culturels, tout en conservant leur nationalité française en France, avant de choisir entre la nationalité algérienne et le statut de ressortissant étranger défini par une convention d'établissement négociée entre les deux gouvernements.
En revanche, aucune garantie particulière n'était prévue pour les " citoyens de statut civil de droit local ", c'est-à-dire les citoyens " français musulmans " qui avaient conservé le bénéfice de leur statut personnel coranique, ou coutumier, en vertu de la loi du 4 février 1919 et de l'ordonnance du 7 mars 1944. Ils étaient destinés à perdre leur nationalité française pour devenir citoyens algériens à la suite du référendum organisé en Algérie pour ratifier les accords d'Évian dans un délai de 3 à 6 mois après ceux-ci. Ils pouvaient pourtant la conserver en quittant l'Algérie pour s'établir en territoire français et souscrire une " déclaration recognitive de nationalité française " qui impliquait la renonciation au statut personnel musulman, ou coutumier, et qui pouvait être refusée, selon l'ordonnance du 21 juillet 1962. C'était un retour à la pratique de la " naturalisation " individuelle définie par le Sénatus-consulte du 14 juillet 1865, et l'abrogation de la " citoyenneté dans le statut " reconnue par l'ordonnance du 7 mars 1944. De plus, les citoyens " français musulmans " pouvaient comme les autres Français d'Algérie demander à bénéficier de la loi Boulin ; mais les formalités étaient difficiles pour la plupart d'entre eux qui ne savaient pas lire ni écrire le français. Cependant, un communiqué du ministère des Armées, publié dès le 22 février 1962, avait annoncé qu'une opération de recasement en métropole des personnels militaires ou auxiliaires libérés de leur contrat [13] qui désireraient s'y installer serait " étudiée et préparée méthodiquement " par une commission interministérielle, mais la plupart des supplétifs licenciés sur place n'avaient pas demandé à en bénéficier.
Ainsi, les cadres juridiques permettant d'organiser un rapatriement massif avaient été prévus, mais leur mise en œuvre n'était pas souhaitée par le gouvernement de la France, qui avait obtenu du FLN les garanties permettant d'espérer le maintien en Algérie de la plupart de ses ressortissants et des Algériens engagés dans son camp, et qui ne voulait pas miser sur l'échec des accords d'Évian. La violation des accords d'Evian et le rapatriement inévitable
L'échec des accords d'Évian est très souvent imputé à l'OAS. Sa part de responsabilité est évidemment considérable, mais elle n'est pas exclusive d'autres responsabilités qu'il convient de rechercher sans a priori. Non moins importantes sont les responsabilités du FLN, de l'ALN, et des groupes armés qui s'en réclamaient à tort ou à raison. Il est vrai que le FLN a commencé par interdire toute riposte ouverte aux provocations de l'OAS, pour ne pas faire son jeu en obligeant l'armée française à intervenir. Mais il eut vite recours (de préférence aux attentats qui eurent parfois lieu) à des enlèvements suivis d'assassinats, qui visaient d'abord sélectivement les membres de l'OAS, mais qui s'élargirent en une chasse à l'Européen dont nul ne pouvait se croire à l'abri, même dans les campagnes où l'OAS n'était pas particulièrement active. En même temps, l'ALN y multiplia les actes arbitraires de réquisition, taxation, rançonnement, et par endroits d'enlèvements et de massacres d'anciens supplétifs musulmans de l'armée française. En témoignent les rapports des autorités militaires et civiles et les déclarations de membres du gouvernement français, mais aussi l'accablant constat dressé par les membres du groupe FLN de l'Exécutif provisoire dans leur lettre de démission adressée au GPRA le 27 juin 1962 : " Les enlèvements de compatriotes ou d'Européens se multiplient ; les occupations abusives d'appartements, de fonds de commerce, les vols de voiture, de camions-citernes, de véhicules de la Croix-Rouge internationale, la levée de dîmes sur les colons européens, concrétisent l'anarchie qui s'est établie au sein de la hiérarchie organique [du FLN-ALN]. Ces atteintes à l'ordre public, qui déjà remettent en cause les prescriptions des accords d'Évian, risquent, au lendemain du référendum, de se généraliser au point de tout rompre, et même de provoquer l'intervention de l'armée française. Tout cela, aggravé par le départ massif depuis un mois de plusieurs milliers de cadres européens, dont l'impossibilité de remplacement rapide crée une paralysie sévère de la vie administrative et économique, compliquant l'état anarchique déjà existant [15]. "
Ces craintes furent confirmées par la suite des événements. Après quelques jours d'euphorie entre le référendum d'autodétermination et la proclamation de l'indépendance, l'impuissance de l'Éxécutif provisoire (désarmé par la désertion de la " force locale " au profit des wilayas) et l'absence d'une direction politique reconnue par l'ensemble du FLN-ALN précipitèrent l'Algérie dans une crise profonde. L'anarchie générale facilita les enlèvements et les assassinats d'Européens à caractère vengeur, raciste ou crapuleux. La surenchère patriotique dans la lutte pour le pouvoir multiplia les arrestations et les massacres de " harkis " et autres Algériens compromis avec la France. Le FLN, désintégré, oublia tout à la fois ses engagements des accords d'Évian (qu'il avait secrètement désavoués en les qualifiant de " plate-forme néo-colonialiste " dans son programme de Tripoli en mai 1962), les promesses qu'il avait faites aux Français d'Algérie depuis la proclamation du 1er novembre 1954, et ses offres de pardon aux Algériens fourvoyés dans le camp français [16]. Il fallut de longs mois, même après la formation du gouvernement d'Ahmed Ben Bella le 29 septembre 1962, pour rétablir un minimum de sécurité. De tels faits alimentèrent la " grande peur " prévue par Alain Peyrefitte.
La responsabilité du gouvernement français a également été mise en cause par ses adversaires, qui lui reprochèrent non seulement d'avoir abdiqué la souveraineté de la France en Algérie, mais de n'avoir pas respecté ou fait respecter les garanties des accords d'Évian, et de n'avoir pas suffisamment prévu et préparé l'exode provoqué par leur violation. Même si la prudence s'impose avant d'avoir pu étudier dans les archives la série complète des délibérations et des décisions des autorités, il faut tenter de faire le point à partir des témoignages publiés, qui se multiplient depuis peu. Ceux-ci montrent que les responsables de la politique gouvernementale et de son exécution sont loin de faire front commun contre les accusations qui les ont visés.
Le gouvernement n'a pas réussi à imposer à tous le respect du cessez-le-feu et des garanties de sécurité. Ce n'est pas faute d'avoir fait tout son possible contre l'OAS, dans la mesure où il a été obéi par ses subordonnés. Mais il lui a été reproché de ne pas avoir manifesté le même zèle contre les représailles du FLN, et même d'avoir sanctionné des officiers qui tentaient d'arrêter les auteurs d'enlèvements [17]. La libération des personnes enlevées relevait normalement des commissions mixtes de cessez-le-feu.
La concentration du dispositif militaire sur les grandes villes eut pour effet d'abandonner l'intérieur du pays à l'ALN, alors que, selon les accords d'Évian, ses unités auraient dû se stabiliser dans leurs régions d'implantation, et ses membres se déplacer seuls et sans armes en dehors. L'armée française réagit d'abord par la force aux violations de cette clause. Mais lors du conseil des ministres du 25 avril, le ministre des Affaires algériennes Louis Joxe, après avoir affirmé que la situation dans le bled était calme, dut reconnaître que " en réalité, nos troupes sont consignées dans leurs casernes, tandis que l'ALN, qui n'est ni ravitaillée ni payée, cherche de quoi survivre : la faim fait sortir le loup du bois. " Le général de Gaulle répliqua qu'il était impossible de la laisser continuer : " Il faut la cantonner. C'est à l'Éxécutif provisoire de régler le problème [18]. " Connaissant le manque d'autorité de cet exécutif sur les wilayas de l'ALN, on peut douter que cet ordre ait été suivi d'effet. Ce que semble confirmer le témoignage de Michel Debré sur la période postérieure à la fin de ses fonctions de premier ministre le 14 avril 1962 : " L'on a su dans le secret de l'État que j'étais défavorable aux consignes d'abstention trop vite données à notre armée, et au raccourcissement du délai prévu pour le référendum [19]. "
Ce dernier point traduisait la volonté souvent exprimée par le général de Gaulle de placer le plus vite possible les Français d'Algérie devant l'inéluctabilité de l'indépendance pour les obliger à renoncer à leur foi insensée en l'OAS. Mais il posait la question essentielle de la responsabilité du maintien de l'ordre après la proclamation du résultat de l'autodétermination, qui devait relever désormais des seules autorités algériennes, comme le chef de l'État l'avait répété au conseil du 4 mai 1962 : " Il faut annoncer la date de l'autodétermination. Que personne ne doute que la France n'exercera plus aucune responsabilité, ni politique, ni de maintien de l'ordre, au plus tard six mois après le cessez-le-feu ! Que les musulmans préparent le gouvernement de l'Algérie ! Que les Européens se persuadent qu'il faut, ou bien s'accommoder avec les musulmans sans que la France les protège, ou bien rentrer en France [20] ! "
Selon le général Katz, nommé pour disputer Oran à l'OAS, le général de Gaulle était mal informé par ses subordonnés : les ministres Joxe et Messmer, le Haut commissaire Fouchet et le général Fourquet. Le statut des forces françaises en Algérie après l'autodétermination, défini dans le Journal officiel du 19 mars 1962, était " aussi imprécis qu'ambigu ". Les notes d'orientation du commandement supérieur traduisant une " méconnaissance totale de la situation ", on pouvait prévoir que " les forces de l'ordre [interviendraient] toujours trop tard ". Ainsi le général Katz rejette la responsabilité qui lui a été imputée de la fusillade et des massacres du 5 juillet 1962 à Oran : " La principale, l'essentielle, a été la légèreté et l'insuffisance des responsables du Gouvernement français : le ministre chargé de l'affaire algérienne, le Haut commissaire à Alger et le commandant interarmes " (auxquels il reproche d'avoir fui leur poste dès le 3 juillet 1962) [21].
Le premier ambassadeur de France en Algérie, Jean-Marcel Jeanneney, rejoignit son poste le 7 juillet 1962 avec des consignes du général de Gaulle qui définissaient sa mission négativement : éviter que l'Algérie indépendante devienne un nouveau Congo, qu'elle rompe avec la France comme Cuba avec les États-Unis, et que les hostilités reprennent comme à Bizerte en 1961 [22]. En conséquence, il refusa plusieurs demandes d'intervention militaire réclamées par des Français d'Algérie. Un autre reproche fait au gouvernement est d'avoir trop longtemps minimisé l'ampleur et le caractère définitif du rapatriement. L'estimation officielle du nombre de retours attendus pour 1962 était de 70.000 au début de l'année, puis de 160.000 au conseil du 27 juin [24]. Le pronostic du général de Gaulle sur leur nombre final était de 100.000 ou 200.000 en décembre 1961, 300.000 le 24 mai, 350.000 le 22 août : à quoi le Premier ministre, Georges Pompidou (qui venait de décider la création d'un ministère des rapatriés), osa répondre qu'ils risquaient d'être plutôt 550 000, voire davantage [25] : encore le général voulut-il croire jusqu'en septembre qu'il s'agissait de " vacanciers ", puis de " repliés " susceptibles de revenir chez eux dès que la sécurité y serait rétablie. Selon le témoignage de celui-ci, les propos échangés sur les rapatriés en conseil des ministres manquaient souvent d'indulgence. Louis Joxe et son collègue de l'Intérieur, Roger Frey, voyaient arriver avec inquiétude les " desperados " de l'OAS et les jeunes " blousons noirs " désaxés par la violence. Le général reprochait aux Français d'Algérie d'avoir fait leur propre malheur en rejetant sa politique et en soutenant jusqu'au bout la folie sanguinaire de l'OAS. Il s'indignait contre la désertion des fonctionnaires - notamment ceux des finances - qui paralysait l'Algérie, et réclamait des mesures autoritaires pour disperser les rapatriés loin de Marseille et de la Méditerranée, et pour les forcer à travailler.
Envers les réfugiés " français musulmans ", son attitude était encore plus réticente. Le plan de démobilisation des supplétifs du 22 février 1962 avait prévu des possibilités très limitées de rengagement dans l'armée française, et un petit nombre d'entre eux se sentaient assez menacés pour demander à être transférés en métropole sans espoir de retour au pays natal : moins de 1.500 harkis et moghaznis (plus leurs familles) au 13 juin 1962 selon le ministre Messmer [27]. Il n'avait pas été question d'un repli massif et préventif, " le seul moyen vraiment efficace d'assurer leur sécurité, parce que le gouvernement voulait croire que le FLN appliquerait les accords d'Évian : quelle illusion ! " juge-t-il rétrospectivement [28].
Cependant, le général de Gaulle avait une autre raison de ne pas souhaiter un repli massif des " Français musulmans " : il ne les considérait pas comme de vrais Français (à l'exception de ceux qui avaient opté pour la pleine citoyenneté française impliquant la soumission au code civil) et jugeait que leur place était normalement en Algérie, où les accords d'Évian étaient censés les protéger [30]. Il le dit très clairement au conseil des ministres du 25 juillet : " On ne peut pas accepter de replier tous les musulmans qui viendraient à déclarer qu'ils ne s'entendront pas avec leur gouvernement ! Le terme de rapatriés ne s'applique évidemment pas aux musulmans [...]. Dans leur cas, il ne saurait s'agir que de réfugiés ! Mais on ne peut les recevoir en France comme tels, que s'ils couraient des dangers [31] ! "
Ces propos expliquent la succession, dans les mois suivants, de consignes contradictoires, ordonnant à l'armée d'accueillir et de transférer les réfugiés ou, au contraire, de limiter leur accueil pour éviter des heurts avec le gouvernement algérien et parce que la " capacité d'absorption de la métropole " était saturée. Ils montrent aussi que de Gaulle ne considérait pas le problème des anciens supplétifs indépendamment de l'immigration algérienne, conséquence indésirable d'une décolonisation chaotique : " Nous ne devons pas nous laisser envahir par la main-d'œuvre algérienne, qu'elle se fasse ou non passer pour des harkis. Si nous n'y prenions pas garde, tous les Algériens viendraient s'installer en France [32] ! " C'est sans doute la crainte de voir un ou deux millions de réfugiés politiques ou économiques s'ajouter au million de rapatriés qui l'empêcha de renoncer à la coopération, comme il en avait menacé le FLN à la fin juillet et à la fin août 1962 [33]. Le gouvernement français n'avait pas d'autre choix que de faire tout son possible pour stabiliser l'Algérie à tout prix.
Peut-être parce que l'aide à l'Algérie continuait de coûter à la France, le gouvernement attendit 1970 pour faire voter la première loi d'indemnisation, après avoir donné la priorité aux mesures d'intégration économique et sociale, non sans succès dans le cas des " rapatriés ". Le général de Gaulle s'en était déchargé sur ses ministres. Le 23 novembre 1962, il avait refusé de parler directement aux Français d'Algérie pour les aider à tourner la page, comme le lui proposait Alain Peyrefitte. Il attendit juin 1964 pour le faire lors de son voyage dans l'Oise et en Picardie, d'une manière qui ne les convainquit pas d'avoir été enfin compris : " Pour sortir du drame, il fallait résoudre un problème grave et même cruel, celui de l'Algérie. Nous l'avons résolu comme il le fallait, conformément au génie de la France et à son intérêt. Mais encore, je vous en prends à témoin, en une année, un million de Français établis dans ce pays ont été rapatriés sans heurts, sans drames, sans douleurs, et intégrés dans notre unité nationale. Cela ne s'était jamais vu. Cela signifiait de la part de tous les Français une grande compréhension et une grande générosité. Cela signifiait, de la part des Français d'Algérie, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'esprit de labeur et d'entreprise et beaucoup de patriotisme. Je leur en donne témoignage tout simplement [34]. "
 partie de sa brochure, La tragédie algérienne, rédigée d'abord sous la forme d'une note destinée au président du Conseil, Guy Mollet, l'idée que l'indépendance de l'Algérie impliquait nécessairement le départ d'un grand nombre de Français établis dans le pays revenait comme un leitmotiv [1]. Estimant qu'une telle issue était inévitable, l'auteur jugeait que " le vote d'un crédit de 500 milliards pour rapatrier les Français d'Algérie serait finalement une solution moins coûteuse que la prolongation de la guerre, même victorieuse, et moralement préférable à l'abandon déshonorant d'un million de compatriotes et des musulmans qui furent nos amis " afin d'échapper à une guerre interminable. Il proposait de faire admettre par l'Assemblée nationale " le principe d'une compensation " en faveur des rapatriés.
partie de sa brochure, La tragédie algérienne, rédigée d'abord sous la forme d'une note destinée au président du Conseil, Guy Mollet, l'idée que l'indépendance de l'Algérie impliquait nécessairement le départ d'un grand nombre de Français établis dans le pays revenait comme un leitmotiv [1]. Estimant qu'une telle issue était inévitable, l'auteur jugeait que " le vote d'un crédit de 500 milliards pour rapatrier les Français d'Algérie serait finalement une solution moins coûteuse que la prolongation de la guerre, même victorieuse, et moralement préférable à l'abandon déshonorant d'un million de compatriotes et des musulmans qui furent nos amis " afin d'échapper à une guerre interminable. Il proposait de faire admettre par l'Assemblée nationale " le principe d'une compensation " en faveur des rapatriés.
 La publication de cette brochure indigna les partisans de l'Algérie française. Jacques Soustelle, champion de l'intégration, lui répliqua aussitôt dans Le drame algérien et la décadence française, réponse à Raymond Aron, en l'invitant à voir " à quel abîme il voudrait conduire cette masse humaine qu'il condamne si légèrement à l'exode. D'après lui, un tel transfert de population était impraticable, sauf pour un régime dictatorial à la Staline : la solution proposée par M. Aron aboutit à l'abandon pur et simple de tous ceux qui n'ont pas placé quelques millions en France ou à l'étranger [... ] à la discrétion du FLN, de ses tueurs, de ses égorgeurs ! " Il concluait : " On ne renonce pas à l'Algérie. Cela n'est ni honorable, ni possible [3]. "
La publication de cette brochure indigna les partisans de l'Algérie française. Jacques Soustelle, champion de l'intégration, lui répliqua aussitôt dans Le drame algérien et la décadence française, réponse à Raymond Aron, en l'invitant à voir " à quel abîme il voudrait conduire cette masse humaine qu'il condamne si légèrement à l'exode. D'après lui, un tel transfert de population était impraticable, sauf pour un régime dictatorial à la Staline : la solution proposée par M. Aron aboutit à l'abandon pur et simple de tous ceux qui n'ont pas placé quelques millions en France ou à l'étranger [... ] à la discrétion du FLN, de ses tueurs, de ses égorgeurs ! " Il concluait : " On ne renonce pas à l'Algérie. Cela n'est ni honorable, ni possible [3]. "
Cette incertitude persistante n'avait rien de rassurant pour les Français d'Algérie.
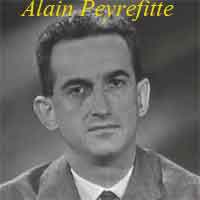 Dès le 12 juillet 1961, le général confia au jeune député gaulliste Alain Peyrefitte la mission d'étudier et de populariser la solution du partage, afin de donner au FLN une " poire d'angoisse " qui l'incite à négocier sérieusement l'indépendance dans la coopération [8]. Alain Peyrefitte prit sa mission à cœur. Il publia plusieurs articles dans Le Monde et diverses revues, puis un livre intitulé Faut-il partager l'Algérie ?, qui parut en décembre 1961. Contrairement à Raymond Aron quatre ans plus tôt, il estimait que le partage et le regroupement en Algérie seraient moins coûteux que le rapatriement en métropole. La meilleure garantie d'une éventuelle coopération entre les communautés serait que chacune fût majoritaire sur une partie du territoire [9] : sinon, au cas où l'Algérie entière serait livrée au FLN, il fallait prévoir le rapatriement massif du million de Français d'Algérie auxquels tenteraient de se joindre un ou deux millions de réfugiés politiques ou économiques musulmans.
Dès le 12 juillet 1961, le général confia au jeune député gaulliste Alain Peyrefitte la mission d'étudier et de populariser la solution du partage, afin de donner au FLN une " poire d'angoisse " qui l'incite à négocier sérieusement l'indépendance dans la coopération [8]. Alain Peyrefitte prit sa mission à cœur. Il publia plusieurs articles dans Le Monde et diverses revues, puis un livre intitulé Faut-il partager l'Algérie ?, qui parut en décembre 1961. Contrairement à Raymond Aron quatre ans plus tôt, il estimait que le partage et le regroupement en Algérie seraient moins coûteux que le rapatriement en métropole. La meilleure garantie d'une éventuelle coopération entre les communautés serait que chacune fût majoritaire sur une partie du territoire [9] : sinon, au cas où l'Algérie entière serait livrée au FLN, il fallait prévoir le rapatriement massif du million de Français d'Algérie auxquels tenteraient de se joindre un ou deux millions de réfugiés politiques ou économiques musulmans.
Or, ces garanties furent très rapidement bafouées, ce qui rendit inévitable un afflux de rapatriés et de réfugiés.
L'OAS a immédiatement refusé le cessez-le-feu et tenté de l'empêcher par des attentats aveugles contre les quartiers musulmans, visant à provoquer des représailles du FLN contre les quartiers européens, qui obligeraient l'armée française à riposter. En même temps, elle s'est attaquée aux éléments des forces de l'ordre qui refusaient de prendre son parti. Par là, elle a exposé la population française d'Algérie aux pires périls, tout en dissuadant les CRS, gendarmes et soldats de prendre des risques pour la défendre. De même, elle a fourni un prétexte aux représailles du FLN contre les anciens " harkis " en tentant de les entraîner à former des maquis dans l'Ouarsenis. L'OAS, prétendant mobiliser sur place les Français d'Algérie, interdit tout départ vers la métropole et ordonna la grève des compagnies de transport qui rendit les embarquements beaucoup plus difficiles et allongea les files d'attente [14]. Ses derniers commandos, refusant le nouveau cessez-le-feu négocié à Alger entre Jean-Jacques Susini et le président de l'Éxécutif provisoire, Abderrahmane Farès, multiplièrent les destructions puis s'enfuirent à la veille du référendum d'autodétermination.
Après avoir appris qu'à l'issue du conseil des ministres du 25 juillet, le porte-parole Alain Peyrefitte avait déclaré que " si la situation s'aggravait, la France interviendrait directement pour protéger ses nationaux [23] ", l'ambassadeur vint à Paris se faire confirmer que la mission de l'armée était " de recueillir et d'embarquer ", et non pas de mener des opérations préventives ou offensives sans la requête des autorités algériennes. La sécurité des Français en Algérie n'était donc pas la priorité absolue.
Enfin, le 26 septembre, le nouveau ministre des rapatriés Alain Peyrefitte lui présenta un bilan sans illusion, concluant que leur nombre à la fin de l'année serait de 650.000 (dans la meilleure hypothèse) à 900.000 [26].
 Plus grave, le ministre Joxe interdit, le 16 mai 1962, les " rapatriements prématurés " d'anciens supplétifs organisés en dehors de la hiérarchie par certains de leurs officiers ou anciens officiers. Il réclama des sanctions contre les " coupables ", et ordonna le refoulement en Algérie de ceux qui en avaient déjà bénéficié. Cette mesure était contraire à la liberté de circulation garantie par les accords d'Évian, et à la loi française qui ne permettait pas d'expulser des citoyens français, qu'elle empêchait de manifester leur volonté de le rester tout en mettant leur vie en danger. Elle s'expliquerait difficilement sans l'obsession d'une manoeuvre de l'OAS tendant à transférer des recrues potentielles en métropole pour y entretenir la guerre civile, avouée par Louis Joxe au conseil du 24 mai : " les harkis veulent partir en masse. Il faut combattre une infiltration qui, sous prétexte de bienfaisance, aurait pour effet de nous faire accueillir des éléments indésirables [29]. "
Plus grave, le ministre Joxe interdit, le 16 mai 1962, les " rapatriements prématurés " d'anciens supplétifs organisés en dehors de la hiérarchie par certains de leurs officiers ou anciens officiers. Il réclama des sanctions contre les " coupables ", et ordonna le refoulement en Algérie de ceux qui en avaient déjà bénéficié. Cette mesure était contraire à la liberté de circulation garantie par les accords d'Évian, et à la loi française qui ne permettait pas d'expulser des citoyens français, qu'elle empêchait de manifester leur volonté de le rester tout en mettant leur vie en danger. Elle s'expliquerait difficilement sans l'obsession d'une manoeuvre de l'OAS tendant à transférer des recrues potentielles en métropole pour y entretenir la guerre civile, avouée par Louis Joxe au conseil du 24 mai : " les harkis veulent partir en masse. Il faut combattre une infiltration qui, sous prétexte de bienfaisance, aurait pour effet de nous faire accueillir des éléments indésirables [29]. "
Ce texte a été présenté au colloque Marseille et le choc des décolonisations, les rapatriements, 1954-1964, qui a eu lieu à Marseille les 11, 12 et 13 mai 1995, sous la direction de Jean-Jacques Jordi et d'Emile Témime, puis a été publié par les Editions Edisud en janvier 1996.
[1] Raymond Aron, La tragédie algérienne, Paris, Plon, 1957, pp. 3, 13, 18, 20, 21-22, 26-27, 30, 32-33,36.
[2] Ibid., pp. 52-53.
[3] Soustelle, op. cit., Plon 1957, pp. 45 et 63.
[4] Discours du 4 novembre 1960, Ibid., p. 259.
[5] Résultats du référendum du 8 janvier 1961 en Algérie, illustrés par une carte, publiés par Alain Peyrefitte, Faut-il partager l'Algérie ?, Paris, Plon, 1961, pp. 178 et 179. Ils montrent une majorité absolue de non par rapport aux suffrages exprimés (relative par rapport aux inscrits) dans trois régions : Alger-Blida ; Oran-Sidi-Bel-Abbès ; Bône-Philippeville.
[6] De Gaulle, op. cit., p. 292.
[7] Pierre Viansson-Ponté, Histoire de la République gaullienne, t. 1, Paris, Fayard, 1970, p. 403.
[8] Alain Peyrefitte, C'était de Gaulle, Paris, Fayard, 1994, p. 76.
[9] Idée indiquée par de Gaulle lui-même le 12 juillet 1961.
[10] Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 28 décembre 1961, pp. 11996-11997.
[11] Peyrefitte, op. cit., pp. 84-91.
[12] Sur les accords d'Évian, qu'on me pardonne de renvoyer à mes publications : " Les accords d'Évian et les relations franco-algériennes ", dans La guerre d'Algérie et les Français, s. dir. J.-P. Rioux, Paris, Fayard, 1990, pp. 484-493 ; 1962 : la paix en Algérie, Paris, La Documentation française, 1992, 96 p. et " Trente ans après, réflexions sur les accords d'Évian ", Revue française d'histoire d'Outre-Mer, 1992, n° 296, pp. 367-381.
[13] Sur le recrutement et le licenciement des " harkis " et autres supplétifs, voir notamment mes articles dans L'Histoire, n° 102, juillet-août 1987, pp. 30-34, n° 140, janvier 1991 (repris dans L'Algérie des Français, présenté par C.R. Ageron, Paris, Le Seuil, 1993) et n° 181, octobre 1994, p. 59.
[14] Cf. les déclarations de Robert Boulin au Conseil des ministres du 29 mai 1961, Peyrefitte, op. cit., pp. 136-137.
[15] Cf. texte reproduit par Mohammed Harbi, Les Archives de la Révolution algérienne, Paris, Éditions Jeune Afrique, 1981, p. 341.
[16] Ces promesses n'étaient valables que jusqu'à la fin de la guerre, et n'engageaient pas le futur gouvernement algérien, selon les déclarations faites le 14 mars 1960 par Lakhdar Ben Tobbal, ministre de l'Intérieur du GPRA, reproduit par Harbi, op. cit., p. 300.
[17] Mémorandum sur les enlèvements rédigé par un officier pour la défense du capitaine Murat (membre de l'OAS), reproduit dans OAS parle, Paris, Julliard, 1963, pp. 256-263.
[18] Peyrefitte, op. cit., pp. 121-122.
[19] Michel Debré, Mémoires, t. 3, Gouverner, Paris, Albin Michel, 1968, p. 310.
[20] Peyrefitte, op. cit., p. 124.
[21] Joseph Katz, L'honneur d'un général, Paris, L'Harmattan, 1993, pp. 266, 295-296, 300, 334 et 338.
[22] Déclaration de Jean-MarcelJeanneney au colloqueDe Gaulle en son siècle, Paris, Plon et La Documentation française, 1992, t. 6, pp. 226-228.
[23] Cf. Peyrefitte, op. cit., p. 197.
[24] Ibid., p. 173.
[25] Ibid., p. 204.
[26] Ibid., pp. 251-252.
[27] Ibid., p. 171.
[28] Pierre Messmer, Après tant de batailles, Mémoires, Paris, Albin Michel, pp. 261-263. Cf. Michel Debré : " J'aurais souhaité une volonté plus efficace de transférer en métropole les soldats musulmans qui avaient servi sous notre drapeau " (Debré,op. cit., p. 310).
[29] Voir aussi Peyrefitte, op. cit., p. 136.
[30] L'acceptation par le GPRA de l'exigence française de " non-représailles " envers les musulmans pro-français avait débloqué les négociations lors des rencontres secrètes de Bâle en octobre-novembre 1961, selon Ben Khedda, Les accords d'Évian, Paris, Publisud, et Alger, OPU, 1986, pp. 27 et 30. Cela dément les allégations au sujet de " clauses secrètes " abandonnant volontairement les harkis à la vindicte du FLN, reprises par Taouès Titraoui et Bernard Coll, Le livre des harkis, Bièvres, Jeune Pied-Noir, 1991, p. 169.
[31] Peyrefitte, op. cit., p. 196.
[32] Ibid., p. 396 (entretien du 3 janvier 1963).
[33] Cf. les propos du général après le conseil du 29 août 1962 : " Il faut bien admettre que l'Algérie vit actuellement dans la confusion [...] mais il est de notre devoir de faire comme si elle devait s'en sortir. [...] Nous n'avons pas avantage à miser sur l'échec, mais sur la réussite de l'Algérie nouvelle " (Peyrefitte, op. cit., pp. 249-250).
[34] Cité par Claude Paillat, La liquidation, Paris, Robert Laffont, 1972, pp. 757-758, note 33 (d'après La Croix du 13-06-1964). J'ai moi-même entendu le général prononcer ces paroles surprenantes à Creil.
Mis en ligne le 13 décembre 2011