|
Je crois que l'on peut dire, sans commettre d'erreur, que le bombardement de Sakiet, le 2 février 1958, a sonné le glas de la IVe République. Ce furent, en effet, ses répercussions dont les gaullistes se sont servis pour monter le coup d'État du 13 mai. Il est vrai aussi qu'ils ont été puissamment aidés par les rivalités des partis politiques qui n'arrivaient à aucune entente pour dénouer la crise ministérielle, ouverte en avril par la chute du gouvernement de M. Félix Gaillard.
Sakiet serait une initiative regrettable du haut commandement militaire, certes couverte officiellement, mais qui se serait apparentée à de l'indiscipline. En est-il ainsi? C'est ce que nous allons tenter d'élucider, non sans avoir rappelé deux opérations antérieures qui illustrent la volonté offensive de certains ministres, car il est heureux de constater!
que nos responsables de la Défense nationale n'ont pas toujours été dupes de la prétendue neutralité des pays voisins de l'Algérie et encore moins enclins à accepter de leur part un soutien actif à la rébellion, soutien qui se manifestait parfois non sans ostentation.
En septembre 1957, la sécurité au Sahara risquait d'être compromise si des bandes ennemies, arrivant de Libye, attaquaient les installations pétrolières d'Edjelé et surtout tentaient de mettre, comme en 1916, le tassili des Adjers en dissidence. C'est de Ghat qu'étaient partis, à l'époque, les Senousis, qui, remontant jusqu'au Hoggar, avaient assassiné le père de Foucauld à Tamanrasset. Or en 1957, de nouveau, des émissaires parcouraient la région de Djanet pour fomenter la guerre sainte.
Des ordres, émanant de la Défense nationale, autorisèrent, si besoin en était, de s'emparer de l'oasis de Ghat, en territoire libyen, que contrôlaient pratiquement les rebelles algériens. Le dispositif fut placé aux ordres du chef de bataillon Touret. Il n'eut pas à intervenir, car, dès la mise en place de nos renforts à Fort-Polignac, tout rentra dans l'ordre. Ce fut à l'esprit de détermination de MM. Bourgès-Maunoury, président du Conseil, et Morice, ministre de la Défense nationale, que l'on doit d'avoir évité le pourrissement de la région de Djanet.
Il était donc parfaitement admis d'attaquer en territoire étranger les fellagha, si ces derniers profitaient de l'asile qui leur était accordé, pour monter des actions contre nos troupes et les populations placées sous notre protection.
Un poste clandestin: " La Voix de l'Algérie libre ", émettait depuis le 15 décembre 1956, lançant chaque soir sur les ondes des thèmes d'une propagande antifrançaise d'une particulière violence. Sa localisation, par goniométrie, l'avait situé en territoire marocain, au sud de Nador. Il se déplaçait d'une émission à l'autre dans une zone d'environ trente kilomètres de rayon. L'émetteur se trouvait certainement sur un véhicule, ce que confirmait un renseignement digne de foi : deux émetteurs montés sur camion avaient été livrés à Alhucemas aux rebelles algériens le 17 octobre 1956.
Le ministre de la Défense nationale donna l'ordre de détruire ce poste. L'armée de l'air fut chargée de l'exécution. La préparation de cette opération, baptisée " Condor ", fut entreprise avec méthode. L'objectif devait d'abord être localisé par un avion muni de moyens électroniques appropriés. Un Marcel Dassault devait ensuite baliser l'emplacement qu'un Dakota éclairerait par bombes " Luciole ". Le véhicule émetteur serait alors attaqué au SS Il (engins téléguidés) et aux armes de bord par trois autres Marcel Dassault. Le feu ne devait, selon mes instructions, être ouvert qu'en rase campagne. Une première opération eut lieu en mai 1957. Les résultats ne correspondaient pas à nos espoirs, mais on pouvait tirer des enseignements pour l'occasion suivante. Ce n'était pas un seul émetteur, mais deux, distants de dix kilomètres, qui travaillaient alternativement au cours d'une même soirée. Les moyens furent, de ce fait, renforcés : deux avions électroniques, deux M. D. marqueurs, trois Dakota éclaireurs, quatre M. D. pour l'attaque proprement dite.
En juillet 1957, l'escadrille ainsi constituée intervenait par deux fois. La première opération se heurta à des difficultés techniques et au stationnement des émetteurs sur une route à moyenne circulation, ce qui excluait, selon mes ordres, toute attaque. La seconde fut plus heureuse et les postes émetteurs furent sérieusement endommagés.
Aucune réaction ne fut relevée de la part du gouvernement chérifien. Le Maroc ne crut pas devoir protester contre le survol de son pays, car il lui était difficile de démentir l'existence de postes radio rebelles sur son territoire. La seule information précise que nous ayons reçue faisait état de la crainte de l'Amel local d'un lâcher de parachutistes français. L'armée chérifienne reçut simplement l'ordre de les rechercher. Aucune protestation diplomatique ne fut enregistrée.
Une réaction virile de notre part en imposait donc à ceux qui soutenaient ouvertement les rebelles.
Il convient maintenant de parler de l'affaire de Sakiet, dont la résonance sur le plan international ne le céda en rien à celle de Suez. Elle ne peut toutefois être évoquée sans être située dans le contexte du climat qui régnait dans les milieux militaires de l'époque.
- L'humiliation de l'Indochine, il faut toujours le souligner, obsédait tous les esprits. Aussi, l'armée ne pouvait admettre de perdre la guerre d'Algérie, et son chef suprême, le général Ely, la confirmait dans sa résolution par une directive datée du 26 juin 1957 :
" Le but à atteindre, disait-il, doit être précis, sans équivoque à tous
les échelons de commandement: en face de l'effort adverse, il s'agit non pas de tenir, mais de gagner, non pas de durer, mais de remporter la décision
- Rompre la tentation de lassitude des exécutants en les convainquant de la détermination du gouvernement et du commandement. Tout doit converger pour restaurer la confiance et dissiper la hantise de l'Indochine.
- Convaincre la population musulmane, d'une part, de la volonté de la France d'affronter pendant tout le temps qu'il faudra la guerre qui lui est imposée et de la gagner, d'autre part, de sa loyauté dans la recherche d'une solution généreuse.
Il était donc demandé aux officiers généraux de convaincre leurs subordonnés de la ferme volonté du gouvernement de lutter, sans découragement, jusqu'au succès final. Mais, pour les exécutants, les intentions les plus fermes n'ont de valeur que si elles sont complétées par l'action. A cet égard, les militaires doutaient de la résolution des gouvernements qui se succédaient à la tête de l'État.
Comment n'auraient-ils pas douté des hommes au pouvoir, lorsque des politiques, fidèles au général de Gaulle, et, avec eux, tout spécialement Michel Debré, les mettaient en garde contre la velléité des dirigeants. A les en croire, le manque d'autorité tout comme le sens discutable de la grandeur du pays des ministres de la IVe République devaient conduire inexorablement à une nouvelle et déshonorante capitulation. Demain, ces " Princes (1), qui nous gouvernaient avec l'esprit de démission qui les caractérisait, accepteraient de traiter avec les rebelles. Rappeler toutes les proclamations incendiaires du sénateur Debré, toutes ses incitations à la violence, à l'insurrection, toutes ses philippiques contre les gouvernants prêts à brader l'Algérie française exigerait un ouvrage spécialement consacré à ce sujet. Comme Cassandre, il prédit des jours sombres. " Il est en politique, écrira-t-il, des lois aussi impitoyables que l'est en physique celle de la pesanteur. L'absence de parapet fait tomber dans le vide. L'absence de gouvernement mène à la ruine des nations. "
Il n'était du reste pas besoin de ce volcanique parlementaire pour se rendre compte de l'impuissance d'un État dont l'autorité s'amenuisait chaque jour. Quel crédit dès lors apporter aux déclarations, même solennelles, des ministres? Elle était loin d'être aveugle la confiance que leur accordaient ceux qui, depuis vingt ans, affrontaient chaque jour la mort et qui craignaient qu'on ne finît par leur demander, une fois encore, d'amener les couleurs sur une terre qu'ils avaient juré de défendre, se référant en cela aux directives gouvernementales. Certes, privés de leurs familles, toujours au combat, ils aspiraient à une vie normale, sans pour autant accepter, pour en bénéficier, de sacrifier leur honneur. Il y a des limites au parjure.
1. Ces Princes qui nous gouvernent, livre de Michel DEBRÉ publié en septembre 1957. Les Princes sont non seulement les hommes du gouvernement, mais tous ceux qui exercent une action sur l'opinion et sur le pouvoir.
La situation sur la frontière tunisienne était des plus délicates. Des incidents, souvent très graves, éclataient entre le barrage et la frontière, où de nombreux villages exigeaient la présence et la protection de l'armée française. En septembre 1957, au Kouif, à EI-Khemissi, la collusion entre Tunisiens et rebelles se manifeste outrageusement, ce contre quoi le général Salan s'élève avec fermeté. Mais les protestations de notre ambassade à Tunis restent ignorées de M. Bourguiba qui, probablement, ne contrôle plus les forces du F.L.N., imposant leur volonté en Tunisie. L'audace de nos adversaires va croissant, prenant même pour cible les avions qui patrouillent aux limites de la frontière, dans l'espace aérien français. Les tirs proviennent généralement du poste de Sakiet-Sidi-Youssef. M. Bourguiba incrimine la responsabilité des incidents à l'aviation française et M. Gorse, secrétaire d'État aux Affaires tunisiennes et marocaines, marque son inquiétude à M. Robert Lacoste. Il craint une tension de nos rapports avec le gouvernement tunisien et, tout en reconnaissant le bon droit des aviateurs français, incite à la prudence. " Dans l'hypothèse, écrit-il, où notre aviation serait conduite, à la suite de nouvelles agressions contre des appareils, à prendre des mesures de représailles, nous aurions soudain à faire face à une crise aiguë qui compromettrait tous les efforts que nous pouvons tenter sur un autre plan pour nous rapprocher des Tunisiens."
M. Bourguiba est-il abusé par son entourage ou déforme-t-il volontairement la vérité ? Je n'ai pas à prendre parti, mais j'adresse à mon secrétaire d'État un rapport dont la conclusion n'incite pas à la passivité.
Le ministre de la Défense nationale, M. André Morice, n'est quant à lui pas enclin à céder à l'intimidation. Sur ses directives, une conférence se réunit à Alger, sous la présidence du général Salan, pour examiner dans quelles conditions pourrait être envisagée une action tendant à assurer le contrôle du territoire tunisien. J'y participe, tout comme le général Gambiez, commandant interarmées en Tunisie, et l'amiral Geli, qui a sous ses ordres la marine. Le 6 septembre 1957, une instruction est signée par le général Salan ; son but : destruction des bases F.L.N. implantées en Tunisie, tout en assurant la protection de nos ressortissants. Il faudra pousser jusqu'à Tunis et je prépare une intervention aéroportée sur cette ville et Bizerte, tandis que la marine débarquera à Sousse. L'opération, de grande envergure, doit être menée avec le souci de "se conduire en amis, écrira le général Salan et de faire comprendre aux Tunisiens qu'on vient les délivrer de l'emprise que le F.L.N. leur fait subir en se conduisant chez eux comme en pays conquis".
Le général Ély donne son accord au projet et demande d'en poursuivre la préparation. Nous avons l'impression d'être enfin commandés par des hommes qui comprennent les problèmes devant lesquels nous sommes confrontés. Que nous sommes loin de la pusillanimité qui suivit Sakiet ! Cependant, le gouvernement de M. Bourgès-Maunoury tombait le 30 septembre 1957. La directive dont on vient de parler fut classée dans les archives.
M. André Morice avait été remplacé à la Défense nationale par M. Chaban-Delmas, qui était encore peu connu en Algérie, bien qu'ayant déjà occupé des fonctions ministérielles dans les cabinets Pierre Mendès France et Guy Mollet. C'était un " gaulliste ", qui avait toutefois fondé en 1955, avec Mendès France, Guy Mollet, Mitterrand, le "Front républicain". Il était attendu à Alger avec curiosité par les milieux militaires, car ce ministre de la Défense nationale était un général de brigade honoraire. Lieutenant d'infanterie de réserve, il avait exercé en 1944 les hautes fonctions de " délégué militaire national " en France occupée, ce qui lui avait valu en mai 1944 de recevoir, avec la Légion d'honneur, ses étoiles de brigadier. C'était normal, et si ce rapide avancement heurtait certains milieux militaires, ils auraient dû se souvenir que la formule était en honneur en Grande Bretagne où les grades temporaires, dits acting, étaient attribués en fonction de l'importance des tâches exercées, à une époque déterminée.
Je ne connaissais pas particulièrement M. Chaban-Delmas, ne l'ayant aperçu que quelques instants, en septembre 1944, sur le terrain de Bordeaux-Mérignac, alors qu'il s'apprêtait à décoller pour Paris. J'avais apprécié l'allure sportive de ce général, guère plus âgé que les chefs de la révolution, les Desaix, Hoche, Lasalle, Ney..., qui commandaient en chef devant l'ennemi à moins de trente ans. J'avais toutefois été surpris, au premier abord, en découvrant un officier général qui n'était que chevalier de la Légion d'honneur et dont la croix de guerre paraissait modeste. Il ne m'adressa, avec condescendance, que quelques mots d'une parfaite banalité, car mon grade de modeste commandant aviateur, au milieu de si nombreux faux colonels, ne pouvait retenir son attention.
Dès son arrivée en Algérie, M. Chaban-Delmas prenait la parole à Bône, au cours d'une séance de travail à laquelle assistait un aréopage de généraux et d'officiers supérieurs. Après avoir rappelé que, contrairement à la légende, il n'était pas polytechnicien, mais simple inspecteur des Finances, M. Chaban-Delmas expliquait le sens de la crise qui avait provoqué la chute de Bourgès-Maunoury. Après avoir exposé les buts que se fixait le nouveau gouvernement, il concluait, dans une belle envolée oratoire, en nous assurant de la chance de la France d'avoir à sa tête trois hommes jeunes, issus de la Résistance, qu'étaient le président du Conseil, Félix Gaillard, le ministre de l'Intérieur, Bourgès- Maunoury, et enfin lui-même à la Défense nationale. Ces trois gaillards (sourire) sauraient faire respecter les droits de la France (1).
1. J'ai reproduit dans () mon pays perdu (pp. 45-46) l'exposé du ministre tel que je l'ai noté à l'époque, car il me parut particulièrement savoureux.
Les droits de la France! M. Chaban-Delmas allait bientôt avoir l'occasion de montrer les résolutions du gouvernement dont il faisait partie, car les difficultés que nos troupes rencontraient à la frontière ne diminuaient guère. Après une très brève accalmie, fin 1957, les attaques reprenaient avec virulence et, le Il janvier 1958, un détachement français fut violemment attaqué par une importante colonne ennemie, soutenue par des réguliers tunisiens.
Ce jour-là, le capitaine Allard, commandant un poste situé face au village de Sakiet, monte une opération pour tendre une embuscade, à sept cents mètres à l'ouest de la frontière, aux fellagha qui utilisaient un sentier pour transiter sur la Tunisie. L'opération doit donc avoir lieu en territoire français, précisons-le. Les deux sections du capitaine Allard, à peine arrivées aux abords de l'endroit choisi, sont prises à partie par un important détachement rebelle, opérant non seulement sur le territoire algérien, mais ouvrant le feu, par armes automatiques et mortiers, depuis les hauteurs dominantes situées en territoire tunisien. C'est au tour de la petite formation française d'être l'objet d'une embuscade tendue des deux côtés de la frontière. Lorsque les renforts arriveront, dès que notre aviation interviendra, les fellagha décrocheront sous la protection des bases de feu installées sur le sol tunisien et les rebelles seront récupérés par des G.M.C. de l'armée tunisienne qui avaient auparavant transporté des renforts sur les lieux du combat. Le bilan, du côté français, sera sévère. On trouvera sur le terrain quatorze cadavres, affreusement mutilés. Quatre soldats sont faits prisonniers. Aux obsèques des victimes, le capitaine Allard dira :
"Vous êtes morts dans un combat difficile, devant un ennemi supérieur en nombre, aidé par ses amis tunisiens. Nous le savons maintenant !"
M. Félix Gaillard voulut réagir. Il envoya son conseiller militaire, le général Buchalet, remettre en main propre une lettre à M. Bourguiba. Ce dernier refusa purement et simplement de recevoir l'émissaire du président du Conseil français. Notre gouvernement n'insista pas; on ne pouvait lui reprocher un excès de susceptibilité.
Ce n'était pas la première fois que la France tentait de dénoncer ces attaques menées d'un pays, en principe neutre. Mais le Quai-d'Orsay était-il aussi sensibilisé que les soldats qui montaient la garde à la frontière ? On peut en douter si l'on écoute un diplomate, M. Alain Peyrefitte. Ce dernier, après avoir souligné l'importance des forces de l'A.L.N. stationnées au Maroc et en Tunisie, convient que nos troupes doivent, l'arme au pied, subir les attaques des rebelles sans riposter.
" Depuis trois mille ans, cela ne s'était encore jamais vu, ajoute-t-il. Les militaires ont de la peine à comprendre cette situation." Ces derniers réagissent, oubliant que " le Maroc et la Tunisie sont deux pays neutres ; bien plus, deux pays amis de la France, coopérant avec elle plus qu'avec aucun autre pays. Il y a des choses qu'on ne peut pas
Faire : riposter à l'A.L.N. est de celles-là."
Riposter à l'A.L.N. serait donc à éviter scrupuleusement. Nos soldats avaient à cet égard un avis assez différent.
Car la Tunisie était-elle un État neutre ? Un pays ami de la France ? La neutralité de la Tunisie aurait dû avoir pour corollaire le refus de laisser les rebelles stationner sur son territoire. Ceux-ci auraient dû, tout au moins, être désarmés. Il n'en était pas ainsi puisque les hors-la-loi algériens pouvaient s'organiser, s'armer, s'entraîner et effectuer des raids aller-retour en Algérie. Or, la Tunisie avait été admise aux Nations unies. L'article 4 de la charte ne lui faisait-il pas une obligation d'adopter une attitude de bon voisinage avec les autres États membres de l'Organisation dans l'intérêt de la paix ? Cette neutralité s'était transformée, en fait, en une belligérance déguisée.
Était-ce un pays ami ? Encore moins sans conteste. Le gouvernement français avait bien attiré l'attention de M. Bourguiba sur la gravité de la situation qu'engendrait son attitude à l'égard de la rébellion algérienne. Dans une dépêche du 7 décembre 1956, M. Maurice Faure, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, adressait à M. Seydoux, envoyé exceptionnel de la République française en Tunisie, des instructions très nettes. On demandait à notre représentant de prendre contact avec le gouvernement tunisien " ... pour lui indiquer que le gouvernement français se réserve la possibilité de faire usage, conformément au droit international, du droit de poursuite dans le cas où des bandes de rebelles algériens pénétreraient sur le sol tunisien sans être désarmées et dissoutes, pour porter à la connaissance de M. Bourguiba que l'attitude de la délégation tunisienne à l'Assemblée générale des Nations unies est considérée par le gouvernement français comme inamicale, surtout dans les propos tenus à la tribune de l'D.N.V. par le chef du gouvernement tunisien à l'égard du chef du gouvernement français "...
Ainsi, le Quai-d'Orsay, même si les démonstrations de la force lui semblaient inopportunes, ne semblait pas être dupe de la neutralité tunisienne.
Si l'armée de terre avait à subir les provocations des rebelles de Tunisie sans réagir, l'aviation n'était guère épargnée par les Tunisiens et les rebelles qui, nous l'avons dit, tiraient sur nos appareils dès qu'ils s'approchaient de la frontière. Du 30 août 1957 au 7 février 1958, vingt-neuf de nos avions avaient été pris à partie par des mitrailleuses lourdes installées à Sakiet. La plupart étaient rentrés à leur terrain avec des traces d'impact. Pouvait-on admettre que nos troupes fussent l'objet d'attaques venant de Tunisie, où, au retour de l'opération, les rebelles étaient assurés d'une protection absolue? Pouvait-on tolérer que nos aviateurs fussent mitraillés, sans réaction de leur part, par la D.C.A. tunisienne ?
Quelle conduite adopter? Quatre solutions furent envisagées :
- Se retirer à l'ouest de la ligne Morice et abandonner ainsi une large bande de territoire français aux fellagha. Solution inacceptable. Politiquement, aucun gouvernement français ne pouvait tolérer une telle humiliation. De plus, les fellagha n'installeraient-ils pas un gouvernement rebelle sur ce qu'ils appelleraient " l'Algérie libérée" ?
Enfin, les fellagha prenant position à proximité du barrage auraient plus de facilités pour le franchir.
- Riposter si nos avions étaient attaqués et poursuivre en Tunisie les rebelles s'ils franchissaient la frontière pour effectuer un coup de main.
- Abandonner la protection par voie aérienne des postes et des convois, ce que personne, en particulier l'armée de l'air, ne pouvait admettre.
- Continuer à assurer l'appui des forces terrestres, sans répondre au tir de l'ennemi.
Cette dernière solution était une vue de l'esprit. On peut personnellement consentir à ne pas réagir lorsqu'on vous prend pour cible. On ne peut l'exiger de ses subordonnés. Il y a des ordres que l'on ne peut donner. D'abord parce que votre conscience vous l'interdit. Ensuite parce que, si vous aviez le front de passer outre, vos équipages n'auraient que mépris pour vous. Mes aviateurs, au sang ardent, commençaient à supporter de plus en plus difficilement d'être contraints à recevoir des coups sans en rendre. Jeune officier, j'aurais partagé leurs sentiments. A leur tête, je les approuvais.
Le grave incident que l'on redoutait va se produire. Successivement, à huit jours d'intervalle, trois avions vont être sérieusement touchés par l'artillerie antiaérienne basée en Tunisie.
Le 30 janvier 1958, d'abord, un appareil T.6 en mission de protection d'un convoi était abattu par la D.C.A. tunisienne. L'appareil se posait en pleine campagne à huit cents mètres de la frontière. L'équipage était dégagé par une patrouille, tandis que les mortiers rebelles ajustaient leur tir sur lui.
Le général Salan se trouvant à Paris, je lui rendais compte, non sans vivacité, de cette nouvelle agression. Je demandais instamment que le droit de riposte nous fût accordé. Le samedi 1er février, le général Salan, de retour à Alger, câblait au général Ély que, sauf contrordre de sa part, il ferait appliquer dès le surlendemain les mesures suivantes :
reconnaissances aériennes autorisées jusqu'à la ligne frontière; riposte automatique, dans les trois heures, à tout tir en provenance de la Tunisie. Ce télégramme fut transmis au ministre de la Défense, au président du Conseil et aux Affaires étrangères. Le général Ély, au nom du gouvernement, donna un accord le 2 février 1958.
Il n'y avait, dans notre esprit, aucune ambiguïté dans la réponse du général Ely: " Les mesures que vous avez prévues dans votre message n° 31 sont approuvées." Pourtant le général Ély, dans ses Mémoires (1), insinue que sa bonne foi aurait été abusée. Il rappelle tout d'abord l'état d'esprit des aviateurs.
"Les formations aériennes, écrit-il, étaient ulcérées, car elles étaient sans défense" et "l'ensemble des forces des trois armées ne comprenait pas cette attitude, jugée trop passive, partageant le mécontentement des aviateurs".
Si ce général comprend l'exaspération des combattants, il s'élève contre les ministres qui, "avec une certaine part de démagogie, de bon aloi", avaient tendance à encourager les exécutants "à ne pas se laisser faire". Et il ajoute que cette attitude "s'était tout particulièrement exprimée lors du passage de M. Morice dans le Constantinois".
C'était exact et je me souviens fort bien que, le 2 octobre 1957, M. Morice, ministre du gouvernement Bourgès- Maunoury, mis en minorité, demandait au général Salan et à moi-même un peu plus d'énergie devant les provocations tunisiennes. Je lui répondis que, la veille et l'avant-veille, mes aviateurs avaient riposté au tir ennemi avec leur armement de bord. Le ministre en fut enchanté.
Pour en revenir à l'accord donné par le général Ély, ce dernier pensait que "la riposte, telle qu'elle était prévue, semblait devoir consister, par exemple, en l'intervention de l'avion prenant la relève de celui qui, touché, n'aurait pu réagir lui-même ou encore en un tir de mortiers demandant un certain délai pour la préparation".
Le chef d'état-major général ignorait, n'ayant jamais eu l'occasion d'exercer des commandements importants sur le terrain, quelle serait la réaction des hommes au combat.
1. Suez..., le 13 mai, général ELY (Plon).
Cette réaction fut vive. En tant que général adjoint interarmées, je signais une instruction destinée au général commandant le corps d'armée de Constantine et au colonel commandant les forces aériennes du Constantinois.
Compte tenu des directives antérieures de la Défenses nationale, je précisais que :
" La riposte aux tirs de la D.C.A. adverse est effectuée à l'initiative de l'armée de l'air :
" - Soit par attaque immédiate par les avions pris à partie ;
" - Soit par intervention du " Poste de commandement avancé Air " dans les trois heures qui suivent ;
" - Soit par demande de tirs adressée à l'armée de terre, sous réserve expresse d'identification sans ambiguïté de cette D.C.A., excluant tout tir systématique et aveugle sur un point ou une zone suspecte. "
Après l'incident du 30 janvier, un second T.6 fut, le 7 février 1958, l'objet de tirs tunisiens, bien qu'évoluant aussi dans notre espace aérien. Le chef du poste français, qui fait face à Sakiet, le capitaine Bernon, avertissait son homologue tunisien que si ces tirs ne s'arrêtaient pas, nous interviendrions : avertissement qui ne fut pas pris au
sérieux. La patience de mes équipages atteignait un point critique. C'est, alors que le lendemain 8 février un troisième appareil Marcel Dassault, piloté par le lieutenant Perchenet, fut gravement atteint par des tirs d'armes lourdes installées à Sakiet.
Qu'était-ce que Sakiet ? : Un village tunisien situé, à. quelques centaines de mètres de la frontière franco-tunisienne. Cette région constituait, avec celle de Ghardimaou, le centre de transit et de passage des convois rebelles à destination des wilaya 2 et 3. C'était aussi la base de départ du 3e bataillon de la wilaya de Souk-Ahras pour les opérations entre frontière et barrage. A Sakiet, les rebelles occupaient des locaux, dont la maison forestière, cohabitant avec l'armée et la garde nationale tunisiennes. A six kilomètres au sud du village, étaient cantonnés dans
les locaux d'une mine désaffectée, une katiba et un état-major F.L.N. Trois emplacements de D.C.A. étaient installés à Sakiet, dans le village même: deux sur la place centrale, un autre sur le poste de douane.
Six emplacements de tir étaient érigés aux abords de la mine occupée seulement par des soldats rebelles, soulignons-le.
Le lieutenant Perchenet, moteur droit coupé, hélice en drapeau, pneu crevé, se pose en détresse à Tébessa. Le colonel Duval, commandant l'aviation tactique du Constantinois, décide de riposter. Il modifie la mission donnée à des bombardiers B.26 et à des Corsair de l'aéronavale qui devaient opérer dans les Aurès. Une opération sur Sakiet est rapidement organisée, les dossiers d'objectifs sur la frontière ayant été étudiés de longue date.
Le 8 février, à 9 h 50, le général de Rivals-Mazères, qui me remplace ce jour-là à Alger, car je suis en mission à Oran, rend compte des incidents et demande une décision au général Salan. Aucune hésitation du commandant supérieur interarmées : "Attaquez Sakiet."
La riposte sera effectuée :
- Sur la D.C.A. de Sakiet par six avions de l'aéronavale, des Corsair, dont la précision du tir est remarquable.
- Sur la D.C.A. de la mine désaffectée par onze B.26, armés de trois bombes de mille livres par appareil.
La réaction de la presse française fut vive et le commandement militaire copieusement critiqué, même insulté. L'opinion internationale ne fut pas plus tendre. Personne ne s'était demandé si la destruction de la quasi-totalité des villes allemandes, au napalm souvent, se justifiait par la nécessité d'amener le Reich à capituler plus rapidement et si la bombe d'Hiroshima s'imposait face au Japon. On semble avoir oublié assez facilement que dans ces métropoles il y avait des femmes et des enfants. De toute façon, on doit déplorer que des innocents soient les victimes de la guerre, toujours atroce : c'est elle la grande responsable.
Quant aux Américains, ils n'eurent pas de mots assez durs pour flétrir notre action. Ils ignoraient à l'époque que, bientôt, des milliers de tonnes de bombes s'abattraient chaque jour sur le Nord-Viêt-nam, lancées par des bombardiers lourds de l'U.S. Air Force!
En France, Robert Buron parlera "d'inconscience cynique et sereine de certains responsables militaires ou civils", Léon Noël "d'une telle stupidité qu'on ne comprend pas comment ce pays aveuli peut accepter pareille maladresse criminelle", tandis que le comte de Paris écrira :
"Le bombardement aérien d'un village, où se trouvent des fellagha, mais aussi des civils, des femmes, des enfants, est inadmissible sur le plan moral quant à ses conséquences diplomatiques."
Nous pouvions mesurer combien la propagande adverse, qui ne manquait pas d'exploiter tout incident, était habile. Comme l'écrivait le très gaulliste Louis Terrenoire :
"De Moscou à New York, en passant par Londres et Stockholm, chez nos alliés plus encore que chez les autres, ce fut à qui dauberait sur la France. De la voir clouée au pilori par tous - bourreaux de Budapest ou chasseurs de Mau-Mau - l'opinion nationale se partageait entre l'indignation, l'humiliation et la consternation (1). "
Rapidement, l'émotion soulevée par le bombardement dégénéra. Ce n'étaient plus les militaires dont on demandait la tête, mais c'est sur Robert Lacoste ou Félix Gaillard que l'on s'acharnait et, parfois, l'occasion se présentait de manifester sa sympathie à ceux qui soutenaient: le F.L.N. Jean Daniel pouvait écrire :
" Si aujourd'hui les Tunisiens se dominent mal, et je trouve encore que leur calme est singulier, c'est qu'ils ne s'y attendaient pas. On attend tout d'un ennemi, pas d'un futur associé. Même lorsqu'ils prenaient parti pour les Algériens contre la France, les Tunisiens avaient le sentiment qu'ils prenaient parti pour un , avenir d'association avec la France. Je crains que Sakiet ne soit la fin d'une grande espérance."
Toute la presse française, heureusement, ne nous accablait pas. Quelques journalistes, pour avoir un jour aussi fait la guerre, comprenaient notre réaction. Certains hommes politiques crurent bon de profiter de l'occasion pour intensifier leur propagande en faveur du retour au pouvoir du général de Gaulle. Ainsi Michel Debré, dans le Courrier de la colère du 14 février 1958, écrivait :
"Qu'un incident grave éclate... Ah ! si de Gaulle était là ! Mais le régime essaie de " tasser " l'incident, de camoufler la crise, afin d'éviter de Gaulle. Si le gouvernement de Salut public, que le général peut seul présider, était en place depuis plusieurs mois, nous ne serions pas où nous en sommes en Afrique du Nord... "
Quelques jours après, il confirmait cet appel :
"L'autorité a un sens, elle a aussi un nom... Le nom: c'est le général de Gaulle, seule personnalité capable d'allier à la fois le pouvoir et la liberté, l'indépendance et les alliances."
Quant à M. Alexandre Sanguinetti, bien qu'à l'époque non gaulliste, il faisait part au général Salan "de ses sentiments personnels de profonde admiration pour la façon dont il assume les responsabilités (2). "
1. De Gaulle et l'Algérie, Louis TERRENOIRE (Fayard).
2. Fin d'un empire, Raoul SALAN (Presses de la Cité).
On a reproché au commandement en Algérie d'avoir préféré l'action aérienne à un raid terrestre. Le raid d'aviation, écrira-t-on, n'était probablement pas le moins coûteux ni le plus efficace pour réprimer la permanente agression qui se préparait en territoire tunisien. Peut-être faudrait-il aller à Tunis ? Le général Aumeran, ancien parlementaire,
écrira: "L'impératif qui nous conduisit à faire la conquête de la Tunisie et du Maroc subsiste toujours." Sans aller jusqu'à cette extrémité, pourtant inscrite dans les intentions du gouvernement précédent, pouvait-on envisager, comme les esprits modérés regretteront qu'elle n'ait pas eu lieu, une riposte terrestre ? Elle fut certes étudiée et, compte tenu de l'importance des forces rebelles stationnées dans la région de Sakiet, elle aurait dû comporter l'engagement des troupes terrestres avec appui d'armes lourdes, d'artillerie, d'aviation. La mise en jeu de tels moyens, la dispersion des tirs d'artillerie auraient certainement provoqué dans Sakiet des destructions et des pertes bien supérieures à celles que causa l'action aérienne.
Les Tunisiens pouvaient-ils se référer au droit aérien international pour justifier leurs tirs contre nos avions ? La question ainsi posée demanderait la consultation de juristes spécialisés dans le droit aérien. Mais je ne crois pas inexactes les considérations suivantes.
D'abord, il n'a jamais été toléré que les artilleurs prennent pour cible les avions d'un État voisin, évoluant dans leur espace aérien, si les hostilités ne sont pas engagées entre les deux pays. La Tunisie se considérait-elle donc en guerre avec la France ?
Supposons cependant que des avions français aient survolé une partie de la Tunisie; le gouvernement de M. Bourguiba aurait pu interdire le survol de son territoire, en le notifiant au préalable à l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.) ou tout au moins en avertissant notre pays. Toutefois, c'est en fait la France qui aurait dû signifier cette interdiction puisque, aux termes des accords d'indépendance de 1955, les tâches de l'aéronautique civile en Tunisie nous avaient été confiées pour une durée de dix ans. De toute façon, même sans être membre de l'O.A.C.I., la Tunisie était tenue de respecter les règles internationales, car elle avait signé la convention de Chicago du 7 décembre 1944. En ce qui concernait d'autre part les avions militaires, il n'existait aucun texte de convention sur le survol de la Tunisie, étant donné la présence à Bizerte et Tunis de forces militaires aériennes françaises.
Au-delà des principes de droit, il y a aussi des règles établies en cas de survol non autorisé, ce qui peut arriver, par suite d'erreurs de navigation ou de détournement dues à des conditions météorologiques défavorables. Le feu n'est ouvert que si le pilote refuse de se soumettre aux ordres reçus. C'est ainsi que dans le couloir pourtant très chaud de Berlin, où les Russes étaient très pointilleux, aucun aéronef en infraction ne fut tiré par la D.C.A. soviétique.
Les Tunisiens agissaient à notre égard comme s'ils étaient en guerre. Pouvait-on interdire à nos équipages de se défendre ?
Il serait difficile de prétendre que l'attaque de Sakiet fut particulièrement appréciée par notre gouvernement. Pourtant, si le droit était de notre côté, le bombardement de Sakiet n'avait pas été aussi meurtrier qu'une démentielle propagande avait voulu le démontrer. Certes, il y eut ma!heureusement quelques innocentes victimes civiles, livrées en holocauste par le gouvernement tunisien ; car quelles raisons pouvait-il avoir d'installer ses batteries en plein centre des localités, au milieu des, maisons, alors que la campagne, aux alentours, était loin de manquer d'emplacements de tir ?
Enfin, une photographie aérienne, prise aussitôt après l'attaque, montrait que si les bâtiments, où était installée la D.C.A., étaient détruits à 80 % (gendarmerie, douane), l'école française et son annexe coranique, la mosquée, n'avaient pas été touchées. Le village de Sakiet était intact aux neuf dixièmes. En réalité, ce fut le bombardement de la mine, cantonnement des fellagha, qui causa les plus grandes pertes. Le 26 février, l'ambassade de France communiquait : "130 rebelles ont été tués, 40 blessés. La plupart d'entre eux appartenaient à une katiba qui venait de se réfugier depuis quelques jours en Tunisie."
Un détail révélateur de la duplicité tunisienne, que me confia M. Vovk, ingénieur à la Penarroya, ancien directeur de la mine de Sakiet : le lendemain de l'attaque, on redonna vie à l'école, désaffectée depuis plusieurs mois, le tableau noir portant une leçon datant, bien entendu, du 8 février et que le bombardement avait interrompue.
Nous ne fûmes pas désavoués officiellement par le gouvernement. M. Chaban-Delmas ne se montra toutefois guère chaleureux en privé. Le 22 février, à son arrivée à Alger, il répond au général Salan qui veut lui montrer des Corsair: "Cachez-moi ces avions que je ne saurais voir..." Et il détourna la tête (1).
Dans ses Mémoires, parus sous le titre L'Ardeur (2), l'ancien ministre prétend que le commandement "avait négligé d'en référer au gouvernement" et que "cela méritait sanction".
Il avait probablement prêté peu d'attention à l'accord que le général Ély nous avait donné, au nom du gouvernement. Pourtant, M. Chaban-Delmas admettait qu'il fallait tenir compte "des conditions insoutenables" qui "étaient imposées à nos troupes".
Je fus reçu par M. Chaban-Delmas, qui ne me cacha pas pouvoir m'estimer heureux d'avoir été couvert par mon ministre, par lui-même. Il stigmatisa l'action de Sakiet avec véhémence. J'appréciais fort peu ces propos, et je demandais au ministre si, d'abord, il désapprouvait l'accord de son chef d'état-major, le général Ély, à notre action et ce qu'il aurait fait s'il avait eu une responsabilité opérationnelle en Algérie. Nous nous quittâmes assez froidement, et c'est sans étonnement que je reçus un mot de mon secrétaire d'État à l'Air, M. Christiaens, me faisant savoir que ma promotion au grade de général d'armée aérienne, qu'il avait proposée au gouvernement avant Sakiet, devait être différée et qu'il me faudrait attendre un changement du climat politique.
Après les événements du 13 mai, avec l'arrivée au pouvoir de de Gaulle, ma cinquième étoile ne tardera pas à m'être attribuée.
1. Op. cit., Raoul SALAN.
2. L'Ardeur, Jacques CHABAN-DELMAS (Stock).
Ce n'est pas sans intérêt que nous attendions l'exposé que M. Chaban-Delmas devait nous faire, fin février. Nous ne fûmes pas déçus. Le ministre, tenant au préalable à indiquer qu'il avait couvert l'incident de Sakiet, militairement insignifiant, mais gros de conséquences politiques, poursuivait par une analyse du problème que posait la belligérance de fait de la Tunisie. Se félicitant du barrage construit de Bône à Tébessa, barrage appelé selon lui abusivement " Morice ", le ministre envisageait de faire le vide devant le barrage, de constituer un glacis où le rebelle pourrait être attaqué sans crainte de tension diplomatique avec la Tunisie. L'idée .aurait pu être retenue, si elle ne s'était pas heurtée à des difficultés considérables, dont en particulier le transfert de population. On se ralliera, en définitive, à la construction d'une seconde ligne fortifiée, longeant la frontière, formant avec la première une nasse où pourraient être pourchassées les unités fellagha qui tenteraient de rejoindre l'Algérie ou de faire mouvement vers la Tunisie pour se reposer et se réarmer. Cette solution démontra son efficacité.
On ne parla plus de Sakiet, mais j'échappai de peu à une mutation au commandement interarmées du Centre-Afrique, bien symbolique, cependant que le remplacement du général Salan fut décidé par Chaban-Delmas et entériné par Félix Gaillard. Il n'en fut rien, le gouvernement Gaillard étant mis en minorité le 15 avril 1958. Nous allons bientôt connaître les heures exaltantes du 13 mai.
Général Edmond Jouhaud. "Ce que je n'ai pas dit" Editions Fayard.
|
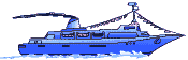 Retour au menu "Sakiet"
Retour au menu "Sakiet"