|
La Californie algérienne
La Mitidja, déblayée par l'épée va pouvoir recevoir la charrue, mais
Boufarik n'est pas au bout de ses peines. Il a seulement changé de fléau. Si
les colons n'y sont plus assassinés, ils y meurent encore de la fièvre et de
la dysenterie dont on ne parvient pas à limiter les ravages dans la
population. Aux sept années de combat avec les arabes, il faudra ajouter
douze années de lutte avec le sol, et cette seconde période sera encore plus
meurtrière que la première. En 1842, près de cent personnes mourront « de la
Maladie du climat » et le paroisse changera trois fois de prêtre, mais dans
la même année on aura construit douze maisons nouvelles, trois briqueteries,
un four à chaux, une fabrique d'eau gazeuse, un lavoir. Attirées par l'ordre
français qui les a débarrassées des pillards, les tribus fréquentent
désormais le marché hebdomadaire où l'on trouve de l'épicerie, des tissus et
de la quincaillerie, et bien entendu, des boeuf, des moutons ou des chèvres,
des volailles, du blé, de l'orge et des fèves. Tandis que l'année
précédente, le marché de Boufarik était désert, plus de 21.000 musulmans y
apparaîtront dans le seul second trimestre 1842. La population s'élève
maintenant à 559 habitants, le nombre des concessions urbaines à 263 —dont
192 lots bâtis en dur—, et celui des lots ruraux à 729 dont 198 sont mis en
culture. La même année, près de 2.000 arbres ont été plantés.
Trois ans plus tard, on compte une population européenne de 1928 individus
dont 1.100 français. Une école a été construite, 150.000 arbres ont été
plantés par les colons, et le marché a été fréquenté par 160.000 arabes.
Désormais, la vie à Boufarik va changer de visage.
Sans doute elle sera loin d'être idyllique, et elle ne le sera jamais.
Mais d'année en année la fièvre reculera,
les marais seront asséchés, drainés et transformés en bonne terre arable
couverte de moissons et de vergers. De nombreux hommes et femmes
succomberont à la peine, mais le taux de mortalité baissera rapidement et un
jour viendra où le climat de la région, totalement transformé par le travail
opiniâtre des colons, sera cité en exemple. Aujourd'hui, Boufarik montre au
voyageur deux monuments aux morts, le premier est élevé à la mémoire de ceux
qui sont tombés sur la glèbe, égorgés par des pillards ou brûlés par la
fièvre, et le second à la mémoire des, enfants et des petits-enfants des
premiers, tombés sur les champs de bataille de 1870, de 1914-18 ou de 39-45.
En 1841, le général Duvivier écrivait dans un livre dont on parla quelque
peu "Solution de la question Algérienne" (déjà), les phrases
suivantes:
"Il faut laisser la Mitidja infecte aux chacals,
aux courses des bandits arabes et en domaine à la mort sans gloire. Boufarik
est un malheur!... Il y a là une petite population européenne qu'il faut
empêcher de s'épandre, et qu'il est nécessaire d'amener, par tous les
moyens, à diminuer, voire même à se dissoudre! Des plaines, telles que
celles de Bône, de la Mitidja et tant d'autres, sont des foyers de maladies
et de mort! Les assainir?... On n'y parviendra jamais!..."
Quelque vingt ans plus tard Boufarik était relié à Alger par le chemin de
fer. Bientôt, Alphonse Laveran allait découvrir l'agent causal du paludisme,
et l'Institut Pasteur, avec les professeurs Mesnil, Roux, Sergent,
superposerait ses méthodes scientifiques aux méthodes empiriques de
l'assèchement pratiqué par les pionniers.
Pour
parvenir à un tel résultat, il avait fallu traverser de nombreuses
péripéties dont le caractère dramatique dépasse souvent en intensité celui
des aventures subies par les colons américains au cours de leur ruée vers
l'Ouest dont le cinéma d'outre-atlantique nous conte sans lassitude les
épisodes.
Sur le plan
de l'héroïsme quotidien, de l'audace, de la volonté, de la tragédie et
finalement du succès obtenu, les Français de la Mitidja n'ont rien a envier
aux fermiers de l'Arizona ou de la Californie. Une chose les sépare
toutefois, c'est que Boufarik est fréquenté par des milliers et des milliers
d'autochtones musulmans, alors que les Indiens
de l'ouest américain ont été tous massacrés.
Il est encore un fait qui les sépare: aux
Etats-Unis on ne perd aucune occasion de magnifier cette colonisation et
d'en faire une sorte d'épopée nationale, en
France, on préfère l'ignorer, la taire, parfois en rougir.
Bertrand Bouret- Paru dans "L'Echo des français d'AFN"
Extrait d'un article publié en septembre 1961 dans le numéro 18 des
"Documents de la Revue des Deux Mondes" |
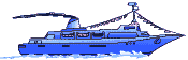 Retour au menu "compléments"
Retour au menu "compléments"