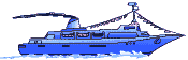« On peut choisir n'importe quelle date sauf le 19 mars ! » avait prévenu François Mitterrand. En votant, le 8 novembre 2013, la proposition de loi socialiste d'inspiration communiste visant à faire du 19 mars 1962, date du cessez-le-feu en Algérie, une « journée nationale du souvenir en mémoire des victimes du conflit », la majorité de gauche au Sénat a donc décidé de passer outre l'avertissement, prenant ainsi, délibérément, la responsabilité d'« un risque grave de division de la communauté nationale » selon les termes de l'Union nationale des combattants. Sur le plan diplomatique, la « défaite » française en Algérie est de fait incontestable. Mais il est également vrai qu'elle était inscrite dès le début dans le processus des négociations. Et ce, pour une raison simple : l'Elysée était demandeur et pressé…
C'est le 20 février 1961 que, dans le plus grand secret, Georges Pompidou et Bruno de Leusse prennent contact en Suisse, à l'hôtel Schweitzer de Lucerne, avec les représentants du GPRA (Gouvernement provisoire de la République française), Ahmed Boumendjel, Taïeb Boulahrouf et Saad Dalhab. Selon les instructions reçues, il ne s'agit pour les représentants français que d'une mission d'information sur les objectifs à long terme du FLN et sur les voies et étapes qu'il compte emprunter pour y parvenir.
Immédiatement, Pompidou donne le ton en affirmant que la France a la situation bien en main, que l'Algérie n'est pas l'Indochine - « Il n'y aura pas de Dien Bien Phu »-, que les menaces de Khrouchtchev ou de tout autre ne font pas peur à De Gaulle et, pour finir, que la France ne craint pas l'indépendance algérienne. Elle exige donc un arrêt des combats avant d'entreprendre des pourparlers avec toutes les tendances sur les conditions de l'autodétermination, dont elle a accepté, depuis le référundum du 8 janvier 1961, le principe. Mais tout de suite aussi, les Algériens font connaitre leur refus de bouger d'un pouce sur la question du cessez-le-feu qui, disent-ils, doit résulter d'un accord politique. Que va décider De Gaulle ?
Le 8 mars, lors d'une nouvelle réunion, Bruno de Leusse lit devant les émissaires du GPRA un communiqué du chef de l'Etat appelant à l'ouverture de discussions « sans conditions préalables ». En bref, le cessez-le-feu n'en est pas un. Il sera l'objet de négociation comme un autre…
Les trois autres exigences du mouvement révolutionnaire sont claires :
Le 15 mars, un communiqué du Conseil des ministres « confirme son désir de voir s'engager, par l'organe d'une délégation officielle, des pourparlers concernant les conditions d'autodétermination des populations algériennes concernées ainsi que les problèmes qui s'y rattachent ». Le 30 mars, le gouvernement français et le GPRA annoncent simultanément que les pourparlers s'ouvriront le 7 avril à Evian. Mais le lendemain, interrogé par la presse sur ses contacts avec Messali Hadj, le leader du Mouvement national algérien (MNA), rival du FLN, Louis Joxe, le ministre en charge des Affaires algériennes, déclare qu'il consultera le MNA comme il consultera le FLN. Aussitôt la nouvelle connue, le GPRA annule les pourparlers.
Que va faire de Gaulle?
Le 6 avril, le Conseil des ministres publie un communiqué prenant acte de l'ajournement de la conférence d'Evian et conclut sobrement: « Le gouvernement s'en tient, pour ce qui le concerne, à l'esprit et aux termes de son communiqué du 15 mars. » Le FLN sera donc l'interlocuteur unique et le représentant exclusif du peuple algérien.
Sur ce, le 21 avril, éclate le putsch des généraux dont l'échec entraîne la création de l'OAS par Pierre Lagaillarde et Jean-Jacques Susini. La violence atteint vite un seuil insoutenable et De Gaulle avoue à Robert Buron ne plus rien maîtriser. « Il n'y a plus, dit-il, que deux forces en présence : le FLN et l'OAS. »
C'est dans ce contexte que, le 20 mai, les négociations s'ouvrent à Evian. Du côté français, outre Louis Joxe, la délégation comprend, entre autres, Bernard Tricot, Roland Cadet, Claude Chayet et Bruno de Leusse. Tous des professionnels de la négociation. Du côté algérien, le chef de file n'est autre que Krim Belkacem, dont l'instruction se résume à un passé de maquisard. Pour marquer sa bonne volonté, le chef de l'Etat annonce une trève unilatérale d'un mois (l'action des troupes françaises sera limitée à l'autodéfense), la libération de 6000 prisonniers et le transfert au château de Turquant, en Indre-et-Loire, des chefs du FLN capturés en 1956.
Après une première interruption des pourparlers le 13 juillet due, notamment, à des divergences sur le Sahara, une reprise des négociations au château de Lugrin, le 20 juillet, et un nouveau capotage pour la même raison, De Gaulle déclare, le 5 septembre, accepter la souveraineté du FLN sur le Sahara, dont il disait quelque temps plus tôt à Louis Joxe : « Le pétrole, c'est la France et uniquement la France ! » Ne reste plus en suspens que le sort des pieds noirs et des musulmans fidèles à la France, qu'il évoque d'ailleurs dans la suite de son discours, en parlant de « dégagement ». Dans le camp d'en face, Benyoucef Ben Khedda, un marxiste, succède à Ferhat Abbas à la tête du GPRA.
Le 11 février 1962, les négociations reprennent aux Rousses. Elles s'achèvent une semaine plus tard sur un ensemble de textes qualifiés d'« accords de principe » que les Algériens doivent soumettre au CNRA, l'instance suprême de la Révolution, réuni à Tripoli.
Le 7 mars s'engage la seconde conférence d'Evian qui traîne trop aux yeux de l'Elysée. Robert Buron décrit un De Gaulle « moins serein, moins souverain » au téléphone. Dans son Journal, à la date de ce 18 mars, Buron reconnait que sa signature figure au bas d'un « bien étrange document ». Et il note : « Les jours qui viennent vont être des jours de folie et de sang ».
Car si le texte assure en principe aux Français d'Algérie « toutes libertés énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme », ainsi que la possibilité de « transporter leurs biens mobiliers, liquider leurs biens immobiliers, transférer leurs capitaux », l'Elysée a renoncé à tout statut particulier pour nos nationaux et aucune clause ne concerne précisément les supplétifs. Le lendemain 19 mars, le cessez-le-feu est proclamé du côté français par le général Ailleret, du côté algérien par Ben Khedda. Ce nettoyage ethnique qu'évoque sans fard dans ses Mémoires, l'ancien président du GPRA, Ben Khedda, en se vantant d'avoir réussi à « déloger du territoire national un million d'Européens, seigneurs du pays », était en germe depuis longtemps puisque les négociateurs du FLN à la conférence de Melun, Boumendjel et Ben Yahia, en avaient fait la confidence à Jean Daniel dès le 25 juin 1960 : « Croyez-vous, leur avait demandé le journaliste, originaire de Blida, qu'avec tous ces fanatiques religieux derrière vous, il y aura dans une Algérie indépendante un avenir pour les non-musulmans, les chrétiens, les juifs auxquels vous avez fait appel ? » Les deux responsables FLN ne s'étaient pas dérobés : « Ils m'ont alors expliqué, témoigne Jean Daniel, que le pendule avait balancé si loin d'un seul côté pendant un siècle et demi de colonisation française, du côté chrétien, niant l'identité musulmane, l'arabisme, l'islam, que la revanche serait longue, violente et qu'elle excluait tout avenir pour les non-musulmans. Qu'ils n'empêcheraient pas cette révolution arabo-islamique de s'exprimer puisqu'ils la jugeaient juste et bienfaitrice. »
Détail important : la livraison au FLN par Hacq, ce 19 mars, de la liste des activistes n'est pas une nouveauté. Elle fait suite à une première liste de 3000 noms adressée au FLN par l'intermédiaire de Lucien Bitterlin, l'un des chefs des barbouzes, dès janvier 1962… C'est-à-dire trois mois avant les accords d'Evian, qui vont voir les relations entre Hacq et Si Azzedine se renforcer. Lors de la crise des Barricades, (la première révolte des pieds-noirs après le discours de De Gaulle annonçant, en septembre 1959, l'autodétermination) en janvier 1960, le chef rebelle a en effet affirmé à l'ambassadeur américain à Tunis, Walter Walmsley, que si De Gaulle avait besoin de soutien, le GPRA se mobiliserait à ses côtés contre tous ceux qui s'opposent à l'indépendance de l'Algérie. Et donc, par extension, contre tous les Français d'Algérie à quelque confession qu'ils appartiennent. Ce 19 mars 1962, la guerre n'est donc pas finie: seuls les alliés et les adversaires ont permuté en fonction des développements successifs de la politique gaulliste. Elle va même prendre un tour extrême quelques jours plus tard.
Le 26 mars, rue d'Isly, une manifestation interdite mais pacifique de Français d'Algérie se dirigeant vers le quartier de Bab-el-Oued, foyer de l'OAS, encerclé par l'armée, se heurte à un barrage de tirailleurs venus du bled. Elle est mitraillée à bout portant. Bilan : près de 49 morts et 200 blessés. Dans la folie meurtrière qui, sous les coups conjugués de l'OAS, du FLN, des barbouzes et du « Détachement métropolitain de police judiciaire» (couverture officielle de la fameuse mission « C » constituée de 200 policiers, et d'une trentaine de gendarmes aux ordres du capitaine Armand Lacoste), s'empare de l'Algérie et menace la métropole, la figure de l'« ennemi commun » se précise : Le rapport de Jean-Marie Robert, sous-préfet d'Akbou en 1962, adressé à Alexandre Parodi, vice-président du Conseil d'Etat, donne une idée détaillée des massacres auxquels se livre alors le FLN sur les supplétifs de l'armée française mais aussi sur les élus (maires, conseillers généraux et municipaux, anciens combattants, chefs de village, etc) « promenés habillés en femmes, nez, oreilles et lèvres coupées, émasculés, enterrés vivant dans la chaux ou même dans le ciment, ou brûlés vifs à l'essence ».
Aux massacres de harkis qui atteignent bientôt des proportions et une horreur inimaginables, s'ajoutent les enlèvements d'Européens : de l'ordre de 300 à 400 entre novembre 1954 et mars 1962, ils se multiplient brusquement à partir de cette date pour atteindre selon les travaux de Jordi le chiffre de 3000 -dont 1630 disparus. Devant l'exode, dont il nie la réalité jusqu'au dernier moment, le chef de l'Etat ne se soucie que de la « concentration » des réfugiés dans le sud de la France. Certains comme Joxe souhaitant envoyer cette « mauvaise graine » au Brésil ou en Australie, De Gaulle répond qu'ils aillent en Nouvelle-Calédonie ou plutôt en Guyane… En Conseil des ministres, le 25 juillet, Alain Peyrefitte note que « plusieurs collègues baissent la tête »… Et le chef de l'Etat est sans doute conscient de son effet puisque le même Peyrefitte rapporte que Pompidou, mi-plaisant mi-sérieux, lui raconte que le Général a déclaré à Mme De Gaulle : « Je vous le dis Yvonne, tout ça se terminera mal. Nous finirons en prison. Je n'aurai même pas la consolation de vous retrouver puisque vous serez à la Petite Roquette et moi à la Santé. »
En réalité la détermination présidentielle est sans faille et pour que les choses soient bien claires, de Gaulle insiste : « Napoléon disait qu'en amour, la seule victoire, c'est la fuite ; en matière de décolonisation aussi, la seule victoire c'est de s'en aller. »
Soixante sénateurs UMP ont d'ailleurs déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Les associations de rapatriés ne désarment pas. Leurs dirigeants sont unanimes. Non seulement parce que la date du 19 mars est celle d'une défaite, mais parce qu'elle n'a même pas marqué, sur le terrain la fin de la guerre: bien plutôt la fin de l'engagement des autorités françaises dans la défense de leurs ressortissants et le début des terrifiantes violences dont furent victimes les Français d'Algérie et les supplétifs engagés aux côtés de la France.
C'est l'impasse. Et la situation n'évolue guère lorsque les mêmes se retrouvent pour une nouvelle réunion, le 5 mars suivant, à Neuchâtel. « Les contacts secrets confirmaient l'absence complète d'accord sur les liens à établir entre les éventuels pourparlers officiels et la cessation des violences », écrit Bernard Tricot, qui assurait alors le secrétariat de la Direction des affaires algériennes à l'Elysée.
A la « trêve statique » des Français, les Algériens opposent leur « cessez-le-feu dynamique » qui serait fonction des progrès de la négociation…
Ce 8 mars 1961, De Gaulle vient donc d'en passer par la première des quatre volontés du FLN.
1) le FLN doit être considéré comme le seul représentant qualifié du peuple algrérien ;
2) l'Algérie est une, Sahara compris (ce qui n'a aucun fondement historique: le Sahara n'a appartenu à l'Algérie que sous la souveraineté française) ;
3) le peuple algérien est un, et ce que décidera la majorité du peuple vaudra pour tout le territoire et pour tous ses habitants. Il ne doit donc y avoir aucun statut particulier pour les Européens. C'est le futur gouvernement algérien qui, une fois installé, décidera avec son homologue français des garanties dont ils jouiront, des modalités de la coopération et des questions de défense. En attendant, il convient de discuter des garanties de l'autodétermination.
Tricot constate : « Les commentateurs les plus avertis se doutèrent bien que si le cessez-le-feu n'était pas mentionné séparément, c'est qu'il faisait désormais partie des problèmes qui se rattachaient à l'autodétermination et qu'il ne constituait pas un préalable. »
Ce 6 avril 1961, De Gaulle vient donc d'en passer par la deuxième des quatre volontés du FLN. Cette double capitulation en l'espace d'un mois explique peut-être les temes un peu crus de sa déclaration du 11 avril : « L'Algérie nous coûte, c'est le moins que l'on puisse dire, plus qu'elle nous rapporte (…) Et c'est pourquoi, aujourd'hui la France considérerait avec le plus grand sang-froid une solution telle que l'Algérie cessât d'appartenir à son domaine»
Ce 5 septembre 1961, il vient donc d'en passer par la troisième des quatre volontés du FLN.
Le mot résonne douloureusement à leurs oreilles, même si De Gaulle assure qu'en cas de rupture brutale avec l'Algérie, l'Etat entreprendra de « regrouper dans une région déterminée les Algériens de souche européenne et ceux des musulmans qui voudraient rester avec la France », donnant ainsi un début de réalité au thème de la « partition » lancé à sa demande par Peyrefitte.
Le 18 mars, juste avant la signature, Krim Belkacem fait valoir une exigence : que les délégués français lisent à voix haute les 93 pages du document. Ces derniers s'exécutent en se relayant, article après article, tandis que les délégués algériens suivent attentivement chaque mot et que De Gaulle, à l'Elysée, attend.
Le rituel imposé une fois terminé, les accords d'Evian sont paraphés par les deux délégations.
Ils prévoient l'organisation d'un référundum sur l'indépendance. Il aura lieu le 1er juillet. Dans l'intervalle, le pouvoir sera exercé par un exécutif provisoire, sous la direction de Christian Fouchet.
C'est la quatrième des exigences du FLN.
Or, ce même 19 mars censé instaurer la paix, le directeur de la police judiciaire, Michel Hacq, patron de la mission « C » (C pour choc) qui supervise les barbouzes (ces « éléments clandestins » chargés depuis décembre 1961 de la lutte contre l'OAS), rencontre secrètement le chef fellagha Si Azzedine, patron de la Zone autonome d'Alger, pour lui remettre une liste d'activistes.
Tout y est : les noms et les pseudonymes, les âges et les adresses. « Le marché est clair, écrit Jean-Jacques Jordi : les commandos d'Azzedine peuvent se servir de cette liste pour leurs actions contre l'OAS et ils peuvent “ bénéficier ” d'une certaine impunité d'autant que les buts du FLN et de la mission “ C ” se rejoignent (…) Cependant, force est de constater que ces mêmes commandos FLN ne s'attaquaient pas réellement aux membres de l'OAS mais poursuivaient une autre stratégie : faire fuir les Français par la terreur. »
Force est donc de constater que, sur le terrain, le cessez-le-feu ne change rien à la poursuite de l'offensive menée de concert par le pouvoir gaulliste et le FLN contre « leur ennemi commun » selon l'expression de Krim Belkacem.
Message entendu à l'Elysée.
« On n'allait bientôt plus savoir qui tuait qui et pour le compte de qui ! On tuait, voilà tout », écrit Bitterlin.
Le drame n'a rien d'un dérapage : Christian Fouchet s'en est justifié plus tard lors d'une confidence à Jean Mauriac : « J'en ai voulu au Général de m'avoir limogé au lendemain de Mai 68. C'était une faute politique.
Il m'a reproché de ne pas avoir maintenu l'ordre : “Vous n'avez pas osé faire tirer [sous-entendu: sur les manifestants étudiants]-J'aurais osé s'il avait fallu, lui ai-je répondu.
Souvenez-vous de l'Algérie, de la rue d'Isly. Là, j'ai osé et je ne le regrette pas, parce qu'il fallait montrer que l'armée n'était pas complice de la population algéroise. ” »
le 3 avril 1962, lors d'une réunion du Comité des affaires algériennes, De Gaulle déclare qu'« il faut se débarrasser sans délai de ce magmas d'auxilliaires qui n'ont jamais servi à rien » et il donne l'ordre de désarmer les harkis (que des ordres complémentaires de Joxe et de Messmer empêcheront de gagner la France et, pour certains de ceux qui y seront parvenus malgré tout, rembarqueront de force pour l'Algérie).
Le 4 mai, en Conseil des ministres, il déclare que : « L'intérêt de la France a cessé de se confondre avec celui des pieds-noirs. »
Les uns et les autres font donc partie du « boulet » dont il avait avoué à Alain Peyrefitte, le 20 octobre 1959, qu'il faudrait s'en « délester ».
Cette disposition d'esprit du chef de l'Etat a une traduction concrète sur le terrain : en vertu de l'ordre donné à l'armée de rester l'arme au pied quoi qu'il arrive à nos nationaux, la politique d'abandon de l'Algérie se double d'une politique d'abandon des populations qui se réclament de la France et dont le sort est désormais lié au seul bon vouloir du GPRA.
Dans l'indifférence la plus totale de la part du gouvernement français que n'émeut pas davantage le massacre du 5 juillet ( jour officiel de l'indépendance algérienne après la victoire du oui au référendum du 1er juillet) à Oran, qui va coûter la vie à 700 Européens.
« Pour la France, à part quelques enlèvements, les choses se passent à peu près convenablement », déclare même De Gaulle le 18 juillet.
L'ordre qu'il donne alors, le 18 juillet, est d'obliger les « repliés » ou les « lascars » (c'est ainsi qu'il appelle les pieds-noirs selon son humeur du jour) à « se disperser sur l'ensemble du territoire ». S'attirant cette réponse de Pompidou, nouveau Premier ministre : « Mais à quel titre exercer ces contraintes, mon général ? On ne peut tout de même pas assigner des Français à résidence ! Les rapatriés qui sont autour de Marseille ne créent aucun problème d'ordre public. On ne peut pas les sanctionner ! »
il réplique : « Si ça ne colle pas, il faut qu'on se donne les moyens de les faire aller plus loin ! Ça doit être possible sous l'angle de l'ordre public. »
Mais son intention véritable, il le dit et le répète, c'est de faire en sorte que tous retournent sans délai dans cette Algérie, dont ils sont parvenus -souvent in extremis-à fuir la terreur.
Henri-Christian Giraud - Publié le 16/03/2015 à 15:57
http://www.lefigaro.fr/histoire/2015/03/16/26001-20150316ARTFIG00250-guerre-d-algerie-les-tragedies-du-19-mars-1962.php